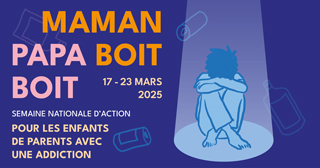L’exil, cassure du monde qui nous entoure
Migration et confinement 5. L’immobilité caractérise la personne confinée. La mobilité marque la personne exilée. Pourtant, les expériences des unes et des autres se sont brutalement rapprochées. L’occasion de fluidifier notre perception du monde ?
Par Claudio Bolzman, professeur honoraire, HES-SO, Haute école de travail social Genève
A première vue, il n’y a rien de commun entre le confinement au temps du Covid-19 et la migration. En effet, le confinement est un cas extrême d’immobilité, alors que la migration est une figure emblématique de la mobilité. Cependant, la sociologie nous invite à sortir des sentiers battus et à creuser au-delà de la surface pour mieux comprendre les articulations possibles entre ces deux phénomènes [1].
Une première piste est de nous inspirer du cadre d’analyse de la migration pour comprendre certaines dimensions centrales du confinement et de ses effets, mais aussi de nous rappeler les expériences vécues dans ces temps si particuliers et d’examiner leurs liens avec le vécu des personnes migrantes. Autrement dit, penser le confinement avec le regard de la migration, penser la migration avec l’expérience du confinement. Bien entendu, il ne faut pas forcer non plus les similarités, et nous en tiendrons compte lorsque c’est nécessaire. Mais en ce temps de renforcement des frontières étatiques, il me semble important de fluidifier notre perception du monde plutôt que de renforcer nos frontières mentales. Je me focaliserai en particulier sur une forme particulière de migration, l’exil, plus habituellement connue comme l’asile, car on la regarde du point de vue des sociétés de destination. Puis, dans un deuxième temps, je m’interrogerai sur les défis qui attendent le travail social dans ce nouveau contexte.
Rupture dans la vie quotidienne
L’exil est une rupture radicale de la vie quotidienne et de ses évidences suite à des situations de violence politique [2]. Il y a, dans ce contexte, une cassure du monde social, de sa prévisibilité, des rythmes et des habitudes qui faisaient croire que demain ne serait pas trop différent d’aujourd’hui et d’hier. Le départ pour se protéger de la violence et de l’insécurité en est la conséquence. Dans le cas de la pandémie du Covid-19, les mesures de confinement ou de semi-confinement prises par les gouvernements face à la pandémie induisent aussi une rupture profonde de la vie quotidienne des personnes concernées.
Les personnes exilées quittent une réalité en plein bouleversement, mais malgré tout familière, connue, faite d’évidences, de rituels rassurants, pour se transporter vers un monde inconnu, déstabilisant où les choses les plus simples peuvent devenir un problème. En effet, elles ne disposent souvent pas des codes nécessaires pour accéder aux clés de compréhension de leur nouvelle société. Chaque pas est une aventure incertaine. Quelle est la bonne distance pour avoir une conversation ? Comment saluer les autres ? Peut-on les toucher ? Peut-on s’asseoir à côté de quelqu’un dans les transports publics ? Pourquoi les gens regardent bizarrement si l’on se rapproche d’eux ou si on leur adresse la parole ? On pourrait continuer la liste, qui nous rappelle à dessein les expériences quotidiennes faites par chacun au temps du coronavirus. En tout cas, les actes les plus banals deviennent source de questionnement, d’inquiétude, voire d’angoisse.
Le départ en exil est un acte qui amène à la séparation des proches, notamment des parents, qui restent le plus souvent au pays, mais parfois aussi d’autres membres de la famille, sans parler des amis. Dans le cadre de cet éloignement forcé, on souhaite vivement garder le contact avec celles et ceux qui demeurent derrière ou qui sont parti·es ailleurs. On cherche ainsi à se construire une intimité à distance [3] avec les autres en utilisant les nouvelles technologies de la communication, telles que Whatsapp, Skype, Facebook, etc. On est poussé à inventer de nouvelles formes de faire famille [4] où l’on se rencontre et on échange des nouvelles, des conseils, des affects de manière virtuelle. C’est l’expérience vécue aussi par les personnes confinées, qui ne peuvent plus voir leurs parents âgés ou leurs enfants et petits-enfants et doivent recourir à d’autres moyens de communication pour garder les liens.
Promiscuité dans les foyers
A l’arrivée dans un nouveau pays, les exilé·es, deviennent des requérant·es d’asile. Ils et elles sont évalué·es à l’aune de la logique étatique et du système administratif de la société de destination. En Suisse, ces personnes passent la première sélection dans les Centres fédéraux prévus à cet effet, puis elles sont envoyées dans les cantons et placées, pour la plupart, dans des foyers collectifs, où elles doivent partager les cuisines, les toilettes et, parfois, même les chambres, dans le cas des célibataires, avec d’autres personnes qu’elles ne connaissaient pas auparavant. En temps de Covid-19, la consigne est « restez chez vous », mais c’est où « chez nous » pour ces requérant·es qui se trouvent dans la promiscuité des foyers ? Comment garder les distances sociales quand on doit côtoyer d’autres personnes dans un espace limité tout au long de la journée ? Ces expériences sont partagées, dans une certaine mesure, par des personnes dont le logement est trop exigu, dont le ménage vit des situations conflictuelles ou de crise. Et que dire des personnes sans domicile fixe ?
Les requérant·es d’asile sont confronté·es à l’interdiction de travailler pendant les premiers mois de séjour en Suisse. Puis, quand l’interdiction est levée, les contraintes légales et administratives, voire les préjugés, sont tellement importants que seule une infime portion de requérant·es accède au marché du travail. Ils et elles doivent vivre d’une aide sociale minimale, bien plus faible que le montant, déjà très bas, reçu par les personnes suisses et étrangères résidentes qui se trouvent au bénéfice de l’assistance.
Ils et elles aimeraient bien « gagner leur vie », être autonomes, mais les obstacles sont quasi insurmontables. C’est l’expérience que font aussi de nombreux indépendants, petits patrons ou salariés qui, du jour au lendemain, voient leur activité interdite pour cause de pandémie. Ils et elles doivent se tourner vers l’assurance perte de gain ou le chômage pour pouvoir subsister. Tout comme les requérant·es d’asile, ils et elles s’inquiètent de leur avenir, craignent de ne plus pouvoir continuer à travailler dans leur entreprise et s’interrogent sur la source de leurs revenus dans le futur proche. De plus, certaines personnes, travaillant par exemple dans l’économie domestique, passent « entre les mailles du filet » et ne reçoivent aucun soutien officiel, dépendant ainsi presque exclusivement de la solidarité informelle de bénévoles et des associations privées.
Aide conditionnelle sans «paresse»
Les migrant·es en général, et les requérant·es d’asile en particulier sont confronté·es à une logique du soupçon, ils et elles étant perçu·es comme des abuseur·ses potentiel·les du système d’aide sociale [5], comme des personnes qu’il faut « activer » par des incitations ou des sanctions (par exemple augmentation ou diminution de leur part d’assistance) afin qu’ils et elles ne se complaisent pas dans la facilité. Ces personnes doivent s’engager à participer à certaines activités de formation (cours de langue locale), d’information (sur les « coutumes locales ») et à des tâches collectives d’entretien de leur lieu de résidence si elles veulent recevoir l’ensemble de la somme d’assistance. Les personnes qui, suite au mesures de confinement, se retrouvent sans travail et dépendent du soutien des assurances sont aussi averties qu’elles ne doivent pas faire de ces aides « un oreiller de paresse ». On leur rappelle que ces soutiens seront temporaires, afin qu’elles retournent au plus vite au travail, même si on ne sait rien sur la viabilité future de leur activité professionnelle.
Les personnes exilées ne sont pas perçues comme des individus singuliers, mais comme les représentant·es d’une catégorie générale, les requérant·es d’asile. On les juge non pas en fonction de leurs qualités et défauts individuels (sympathique/antipathique, intelligent/stupide, etc.) mais en fonction de leur appartenance à cette catégorie [6]. Puisqu’on ne les connaît pas personnellement, ils et elles font parfois peur ou alors on les assigne à leurs rôles de victimes. Avec la pandémie de Covid-19, on observe aussi l’émergence de formes de catégorisation, liées à l’âge par exemple. Les personnes âgées, vues comme un tout homogène, sont à risque et n’auraient qu’à rester chez elles pour ne pas déranger le reste de la société qui pourrait ainsi continuer tranquillement ses activités, sans devoir prendre de précautions « excessives ». Avec le personnel soignant, dans certains contextes, les réactions sont encore plus extrêmes dans leur incongruence : fêtés comme des héros chaque soir, mais parfois stigmatisés par leurs voisins qui voient en eux des porteurs de la contagion et de la maladie.
Dans ce contexte difficile, où elles sont perçues avant tout comme des personnes « étrangères », à savoir un peu d’ici mais pas tout à fait, de nombreuses personnes exilées rêvent d’un retour à leur pays d’origine où elles espèrent vivre à nouveau « normalement », sans être pointées du doigt. En temps du coronavirus, beaucoup de monde rêve aussi de la fin de la pandémie et du retour à la normale, au temps où « il faisait bon vivre ». Mais si le retour est possible dans l’espace, il ne l’est pas dans le temps [7]. Les expériences vécues nous marquent, nous font changer, parfois grandir et il n’y aura pas de retour à l’identique au monde d’avant.
Cohésion sociale et libération
Selon la définition globale de l'Association internationale des écoles de travail social et de la Fédération internationale des travailleurs sociaux, « le travail social est une profession basée sur la pratique et une discipline universitaire qui favorise le changement et le développement social, la cohésion sociale, ainsi que l'autonomisation et la libération des personnes. Les principes de justice sociale, des droits de l'homme, de la responsabilité collective et du respect de la diversité sont au cœur du travail social […] le travail social engage les personnes et les structures à relever les défis de la vie et à améliorer le bien-être » [8].
Dans cette période de confinement, puis du processus de déconfinement, le travail social devra relever des « défis de la vie » inédits. Le virus n’a pas disparu et les gestes barrières ainsi que les règles de distanciation physique seront encore maintenus pendant une phase longue dont on ne peut pas prévoir la durée. Comment, dans ce contexte, incarner les principes de la profession dans l’intervention auprès des populations vulnérables, et en particulier auprès des requérant·es d’asile ?
Se référant à l’intervention interculturelle, Margalit Cohen Emérique, définit des pistes aisément généralisables à l’ensemble du travail social : écoute compréhensive, travail de décentration sur ses a priori, climat d’acceptation et de confiance, dialogue et négociation basés sur le respect de la personne, de sa vision du monde, de son système de valeurs et de ses besoins [9]. Il s’agit donc de considérer la personne comme la principale experte de sa vie et de prendre au sérieux son point de vue, si l’on veut entamer un accompagnement dialogique vers une véritable co-construction des actions à venir. Cela est particulièrement valable dans cette période incertaine et déstabilisante pour un grand nombre de personnes. Il ne s’agit pas de faire à leur place mais avec elles, en accordant une attention digne de ce nom au tâtonnement, à l’exploration conjointe et à la créativité.
Le piège du tri social
Si l’on considère à sa juste valeur la définition du travail social, il faut considérer aussi les obstacles contextuels. Ils sont légaux, administratifs, institutionnels, discriminatoires, etc. Ils empêchent le renforcement des ressources, des droits et, in fine, du pouvoir d’agir des personnes vulnérables (ou vulnérabilisées par les circonstances). Il ne suffit donc pas de soutenir et accompagner ces personnes. Il est également important d’agir sur l’environnement afin de tenter de le rendre moins hostile envers ces publics. Les travailleuses et travailleurs sociaux qui connaissent particulièrement bien leurs terrains ont un rôle à jouer dans la diffusion d’informations précises sur les conditions de vie et les obstacles rencontrés par les populations exilées, dans la sensibilisation du public, souvent peu familier avec la précarité qui risque d’augmenter fortement dans la période à venir.
Un des dangers les plus sérieux dans cette nouvelle période est la frontiérisation des pauvres, avec une distinction entre les « bons pauvres » (les pauvres de « chez nous ») et les « mauvais pauvres » (les pauvres d’ailleurs). Autrement dit, les risques d’un tri social hiérarchisant les êtres humains selon la couleur de leur passeport ou leurs origines géographiques ou ethniques. Le travail social, profession des droits humains, doit être particulièrement vigilant pour éviter ce piège de déshumanisation aux conséquences néfastes non seulement pour les personnes ainsi discriminées, mais pour l’ensemble de la société. La force d’une société ne se mesure-t-elle pas à la manière dont elle traite le plus faibles de ses membres ?
[1] C’est l’occasion de remercier ma collègue, la professeure Bhama Steiger, professeure à la Haute école de travail social et de la santé de Lausanne qui a pris l’initiative de me solliciter pour écrire ce texte. En bonne sociologue, elle a suivi son intuition, ou ce que les scientifiques nomment la sérendipité, à savoir la disposition à explorer l’inattendu, ce qui n’était pas prévu dans le programme. Elle a eu raison de se méfier des évidences et de lancer une vaste réflexion sur la relation entre migrations, Covid19 et travail social. NDLR Cet article clôt le dossier spécial «Migration et confinement» sollicité par Bhama Steiger.
[2] Bolzman, C. (2014). Exil et errance. Pensée plurielle, 35, 43-52. En ligne
[3] Coenen-Huther, J., Kellerhals, J. & Von Allmen, M. (1994). Les réseaux de solidarité dans la famille. Lausanne: Réalités sociales
[4] Nedelcu, M., & Wyss, M. (2016). ‘Doing family’ through ICT-mediated ordinary co-presence routines: Transnational communication practices of Romanian migrants in Switzerland. Global Networks, 16(2), 202–218. DOI
[5] Bolzman, C. (2019). La figure de l’étranger et la perspective interculturelle : quelles articulations possibles ?, in Mekideche, T. et Tanon, F. (Eds.). L'interculturel, d'hier à demain. De la lente construction d'un champ épistémologique. Paris : L’Harmattan, 55-76
[6] Ibid
[7] Jankélévitch, V. (1983). L’irréversible et la nostalgie. Paris : Flammarion.
[8] En ligne (consulté le 4.5.2020).
[9] Cohen-Emerique, M. (1993). L’approche interculturelle dans le processus d’aide. Santé mentale au Québec, 18(1) : 71-92. DOI
Partager
Proposer un commentaire
Votre avis nous intéresse
Comment citer cet article ?
Claudio Bolzman, «L’exil, cassure du monde qui nous entoure», REISO, Revue d'information sociale, mis en ligne le 5 octobre 2020, https://www.reiso.org/document/6447