Pour réunir les savoirs
et les expériences en Suisse romande
S'abonner à REISO
Janvier 2025: sélection de la bibliothèque des HES de Fribourg
Pour débuter cette année 2025, Marie Etique, de la Haute école de travail social Fribourg, propose une sélection s'intéressant au handicap, à la santé mentale, et au lien social, qu'il s'agisse de le développer ou de le restaurer.

- Clémence Giroud
- La liminalité dans l’emploi inclusif des personnes présentant un trouble du développement intellectuel : une situation de seuil entre deux réalités
- Édition SZH/CSPS, Bern, 2024
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le fait d’occuper un emploi inclusif ne garantit pas aux personnes en situation de handicap une pleine et entière participation sociale. Malgré la place physique offerte en entreprise ordinaire, l’acceptation sociale et le sentiment d’appartenance ne vont pas de soi. Les travailleuses et travailleurs intégrés peuvent se retrouver maintenus dans une position latente, à l’intermédiaire entre le monde du handicap et la société ordinaire. Cet état d’entre-deux se définit par le concept de liminalité.
Cette recherche a été menée auprès de personnes présentant un trouble du développement intellectuel (TDI) qui occupent un emploi inclusif sur le marché du travail ordinaire. Son objectif est de comprendre dans quelle mesure l’occupation d’un emploi inclusif constitue ou non un moyen de s’extraire du statut d’outsider défini par leur appartenance à l’institution spécialisée et d’accéder à un nouveau statut plus valorisé. Pour répondre à la question de recherche, l’autrice s’est entretenue avec des travailleuses et travailleurs présentant un TDI afin d’étudier leur participation sur le marché du travail ordinaire. Elle a également rencontré les personnes en charge de faciliter l’intégration au sein de l’entreprise dans le but de comprendre leur rôle et leur expérience d’accueil de la diversité. Le croisement de ces deux perspectives met en évidence la complexité des enjeux sous-jacents à l’exercice d’un emploi inclusif. Du côté de l’employeur, un de ces enjeux interroge l’impensée de la persistance de la marginalisation malgré l’intégration physique. Du côté de la personne employée, s’expriment à la fois le sentiment de ne pas être reconnue comme égale et, implicitement, la crainte d’un retour en atelier protégé. Les connaissances et questions fondamentales soulevées dans cet ouvrage permettront aussi bien au corps enseignant, aux travailleuses et travailleurs sociaux qu’aux pédagogues de mieux comprendre l’horizon qui peut se dessiner pour les personnes dont elles partagent le quotidien. (Éditions SZH/CSPS)

- Myriam Winance
- Les approches sociales du handicap : une recherche politique
- Presses des Mines, Paris, 2024
Qu’est-ce que le handicap ? Quelle différence fait-il ? La question paraît simple, pourtant, elle fait, depuis 40 ans, l’objet de débats. Ceux-ci ont été initiés par les chercheurs des Disability Studies, qui ont développé le « modèle social du handicap » ; puis, ils ont été prolongés par la sociologie de la technique, l’éthique du « care » et les théories validistes. Cet ouvrage présente ces approches, et les renouvelle. Il montre que la manière dont chacune a socialisé le handicap est liée à des hypothèses théoriques sur ce qui fait différence et normalité. La question du handicap ouvre alors sur plusieurs questions : celle des in/capacités, celle de l’a/normalité et celle des qualités qui singularisent chaque personne. La dimension politique de ces approches est ensuite interrogée, d’une part à travers l’histoire de la structuration de la recherche sur le handicap au Royaume-Uni et en France, d’autre part, en décrivant les différents positionnements possibles du chercheur. Le lecteur trouvera, dans cet ouvrage, les ressources théoriques et méthodologiques lui permettant d’appréhender les approches sociales du handicap, et de conduire et de situer sa propre recherche sur le handicap. (Presses des Mines)

- Sous la direction de Christine da Silva-Genest et Caroline Masson
- Langage et communication dans les troubles du spectre de l’autisme : de l’évaluation à l’intervention
- Éditions de l’Université de Lorraine, Nancy, 2024
Cet ouvrage réunit chercheurs et professionnels pour explorer les spécificités linguistiques et communicationnelles des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Les perturbations de la communication et du langage constituent des critères d’identification importants des TSA. Ainsi, l’absence ou le retard de mise en place du langage, comme la présence de particularités langagières au cours des premières années, constituent souvent le motif de la première consultation des parents. Ensuite, la phase d’évaluation orthophonique et de diagnostic des TSA repose sur des outils et des critères d’évaluation de compétences qu’il convient d’interroger, au regard de la diversité des profils des sujets. Enfin, l’ouvrage aborde les récents protocoles d’intervention directe expérimentés par les professionnels de santé tels que les orthophonistes (outils de communication alternative, plateformes numériques innovantes…). Au-delà des professionnels de santé, les professionnels de l’éducation et de la petite enfance trouveront dans cet ouvrage des ressources utiles pour la compréhension et l’accompagnement des personnes avec autisme. (Éditions de l’Université de Lorraine)

- Michèle Arcand et Brissette Lorraine
- Accompagner sans s’épuiser : guide à l’intention des professionnels de la relation d’aide
- Erès, Toulouse, 2024
Comment les travailleurs sociaux et les soignants en arrivent-ils à s’épuiser ? Cet ouvrage donne des pistes de réflexion et d’action pour les aider à protéger leur santé. Les autrices abordent la question de l’épuisement en incluant une perspective contextuelle qui évite de limiter le problème à la responsabilité de chaque individu. Contrairement à la croyance populaire, l’épuisement professionnel ne peut pas être ramené à un simple problème de surmenage. La réalité est beaucoup plus complexe. Une forme de démoralisation est sous-jacente au manque d’énergie constaté. Elle est causée par un écart trop grand entre l’effort fourni et la satisfaction qui en résulte. Cette discordance, qui s’est accrue avec la généralisation de la nouvelle gestion publique, revêt des couleurs diverses : conflits de valeurs, désillusion, dévalorisation, sentiment d’injustice ou d’inefficacité, etc. Les autrices ont placé la réflexion fondamentale sur le sens du travail au début de la démarche de prévention de l’épuisement, dénonçant au passage les distorsions qui mènent à la poursuite d’objectifs irréalisables, ou encore dommageables à l’équilibre personnel. Avec un grand nombre d’exemples concrets, d’images fortes et d’exercices, elles invitent les professionnels à faire des choix et à opérer des changements avant d’en arriver à s’épuiser dans la relation d’aide. (Erès)
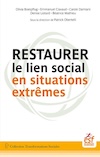
- Sous la direction de Patrick Obertelli
- Restaurer le lien social en situations extrêmes
- ESF Editeur, Paris, 2024
Cet ouvrage explore les ressorts essentiels pour soutenir ou restaurer le lien social dans des situations particulièrement critiques, qu’il s’agisse du vécu d’une catastrophe ou d’un parcours en fin de vie. Face à de telles épreuves, la question est de savoir comment aider les personnes à faire ou à refaire société, à retrouver leur place dans la communauté humaine quand le lien social est profondément altéré, que le sentiment d’identité est fragilisé à l’extrême. Pour y répondre, les auteurs tous experts reconnus, s’appuient sur des cas concrets auxquels ils ont dû faire face.
Donner des repères pour pouvoir se questionner, penser, agir, telle est l’ambition de cet ouvrage de façon à éviter les conduites de ruptures sociales que les dysfonctionnements de nos sociétés ont tendance à favoriser.
On l’aura compris, ce livre s’inscrit dans une éthique de l’humain et de restauration du lien social. (ESF Éditeur)

- Mélanie Kerloc'h et Léa Renard
- Je ne suis pas venu ici pour manger des sandwichs : mineurs non accompagnés : cas cliniques dessinés
- Erès, Toulouse, 2024
« Mélanie Kerloc'h, psychologue clinicienne, et Léa Renard, dessinatrice, nous invitent à prendre part avec elles à une expérience saisissante : partager des séquences de psychothérapies dessinées menées auprès d’un public singulier, celui des mineurs non accompagnés en recours. Ces jeunes nés à l’étranger sont venus seuls en France avec le plus souvent des papiers attestant de leur minorité, mais celle-ci pas été reconnue par notre pays, les plongeant dans un trou noir, ils ne sont ni mineurs ni majeurs et ne disposent des droits d’aucune de ces deux catégories : ni protégés, ni expulsables. Peut-on imaginer une situation plus pathogène pour des jeunes dont le parcours est émaillé de violences subies — parfois au pays, toujours pendant le voyage, souvent en France —, de deuils, de séparations ? En tant que société, nous avons le devoir éthique de mieux traiter ces invisibles et je ne doute pas que cet ouvrage y contribue. » Thierry Baubet Aboubacar, Noor, Tahirou, Seïba viennent du Mali, de Guinée ou d’Afghanistan... Ils parlent français, soninké, bambara, dari... Dans les séances de psychothérapie menées souvent avec l’aide d’interprètes, ils tentent de dénouer les nœuds de leurs histoires singulières. (Erès)
 Gwénaëlle Persiaux et Yoanna Micoud
Gwénaëlle Persiaux et Yoanna Micoud- Les liens d’attachement : de l’enfance à l’âge adulte, comprendre comment se construisent des liens forts et sécurisants
- Eyrolles, Paris, 2024
Développer des relations proches et fortes avec d’autres personnes fait partie de nos besoins profonds d’êtres humains dès notre naissance. C’est ce que l’on appelle l’attachement. Connaître cet instinct et son fonctionnement permet de mieux se comprendre soi-même et de mieux comprendre les autres. Construits dès l’enfance à travers les interactions avec nos figures parentales, les différents « styles d’attachement » (sécure, anxieux, évitant et désorganisé) ont un impact sur tous les aspects de notre vie d’adulte : l’estime de soi, la santé, le couple, l’amitié, le travail, la parentalité... Mais, bonne nouvelle : à tout âge de la vie, il est temps de nouer des liens apaisés ! Soutenu par des saynètes tendres et drôles, ce livre 100% illustré vous permettra de comprendre les mécanismes de construction de l’attachement et les blessures qui peuvent en résulter. Il vous aidera à décrypter votre fonctionnement affectif et émotionnel et à vivre avec plus de justesse et d’épanouissement toutes vos relations. (Eyrolles)

- Sous la direction de Alexandre Heeren
- Eco-anxiété, changement climatique et santé mentale : enjeux cliniques et thérapeutiques
- De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve, 2024
Face aux problématiques de santé mentale liées à la crise écologique, ce livre offre aux professionnels, quels que soient leur milieu d’intervention et la nature de leur profession, un tour d’horizon des connaissances théoriques et des enjeux cliniques propres à ces défis. Une série d’intervenants, d’horizons géographiques et professionnels larges et variés, ont choisi de partager leur expertise. Ils abordent : l’impact du changement climatique sur la santé mentale ; les recommandations de prévention et d’intervention tant individuelle que communautaire auprès de populations à risque ; les interventions sur et par les (éco-)émotions ; des pistes de prise en charge de personnes souffrant d’éco-anxiété invalidante ; le rôle des contextes familiaux, locaux, culturels et historiques dans ces interventions ; les apports des interventions en lien avec le vivant. (4e de couverture)
Bibliothèque de la Haute Ecole de travail social Fribourg
(photo: HETS-FR – © Beni Basler)
Les annonces du réseau
L'affiche de la semaine
 Bureaux partagés en sous-location à Lausanne-centre, dans un environnement propice aux échanges et aux synergies, notamment avec des associations axées sur la famille. (image : © Freepik)
Bureaux partagés en sous-location à Lausanne-centre, dans un environnement propice aux échanges et aux synergies, notamment avec des associations axées sur la famille. (image : © Freepik)

