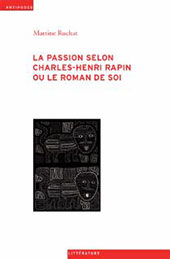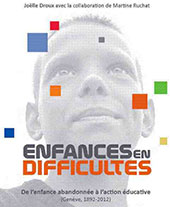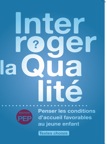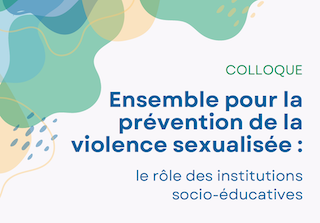Pour réunir les savoirs
et les expériences en Suisse romande
S'abonner à REISO
La liste des parutions
-
La recherche montre clairement que les femmes et les hommes présentent des particularités sexospécifiques. Le type d’addiction, son origine et son développement diffèrent en effet d’un sexe à l’autre. La recherche relève aussi que la prise en charge et le traitement ont plus de succès si le genre est pris en compte de manière adéquate.
Au sommaire : analyse de la socialisation des femmes et des hommes et du lien avec les dépendances ; manière d’approcher les femmes et les hommes lors d’une prise en charge ; conditions-cadres pour une prise en charge basée sur une approche intégrée de l’égalité ; littérature et liens.
Le guide en format pdf
-
Brochure
« Transition école – métier. La pédagogie spécialisée au service du marché ? ». Les conférenciers du colloque ont parlé de leurs expériences selon des perspectives et des domaines d’activité différents.
Ainsi par exemple, le Professeur Kurt Häfeli, responsable du domaine recherche & développement à la Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée de Zurich, a indiqué les mesures et étapes nécessaires pour réussir le passage de l’école vers la formation professionnelle.
La parole a en outre été donnée à des institutions de pédagogie spécialisée, des employeurs, un office AI et des instances cantonales. Les exposés du colloque sont à présent disponibles sous forme d’une brochure digitale qui vient de paraître.
La brochure en format pdf
-
La plate-forme de placement extrafamilial 2012 d’Integras était consacrée à la thématique "Placement extrafamilial : ultima ratio – Qu’imposons-nous aux enfants et adolescents ?".
Les intervenants ont cherché des réponses selon le point de vue des institutions de placement et d’accueil ainsi que de celui des enfants et des jeunes concernés.
Les exposés, entre autres celui du Prof. Klaus Wolf au sujet du vécu biographique d’enfants et d’adolescents en placement extrafamilial, viennent d’être publiés sous forme d’une brochure disponible en téléchargement.
La brochure en format pdf
-
Dossier spécialisé
L’addiction est un phénomène qui résulte de l’interaction de multiples facteurs. La recherche de solutions implique la concertation de plusieurs domaines complémentaires : le social, la santé, l’éducation et la sécurité. Dans cette perspective multifactorielle et interdisciplinaire, la sortie de la dépendance ne concerne pas seulement l’affranchissement de pratiques de consommation, mais aussi l’éloignement de situations de vie problématiques. Une « convergence adaptative » se dessine ainsi entre les approches médicale et sociale et les acteurs ambulatoire et résidentiel posant la question de leur articulation.
C’est à cette question que l’Observatoire de la Ville et du Développement durable de l’Institut de Géographie de l’Université de Lausanne contribue à répondre dans une étude évaluative sur les institutions romandes. Le présent dossier reprend et met en perspective les principaux enjeux que cette étude a pu mettre en évidence.
Dossier préparé par Pascal Roduit, responsable de projet CRIAD (Coordination romande des institutions et organisations œuvrant dans le domaine des addictions)
Télécharger le dossier en format pdf
-
Parution à l’occasion de la journée mondiale 2012 contre l’homophobie et la transphobie. Chaque partie du Livre Vert est constituée de préfaces émanant d’intellectuel-les, de représentants associatifs, de citoyen-nes du monde spécialisé-es dans la lutte contre ces doubles discriminations particulières ; d’une partie théorique, afin de vulgariser la problématique des LGBTphobies de certaines autorités religieuses ; enfin, d’une partie témoignages émanant de LGBT de France, d’Europe et cette année du monde entier.
Lire aussi l’article de Ludovic-Mohamed Zahed « Non, l’islam n’est pas homophobe par essence » sur REISO.
Disponible en ligne
-
Rapport commun de l’Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers (ODAE romand), l’Observatoire suisse du droit d’asile et des étrangers (ODAE-Suisse), ainsi que l’Observatoire du droit d’asile et des étrangers de Suisse orientale (BAAO).
Ce rapport illustre, sur la base de cas réels, l’impact humain des obstacles rencontrés par les migrant-e-s et les Suisse-sse-s eux-mêmes, lorsqu’ils souhaitent faire venir en Suisse les membres étrangers de leur famille. Les cas documentés par les Observatoires font état d’inégalités et de difficultés majeures dans l’accès au regroupement familial. Alors que certaines d’entre elles découlent directement de la loi, d’autres s’inscrivent dans une application particulièrement restrictive, voire abusive du droit existant.
Le rapport en format pdf
-

- Couverture
C’est à une magnifique démarche participative que nous convie l’ethnologue. Elle permet de découvrir la vie quotidienne en communauté des jeunes du foyer, leur perception du monde à travers des photos déroutantes et le symbolisme de certains objets. Le plus prestigieux d’entre eux ? La casquette, mais pas n’importe laquelle…
Denise Wenger a partagé pendant trois mois le quotidien des résident-e-s du foyer, les accompagnant jour après jour dans leurs activités : classe, repas, atelier de mécanique de précision, loisirs, camps, etc.
Quel rôle un internat d’éducation joue-t-il dans la société d’aujourd’hui ? Les adolescent-e-s placé-e-s en institution trouvent-ils-elles dans leur lieu d’accueil un endroit approprié pour quitter l’enfance et entrer dans l’âge adulte ? Un foyer d’éducation spécialisée peut-il être considéré comme une alternative positive à la vie de famille ? Joue-t-il un rôle dans la société ou n’est-il là que pour « corriger » des jeunes placés par un juge des mineurs ou un service social ?
A l’occasion de son 40e anniversaire, la Fondation J. & M. Sandoz, Foyer-atelier pour adolescent-e-s, a souhaité repenser quelques fondamentaux sur l’internat éducatif, non pas en approfondissant la question des problèmes psychologiques ou comportementaux des jeunes en difficulté, mais en s’interrogeant elle-même, en tant que lieu de vie, en tant qu’élément d’une société. L’ethnologie, qui prend pour objet d’étude le fonctionnement des sociétés humaines d’ici et d’ailleurs au travers de méthodes qualitatives mettant notamment en œuvre l’« observation participante » de petits groupes sociaux pour les comprendre de l’intérieur, semblait donc bien placée pour répondre aux questions soulevées.
Voir l’album photo sur REISO.
-
La crise économique des années 1930 s’accompagne d’une véritable offensive contre l’activité professionnelle féminine dans les services publics.
Dans l’ensemble des pays industrialisés, le travail des femmes fonctionnaires devient un enjeu économique, politique, social, familial et moral. La généralisation du chômage suscite d’âpres discussions sur la répartition des postes de travail et les femmes fonctionnaires endossent le rôle de bouc émissaire. Les gouvernements et les autorités publiques des pays industrialisés plébiscitent, selon des modalités diverses, la "solution" d’une réglementation restrictive du travail des salariées des services publics.
Ce livre traite d’un épisode méconnu de l’histoire de la "ségrégation ordinaire" entre les sexes dans le monde du travail. Il montre que les nouvelles distinctions entre "travail masculin" et "travail féminin", intervenues dans les emplois publics durant les années 1930, ne reflètent pas des faits naturels mais qu’elles constituent l’aboutissement d’un long processus de différenciation engageant une multitude d’actrices et d’acteurs sociaux.
L’ouvrage propose une analyse croisée de l’offensive contre l’activité des salariées de la fonction publique en Suisse et en France, en y intégrant la dimension internationale de la campagne contre l’emploi féminin.
Cette approche permet de revisiter l’histoire politique, sociale, culturelle, économique et financière de cette période sous l’angle du genre et de renouveler un cadre d’analyse en histoire du travail et des féminismes.
Editions Antipodes
-
Livre
« Dans cet essai pertinent, Mary Anna Barbey retrace l’histoire du planning familial en Suisse romande, de l’émergence de la formation de conseillère en planning familial à la création de l’actuelle SANTÉ SEXUELLE Suisse. En passant par l’adoption, en 1981, de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse. Au-delà des aspects institutionnels, l’auteure soulève les ambivalences de ce qui est, au final, une "question de vie et de mort ". Par exemple, l’imbrication de la nécessité rationnelle de "planifier" la reproduction avec la part "familiale", relationnelle, émotionnelle qui, parfois, y résiste. » Préface de Liliane Maury Pasquier
Au moment où le droit des femmes de décider librement de leur fertilité est une nouvelle fois remis en question, en Suisse et dans plusieurs pays d’Europe, l’ouvrage de Mary Anna Barbey vient à point nommé rappeler que, « malgré toutes les banalisations qu’en propose la société actuelle, la sexualité aura toujours un caractère subversif ».
Commande en ligne
-
« Elle se demande où tu puises tant d’énergie pour toujours t’en aller ’chanter’ selon l’expression d’un de tes amis ? D’où vient cette envie de porter sans cesse la ’bonne nouvelle’, enseigner, t’adresser à un public que tu cherches à convaincre, à charmer aussi, être en représentation. Devant le constat de tant d’appétence à t’approcher des gens, elle se trouve soudainement taciturne, sauvage et solitaire à aligner des mots sur son ordinateur, seule dans sa chambre d’un hôtel parisien. Mais avec toi, elle a pris goût aux inventaires. Elle fait la liste des congrès où tu es invité, elle compte tes conférences données, tes articles publiés, tes prix reçus comme autant d’indicateurs de ta générosité. Avec toi, elle n’en finit pas de faire le tour de la terre. »
La passion selon Charles-Henri Rapin ou le roman de soi est une biographie du gériatre Charles-Henri Rapin (1947-2007), effectuée à partir d’entretiens biographiques. Sa personnalité charismatique permet à l’auteure de mener une réflexion sur le moteur d’une passion pour le développement des soins palliatifs et la réduction de la douleur, l’amélioration des conditions de vie des personnes âgées et de la justice sociale.
La biographie de Charles-Henri Rapin se double d’une fiction qui questionne le travail biographique, exercice périlleux où la biographe court toujours le risque de se perdre entre la réalité et la fiction, entre la personne et son personnage, entre la mémoire et l’histoire.
-
La Suisse de 1939 à 1945 se caractérise par une relative tolérance envers l’homosexualité. Depuis 1942, le Code pénal suisse dépénalise les relations entre adultes consentant·e·s dans l’ensemble de la Confédération. Zurich accueille la seule association homosexuelle existant au monde durant ces années.
Cette image d’Épinal a longtemps rendu invisibles les vécus quotidiens de l’homosexualité. Cet ouvrage offre un regard inédit en se fondant sur des sources jusqu’alors inexplorées provenant de la justice militaire. Le Code pénal militaire punit en effet les relations sexuelles entre hommes depuis 1928, et la mobilisation générale amène à un paroxysme permettant de dévoiler un ordinaire habituellement masqué. Quelque 120 affaires sont instruites par la justice militaire avec le concours des polices militaires et civiles, des autorités communales et, parfois, du Service sanitaire de l’armée ou de médecins civils. Ces affaires permettent de mettre en évidence, au-delà de l’interdiction de l’homosexualité au sein de la troupe, une marge de liberté dans les grandes villes, mais aussi la surveillance policière et un opprobre social tenace.
La relative tolérance envers l’homosexualité s’inscrit comme un compromis entre un progressisme et un conservatisme politique, juridique, voire médical, qui diffère selon les régions du pays ou l’origine sociale des prévenus.
-
Livre
Dans cet ouvrage, Laurent Cambon (ancien éducateur spécialisé, aujourd’hui directeur d’un centre de placement familial) évoque les plaisirs et les frustrations de ce métier, sur la base de nombreux témoignages de professionnels. Il s’agit de comprendre ce qu’est "être" éducateur spécialisé aujourd’hui : la vie quotidienne, les rapports humains, le diplôme délivré, les contraintes sociales et politiques…
Cet ouvrage est destiné aux jeunes qui réfléchissent à leur orientation, aux professionnels qui s’interrogent sur leur secteur, aux formateurs qui souhaitent approfondir leurs connaissances du métiers et des pratiques, mais aussi à tous ceux qui sont interpellés par le métier d’éducateur spécialisé.
La collection Être sur les métiers est destinée notamment à l’orientation ou réorientation des jeunes et adultes, et est soutenue par l’ONISEP, la région Rhône Alpes et le ministère de la Culture.
Deux autres titres de cette collection sont intéressants pour le domaine du travail social : "Être aide soignant" et "Être éducateur de jeunes enfants".
-
Livre
Alain Bihr est professeur émérite de sociologie à l’Université de Franche-Comté. Il a notamment publié « La reproduction du capital » (2001), « La préhistoire du capital » (2006), « La novlangue néolibérale » (2007) et « La logique méconnue du “Capital” » (2010), aux Editions Page deux, ainsi que, avec Roland Pfefferkorn, « Le système des inégalités », La Découverte, 2008.
Cet ouvrage s’adresse à ceux et celles qui suspectent les discours cherchant à faire croire que les sociétés contemporaines évolueraient vers la constitution d’une « classe moyenne » englobant l’immense majorité de leur population. Des discours qui tiennent pour négligeable le creusement continu, manifeste et accablant des inégalités sociales, qui masquent que ce sont là les effets des « lois du marché » et aussi de politiques délibérées mises en œuvre par les dirigeants des groupes industriels et financiers ainsi que par les gouvernants qui en défendent les intérêts.
L’ouvrage s’adresse donc à ceux et celles qui sentent confusément que nos sociétés restent divisées en classes sociales aux intérêts divergents et même contradictoires, qu’elles sont ainsi le champ d’une intense mais sourde lutte des classes. A ceux et celles qui désirent clarifier et conforter ces intuitions en faisant appel aux notions de classes, de luttes de classes, d’alliances de classes, etc.
A cette fin, l’auteur propose une grille d’analyse marxiste des rapports sociaux de classes qui n’exclut ni des emprunts à des auteurs non marxistes, ni des écarts par rapport à une certaine orthodoxie marxiste. Il vise ainsi à aiguiser la compréhension des enjeux des résistances à la domination et des luttes émancipatrices.
-
La question du placement d’enfants est depuis plus d’une décennie au cœur de l’actualité suisse.
Afin d’éclairer cette page de notre histoire, la Fondation officielle de la jeunesse a souhaité, à l’occasion des 120 années d’expériences dont elle est l’héritière, se pencher sur son passé. Basé sur les archives des services de protection de l’enfance et des institutions d’éducation spécialisées, cet ouvrage abondamment illustré restitue l’évolution du mouvement genevois de protection de l’enfance depuis son émergence en 1892.
Une contribution originale à la réflexion que nos sociétés sont appelées à élaborer sur leur rapport à la jeunesse, tout particulièrement à celle confrontée, hier comme aujourd’hui, au besoin d’accueil et à la nécessité du placement.
- Prix : 25 fr. + frais d’envoi
- Commandes par courriel à ou par courrier postal à FOJ - 20 chemin de la Paumière - 1231 Conches -
Revue spécialisée
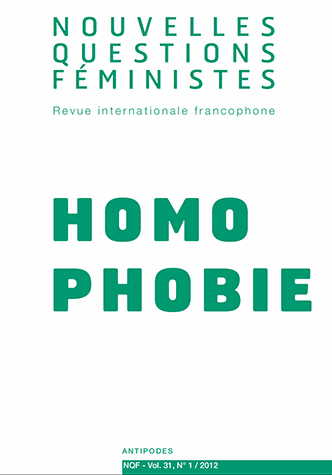 L’« homophobie » désigne couramment le rejet et les discriminations vécues par les personnes homosexuelles ou supposées telles. C’est une notion largement utilisée aujourd’hui dans le langage politique et médiatique mais aussi au sein des recherches en sciences sociales portant sur les minorités sexuelles.
L’« homophobie » désigne couramment le rejet et les discriminations vécues par les personnes homosexuelles ou supposées telles. C’est une notion largement utilisée aujourd’hui dans le langage politique et médiatique mais aussi au sein des recherches en sciences sociales portant sur les minorités sexuelles.Le point de départ de ce numéro de Nouvelles Questions Féministes a été une envie et une nécessité de réfléchir à la portée et aux limites de cette notion d’homophobie, en particulier dans son articulation avec une perspective féministe.
Dans ce but, le numéro propose un ensemble d’articles qui, en se basant sur des recherches empiriques, viennent alimenter ce questionnement. Quelles sont les discriminations vécues par les lesbiennes, sont-elles similaires à celles que vivent les gays et surtout, comment rendre compte de ce qui les produit et les structure ? Les luttes juridiques, matérialisées en Espagne et en Belgique, par exemple, par l’ouverture du mariage aux couples homosexuels, permettent-elles d’éradiquer l’homophobie du droit, de construire une réelle égalité entre couples homos et hétéros ? Comment rendre compte des points communs entre les discriminations et les contraintes vécues par les personnes transsexuel·le·s dans leur parcours imposé pour mettre en conformité leur sexe biologique et leur état civil et celles vécues par les gays, bis et lesbiennes ?
Les thèmes abordés par les articles illustrent ainsi de manière empirique les discriminations que vivent diverses minorités sexuelles et, en même temps, démontrent la complexité des structures qui façonnent ces discriminations, complexité dont la notion d’homophobie à elle seule échoue à rendre compte. Ils invitent donc à réfléchir à l’articulation de la hiérarchie des sexualités, qui sous-tend la norme hétérosexuelle, avec la hiérarchie des sexes et les normes qu’elle produit. Une telle réflexion, loin d’être uniquement théorique, invite également au questionnement quant aux stratégies politiques à mettre en œuvre sur le terrain par les mouvements et associations de défense des personnes LGBTIQ.
-
Un guide pour répondre aux questions que se posent les parents d’enfants avec handicap
Avec « Les droits de mon enfant », Procap Suisse a pour objectif de faciliter les démarches liées notamment aux mesures médicales, scolaires ou professionnelles.
Le guide aborde également la question du droit à des aides et les procédures liées à l’Assurance invalidité ou aux allocations pour impotent, afin d’épauler les parents d’enfants avec handicap dans leurs démarches. Il donne des explications aisément compréhensibles sur l’acquisition de moyens auxiliaires, les aspects à prendre en compte lors du passage à l’âge adulte, les dispositions concernant la caisse de pension, les assurances maladie ou accident.
- Ce livre peut être commandé au 032 323 82 94 ou par courriel à . 34 francs (29 francs pour les membres de Procap)
-
Les maladies psychiques font partie des troubles de la santé les plus fréquents et les plus handicapants. Elles ont des incidences sur tous les aspects de la vie des personnes touchées et peuvent être très invalidantes. Le rapport de monitorage de l’Observatoire suisse de la santé (Obsan) sur la santé psychique de la population suisse paraît en 2012 pour la troisième fois. Il rend compte de l’état présent et de l’évolution de la santé psychique en Suisse au cours des dix dernières années.
Le rapport montre que la santé psychique de la population suisse ne s’est pas détériorée au cours des dernières années et que la situation dans ce domaine est globalement stable. Ce constat infirme l’idée assez répandue selon laquelle les maladies psychiques gagneraient du terrain.
Trois personnes sur quatre, en Suisse, disent se sentir souvent ou très souvent pleines de force, d’énergie et d’optimisme. Mais le monitorage montre aussi que les troubles psychiques restent très répandus en Suisse. Ainsi, plus de 4% de la population souffrent de problèmes psychiques importants et 13% environ des problèmes moyens. Il est vraisemblable que ces 17% de la population – une personne sur six – présentent, du point de vue clinique, des troubles psychiques.
Différences selon les régions
Si les troubles psychiques touchent plus fréquemment les femmes et les jeunes que les hommes et les personnes âgées, la situation est plus contrastée pour ce qui est de la dépression : les symptômes de dépression légère touchent plus fréquemment les personnes âgées et les femmes. La part des personnes touchées est supérieure à la moyenne au Tessin et dans la région lémanique ; elle est inférieure à la moyenne en Suisse centrale.
Recours aux soins
Le nombre de personnes qui selon le rapport se font traiter pour des troubles psychiques reste faible au regard de la fréquence de ces troubles. Il a augmenté de un pour cent en dix ans – passant de 4% en 1997 à 5% en 2007.
En 2009, on a enregistré en Suisse, 78’000 séjours hospitaliers avec diagnostic principal psychiatrique. Cela correspond à 12 hospitalisations pour 1000 habitants. Les hommes sont traités le plus souvent pour des troubles liés à l’alcool ; chez les femmes, c’est la dépression qui occupe le premier rang.
L’étude en ligne
-
Etudes
Expertises médicales dans l’AI
L’assurance-invalidité a mis en place, le 1er mars 2012, un nouveau système d’attribution des expertises médicales pluridisciplinaires, tout en soumettant les centres d’expertises à des exigences de qualité plus élevées et en fixant des mesures de contrôle. Dans le même temps, elle a renforcé les droits de participation des assurés dans la procédure d’expertise. L’AI répond ainsi aux exigences posées par le Tribunal fédéral dans un arrêt de juin 2011, qui avait été précédé par un avis de droit et par une initiative parlementaire réclamant des « expertises et procès équitables ».
L’étude à télécharger en ligne
-
Envisager le corps dans son aspect purement physique demeure réducteur et conduit à l’occultation de l’âge. Le corps pour soi (la manière dont la personne se perçoit) et le corps pour les autres (livré aux regards des autres et image renvoyée par autrui) sont ici convoqués pour tenter de comprendre les mécanismes de (re)construction identitaire au cours du vieillissement.
L’auteur développe la notion d’équilibre identitaire comme point dynamique au centre des différentes tensions exercées alternativement ou conjointement sur le corps biologique, la perception de son image et l’image de soi renvoyée par le regard des autres. Elle croise plusieurs modèles théoriques issus de la phénoménologie, de la sociologie et de la psychanalyse en s’intéressant aux représentations sociales et culturelles de la vieillesse (diffusées par exemple dans les médias) et à l’expérience corporelle individuelle du vieillissement, notamment à travers l’analyse de la place des activités physiques et sportives.
Raymonde Feillet est docteur en sciences de l’éducation, maître de conférences à l’université Rennes 2, membre du Laboratoire vip’s (violences, intégration, politiques et sports).
-
Cette étude a été menée auprès de 6700 élèves de 9e année ainsi que de 324 institutions du domaine de la protection de l’enfance.
Le rapport final met en évidence que les abus sur les enfants sont principalement le fait de proches mais également le nombre important d’abus entre pairs à l’adolescence ainsi que le lien entre le niveau de violence générale à l’intérieur de la famille ou du groupe et le risque d’abus sexuels.
Parmi les auteur-e-s :
- Pasqualina Perig-Chiello, psychologue spécialisée en psychologie du développement et professeur honoraire, Université de Berne
- Christoph Häfeli, juriste, assistant social et spécialiste de la protection de l’enfance par le droit civil, expert du nouveau droit de protection de l’enfant et de l’adulte qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013.L’étude en format pdf
-
Avec des textes de Paola Biancardi, Raymonde Caffari-Viallon, Roger Cevey, Carol Gachet, Fabienne Guinchard Hayward, Caroline Hildenbrand-Doerig, Marie Léonard-Mallaval, Patrick Mauvais, Véronique Montfort, Maurice Nanchen, Enzo Negro, Christine Schuhl.
Au cours des différentes rencontres organisées depuis la création du service d’appui pédagogique et logistique PEP (Petite Enfance Pool - Partenaire Enfance & Pédagogie) et grâce aux textes publiés au travers des bulletins PEP, différents morceaux de choix ont été récoltés. Ils décrivent la qualité de l’accueil sous l’angle des besoins de l’enfant et nous les avons rassemblés pour les partager avec celles et ceux qui, chaque jour, œuvrent en faveur de la qualité d’accueil.
Cette publication est donc un recueil de textes qui s’insèrent dans un outil construit par les conseillères pédagogiques pour interroger le processus ajustant la qualité de l’accueil aux besoins des enfants.
Au travers de ces regards croisés sur la réalité plurielle que constitue l’accueil des jeunes enfants, nous espérons susciter des réflexions utiles aux équipes dans leur souci permanent d’offrir à chaque enfant des conditions d’accueil de qualité.
Commander cet ouvrage par tél. au 021 617 04 00 ou par courriel à . Prix : 20 francs.
-
 Les fondateurs de l’approche Humanitude, Rosette Marescotti et Yves Gineste mettent pour la première fois leur trente années d’expérience professionnelle au service du grand public. Dans un langage concret, illustré de courtes séquences filmées en situation réelle, à domicile, dans des hôpitaux ou des maisons de retraite, Rosette Marescotti et Yves Gineste proposent des solutions qui donneront du sens au quotidien des aidants.
Les fondateurs de l’approche Humanitude, Rosette Marescotti et Yves Gineste mettent pour la première fois leur trente années d’expérience professionnelle au service du grand public. Dans un langage concret, illustré de courtes séquences filmées en situation réelle, à domicile, dans des hôpitaux ou des maisons de retraite, Rosette Marescotti et Yves Gineste proposent des solutions qui donneront du sens au quotidien des aidants.Quelques exemples
- Il ne mange plus ? Peut-être ne reconnaît-il plus les couverts : présentez la nourriture sous forme de toasts que l’on peut saisir à la main.
- Elle refuse violemment une promenade ? Mettez vous face à elle, captez son regard, souriez tout en caressant sa main, puis proposez tranquillement de faire quelques pas. Neuf fois sur dix, elle se lèvera pour vous suivre.
- Il vous demande l’heure pour la centième fois ? Dérivez son attention vers un sujet qui lui plaît. Ce n’est pas de la manipulation, juste une façon de calmer l’angoisse qui monte.
En une heure, vous apprendrez à observer et décoder un comportement en apparence opaque. L’Humanitude vous apporte des outils pour mettre au point vos propres solutions et retrouver des relations plus sereines. Les témoignages d’aidants vous montreront que vous n’êtes pas seul(e) et que des réponses existent.
En bonus, des avis d’experts viennent étayer, compléter, renforcer les messages. Des spécialistes présentent les différents réseaux d’aides en France. Des témoignages d’aidants viennent renforcer ce message d’espoir : l’Humanitude ne guérit certes pas la maladie mais elle donne des clés pour vivre et vieillir debout, sereinement, jusqu’au bout.
Bande annonce en ligne
-
La planification médico-sociale pour les personnes âgées est un élément essentiel de l’organisation du système de santé neuchâtelois. En effet, l’augmentation de la durée de vie et le vieillissement de la population, amplifiés par l’arrivée prochaine en âge AVS des cohortes de population du "baby-boom", placent la question de la prise en charge de personnes du 3ème et du 4ème âge au premier plan.
La planification médico-sociale pour les personnes âgées dans le canton de Neuchâtel est un projet qui a demandé une longue maturation et un travail d’analyse très poussé. Le Conseil d’Etat a mené ses premières réflexions en 2006 déjà, s’adjoignant les compétences et l’expertise de la Haute Ecole Arc Santé pour réaliser les aspects techniques du projet. Si la plupart des mesures proposées s’inscrivent dans le contexte légal actuel, des articles modifiant la loi de santé sont toutefois proposés afin de combler les lacunes de la législation actuelle et permettre la mise en œuvre de la planification. Le Conseil d’Etat propose par ailleurs au Grand Conseil de classer plusieurs motions et postulats qui ont trouvé réponse dans le rapport qu’il lui soumettra.
Le projet en format pdf
-
Les conclusions de cette récente étude d’Addiction Suisse apportent de nouveaux éléments de réflexion sur les variables qui influencent la consommation d’alcool chez les mères de famille. Elles suggèrent que l’investissement d’un pays dans des mesures de promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes permet de réduire le niveau de consommation d’alcool des mères.
Selon les études classiques en effet, plus une femme à de rôles sociaux, avec un partenaire, des enfants, une activité professionnelle extérieure, et moins elle a de risque de boire. Cette corrélation ne fonctionne pourtant pas toujours. En Suisse par exemple, les mères en couple avec un emploi ont des niveaux légèrement plus élevés de consommation d’alcool que celles qui n’ont pas d’emploi.
En comparant la situation dans quinze pays, l’étude montre que dans les pays où il y a moins de mesures incitatives pour encourager le travail des mères, l’effet protecteur de la combinaison travail/maternité est plus faible concernant la consommation d’alcool.
Etude présentée en ligne
-
Sur près de 90 pages, cette brochure fournit de nombreuses informations pratiques destinées à faciliter la vie quotidienne des nouveaux arrivants. Elle fournit des adresses utiles et aborde divers domaines, notamment les questions liées à l’autorisation de séjour, la santé, l’école, le travail, le logement, les cours de langues, les espaces de rencontre.
Des améliorations ont été apportées pour accroître la clarté du document. Les informations concernant les cours de français sont désormais disposées dans un tableau simplifié. De plus, de nouvelles rubriques et des informations complémentaires ont été ajoutées.
Cette 6e version est actuellement disponible en français. Elle sera traduite en cours d’année. D’ici là, il est toujours possible de commander la 5e édition de la brochure dans une des dix langues traduites.
« Bienvenue dans le canton de Vaud » peut être commandée gratuitement auprès du BCI.
La brochure en ligne