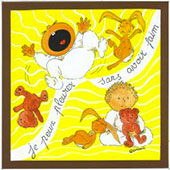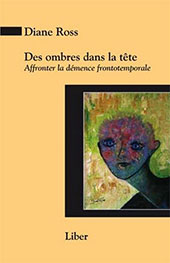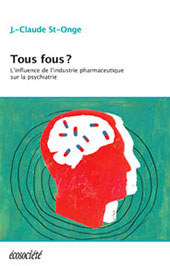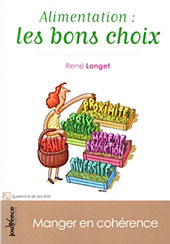Pour réunir les savoirs
et les expériences en Suisse romande
S'abonner à REISO
La liste des parutions
-
 Cette brochure se propose de répondre à quelques-unes des questions que vous pouvez vous poser au moment d’entreprendre une démarche qui n’est pas anodine. En effet, une psychothérapie est un traitement spécifique dont il est important de connaître les possibilités d’application, les buts, les exigences, les résultats.
Cette brochure se propose de répondre à quelques-unes des questions que vous pouvez vous poser au moment d’entreprendre une démarche qui n’est pas anodine. En effet, une psychothérapie est un traitement spécifique dont il est important de connaître les possibilités d’application, les buts, les exigences, les résultats.Il est apparu nécessaire de faire un retour sur un pan essentiel du traitement des affections psychiques, à savoir ces "psychothérapies". Ce guide ne fait par la promotion d’une approche ou d’une autre mais tente de mettre en les mains des personnes toutes les informations nécessaires à se faire elles-mêmes leur opinion.
Evelyne Kolatte est psychiatre, psychothérapeute FMH et membre du comité de Pro Mente Sana.
La brochure en format pdf
-
Le care, c’est à la fois se soucier et prendre soin des autres. Cette activité, au cœur du travail social et sanitaire, est mal reconnue, sans doute parce que la vulnérabilité sociale à laquelle s’adresse le care n’a guère de place dans des sociétés valorisant avant tout le mérite. Les personnes qui effectuent ce travail, des femmes pour l’essentiel, en paient le prix.
Le défi de la reconnaissance du care est dès lors politique, puisque le reconnaître c’est admettre sa nécessité et donner les conditions de son accomplissement adéquat. C’est l’ambition de ce livre qui réunit les contributions stimulantes de spécialistes du care issu·e·s des milieux professionnels et de la recherche.
Cet ouvrage réunit les contributions croisées des auteur-e-s émanant des milieux professionnels de la santé et du travail social, ainsi que de la recherche. Divers éclairages sont ainsi apportés sur la manière de concevoir la solidarité dans nos sociétés en mutation par Natalie Benelli, David Fuehrer, Marie Garrau, Claire-Lise Gerber, Olivier Giraud, Pierre Gobet, Pascale Haldimann, Barbara Lucas, Mascha Madörin et Nicolas Perrin.
-
L’objectif de FriTime est d’offrir un set d’outils qui permette aux communes de proposer des activités extrascolaires sportives, culturelles et artistiques aux enfants et aux jeunes pendant leur temps libre. Ce projet représente une alternative aux rencontres dans les bars, cours d’école, autour des gares ou encore aux arrêts de bus. Il renforce les activités de jeunesse dans les communes fribourgeoises durant la semaine, le week-end, après l’école ou en soirée.
Afin de promouvoir la collaboration entre Etat, communes et sociétés locales, une association à but non lucratif a été créée. Son objectif est d’apporter un soutien durable et organisationnel, au moyen de subventions, aux communes souhaitant mettre en place des activités FriTime. Les communes peuvent donc s’informer auprès du secrétariat de l’association afin de recevoir un guide comprenant différents outils directement utilisables par la commune. En outre, la commune peut bénéficier d’une formation pour la bonne réalisation du projet.
Ce projet est issu de la collaboration entre le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ), le Ser vice de la santé publique (SSP) et le Service du sport (SSpo).
Projet FriTime en format pdf, 56 pages.
-
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) lancent une nouvelle campagne de prévention de l’obésité chez les très jeunes enfants. L’objectif est d’aider les professionnels de la santé et du social à transmettre un discours cohérent, en particulier aux parents.
Le surpoids et l’obésité sont un danger et se manifestent de plus en plus tôt. Entre deux et quatre ans, près d’un enfant sur dix est déjà en excès de poids et 3% des enfants souffrent d’obésité avant l’âge de cinq ans.
Depuis sa création en 2007, ce programme développe une approche thérapeutique et éducative adaptée aux enfants et aux adolescents en surpoids. Sur le plan genevois, le programme de soins Contrepoids a reçu un mandat du Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (DARES) pour organiser et développer la formation des professionnels de la santé en matière d’obésité précoce.
Deux brochures intitulées « Miam la vie », l’une concernant les bébés de 0 à 1 ans, l’autre les enfants de 1 à 4 ans, seront distribuées aux pédiatres, aux maternités et dans tous les lieux d’accueil de la petite enfance. Elles expliquent, illustrations à l’appui, les bons comportements à adopter pour éviter l’obésité.
-
 Les facteurs qui peuvent influencer le salaire et ceux qui ne le doivent pas sont prévus par la loi. Il y a cependant un principe à respecter dans tous les cas : à travail égal ou de valeur égale, les femmes et les hommes dans une entreprise ont droit au même salaire.
Les facteurs qui peuvent influencer le salaire et ceux qui ne le doivent pas sont prévus par la loi. Il y a cependant un principe à respecter dans tous les cas : à travail égal ou de valeur égale, les femmes et les hommes dans une entreprise ont droit au même salaire.Des progrès vers l’égalité ont été réalisés dans diverses branches. L’écart moyen entre les salaires des femmes et des hommes dans le secteur privé se réduit lentement, mais régulièrement. Pourtant, les femmes gagnent encore nettement moins que les hommes.
La présente brochure dresse un bilan de la situation actuelle et met en évidence les progrès réalisés, mais aussi les discriminations qui existent encore. Elle résume les principaux résultats d’une analyse comparative des salaires effectuée sur la base de l’enquête sur la structure des salaires (ESS) et vise à apporter une certaine clarté sur cette question.
La brochure en format pdf
-
Sous la direction du Prof. Reto Stocker de Zurich, ces directives ont été rédigées après environ trois ans de travail. Elles concernent non seulement les situations dans lesquelles les patients se trouvent déjà dans l’unité des soins intensifs, mais également toutes les situations dans lesquelles des mesures de soins intensifs sont adoptées.
Ces directives soulignent que l’évaluation du pronostic fait partie des missions essentielles, mais particulièrement délicates, de la médecine intensive. C’est pourquoi, la sous-commission a jugé nécessaire de définir avec précision les notions clés importantes pour l’indication de soins intensifs telles que « inefficacité », « manque de sens », « qualité de vie » et « dépendance ». Les nouvelles directives accordent une importance majeure aux processus de décision ; en même temps, elles distinguent clairement l’indication de soins intensifs qui relève de la responsabilité du médecin et le droit du patient (ou de la personne habilitée à le représenter) de consentir à un traitement médicalement indiqué ou de le refuser.
Les directives abordent également la question du triage, c’est-à-dire des critères pour l’admission d’un patient dans l’unité des soins intensifs, son transfert dans un autre service ou le renoncement à sa réadmission lorsque son état laisse supposer que des soins intensifs s’avéreront inutiles.
La directive à télécharger en ligne
-
L’utilisation hors étiquette « off-label use » = OLU) de médicaments anticancéreux est fréquente en Suisse et va encore augmenter.
L’étude mandatée par la Ligue suisse contre le cancer et publiée par INFRAS livre pour la première fois des chiffres sur l’ampleur du phénomène en Suisse, estimés à jusqu’à 20 000 traitements OLU par an, soit environ un tiers de tous les cas de cancer. L’absence d’homogénéité dans le remboursement de ces traitements par les assureurs-maladie s’avère problématique. La réglementation actuelle est insatisfaisante et la situation est inéquitable pour de nombreux patients atteints de cancer, car certains se voient privés d’un traitement potentiellement efficace, tandis que ce même traitement est remboursé dans d’autres cas.
L’étude ébauche des solutions sur la manière dont l’OLU pourrait être réduit, l’appréciation du bénéfice thérapeutique standardisée et le remboursement réglementé de manière uniformisée à l’échelle de la Suisse. L’objectif premier est un accès sûr et équitable pour tous aux médicaments anticancéreux.
Résumé de l’étude en format pdf
-
Ce livre raconte le parcours d’une femme qui découvre, au début de la soixantaine, après un parcours professionnel dans l’administration et la politique, qu’elle est atteinte d’une maladie rare de démence frontotemporale. Ce type de maladie constitue un groupe de pathologies neuro-dégénératives caractérisées par des troubles du comportement et du langage associés à une détérioration intellectuelle.
Dès les premiers signes de la maladie, Diane Ross a dû abandonner son travail et fréquenter l’hôpital où on lui a appris à gérer au mieux sa vie quotidienne. Son récit évoque son parcours et sa lucidité devant la maladie, incurable et menant inévitablement à la dégénérescence.
Diane Ross a été adjointe dans divers organismes et institutions publiques au Québec pendant une quarantaine d’années. Elle a notamment été secrétaire de direction à Emploi-Québec, adjointe d’un conseiller politique au cabinet de la ministre d’Etat à l’Emploi et au Travail, adjointe de la ministre d’Etat à la culture et aux Communications et, finalement, adjointe de la leader de l’opposition officielle.
-
doc5205|right>Ce manuel décrit les mesures existantes les plus efficaces pour limiter les problèmes liés aux consommations excessives d’alcool des jeunes. Il s’adresse à l’ensemble des personnes concernées par la thématique : acteurs de terrain, décideurs des politiques publiques, élus, collectivités locales, services de l’état, associations…
Réalisé à partir d’une revue de littérature internationale exhaustive, il a pour ambition de rendre abordables des données scientifiques complexes tout en présentant en encadré des exemples concrets choisis pour leur adéquation avec les recommandations énoncées.
L’Association d’information et de ressources sur les drogues et dépendances et le sida (AIRDDS) est une association régionale qui intervient sur l’ensemble des questions liées à l’addictologie (tabac, alcool et autres drogues) et à la vie affective et sexuelle (santé sexuelle, dépistage, contraception…).
Le Manuel en ligne
-
 Un guide de Parkinson Suisse à recommander
Un guide de Parkinson Suisse à recommanderCet ouvrage est utile pour les personnes atteintes de Parkinson mais aussi pour toutes les autres personnes qui ont des problèmes de déglutitiion. Au sommaire :
- des astuces pour l’alimentation
- quelles aides permettent de mieux manger
- quels peuvent être les causes des troubles de l’élocution et de la déglutition et comment lutter contre.
Le guide contient des idées de délicieuses recettes pour des plats raffinés et un chapitre sur le nouveau concept "Smoothfood", particulièrement adapté aux personnes souffrant de trouble de la déglutition.
Site de l’Association Parkinson Suisse
-
Concept de mise en œuvre du « Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté » sur la période 2014 – 2018, en collaboration avec les cantons, les villes, les communes et des intervenants privés. Le Conseil fédéral a approuvé le programme. L’objectif prioritaire de la Confédération est d’améliorer les chances de formation des enfants, des jeunes et des adultes socialement défavorisés pour éviter qu’ils ne tombent dans la pauvreté. Le montant disponible pour le programme s’élève au total à 9 millions de francs.
Télécharger le document en format pdf
-
Dans le cadre de la Semaine nationale alcool, le Conseil d’Etat valaisan a décerné le prix cantonal « Dîme de l’alcool » au court métrage « Une famille nombreuse », un film de 90 secondes à ne pas rater.
Le Valais décerne ce prix de 10’000 francs tous les deux ans dans le cadre de ses actions visant à prévenir les dépendances (drogues, alcool, tabagisme). Le montant est prélevé sur la part cantonale au bénéfice de la régie fédérale des alcools, dont l’affectation doit être vouée à la lutte contre les dépendances.
« Une famille nombreuse » est un court métrage de 1’30’’ qui aborde avec justesse et sensibilité les dommages collatéraux de l’alcoolisme sur les enfants et les proches. Il a été réalisé par l’association PROD HUG Sion, représentée par Jordi Gabioud. Le film sera projeté dans les principales salles de cinéma du canton (une version allemande a été réalisée à cet effet) durant le mois de novembre avant les lancements des films.
-
A l’occasion des Journées de la schizophrénie 2012, une PechaKucha a été organisée sur ce thème à l’EPFL, avec Archizoom. Six séries d’intervenants ayant 20 images et 20 secondes par image ont ainsi apporté des éclairages multiples et passionnants. Les orateurs sont Philippe Conus, Pierre Magistretti, Pablo - Le fils de la Terre, Isabelle Moncada, Nicole Seiler, Marco Bakker et Alexandre Blanc.
Les Journées de la schizophrénie en ligne visaient à toucher les jeunes en mettant en avant qu’une personne sur 100 est atteinte de la maladie.
-
 La question si singulière de la mort - singulière aussi dans sa pluralité - possède deux versants complémentaires, quoique souvent contradictoires : bien sûr, mourir est, de toute évidence, un acte éminemment individuel, un face-à-face avec soi-même dans lequel nul ne peut s’interposer. Mais le « mourir » et, surtout, l’immédiat « après-mourir » appartiennent également à la communauté de ceux qui restent et par qui l’histoire doit continuer. Il s’agit d’une forme de transmission et, en cela, le décès devrait faire l’objet de la même sollicitude que la naissance.
La question si singulière de la mort - singulière aussi dans sa pluralité - possède deux versants complémentaires, quoique souvent contradictoires : bien sûr, mourir est, de toute évidence, un acte éminemment individuel, un face-à-face avec soi-même dans lequel nul ne peut s’interposer. Mais le « mourir » et, surtout, l’immédiat « après-mourir » appartiennent également à la communauté de ceux qui restent et par qui l’histoire doit continuer. Il s’agit d’une forme de transmission et, en cela, le décès devrait faire l’objet de la même sollicitude que la naissance.Pourtant, la mort se trouve repoussée chaque jour davantage dans les confins individuels des comportements humains. Or, c’est oublier qu’une fois mort, l’homme ne s’appartient plus. Ainsi, les grands débats sur le suicide assisté l’euthanasie, sur la crémation ou l’inhumation, sur une forme de cérémonie religieuse ou républicaine… ne peuvent-ils être ramenés à un simple choix individuel.
Les auteurs, réunis à l’occasion d’un séminaire au centre universitaire catholique de Bourgogne, tentent de penser la mort, de la mettre en questions, de l’apprivoiser peut-être… à partir de leurs réflexions de chercheurs, de leurs pratiques professionnelles et de l’analyse des attitudes anciennes ou contemporaines sur lesquelles se fonde notre humanité.
Daniel Faivre est historien des religions, directeur de recherches au centre universitaire catholique de Bourgogne.
Site des Editions Erès
-
Revue spécialisée
- Evelyne Thommen et Géraldine Ayer : Actualités sur l’autisme (Editorial)
- Evelyne Thommen : Les recommandations de bonnes pratiques pour les personnes avec des troubles du spectre de l’autisme
- Véronique Zbinden Sapin, Evelyne Thommen, Sandra Wiesendanger : L’accompagnement socio-éducatif des adultes du spectre de l’autisme
- Joseph Schovanec : L’insertion professionnelle des adultes avec autisme : une réflexion philosophique entre situation de handicap et intériorité
- Roland Emery : L’intégration en classes ordinaires des enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme : obstacles et propositions
- Rachel Schelling : Intégration scolaire des enfants avec un syndrome d’Asperger : entre volonté, réalités et perspectives
La Revue suisse de pédagogie spécialisée se veut une plateforme de communication nationale destinée aux personnes intéressées par la pédagogie spécialisée. Elle s’adresse avant tout aux professionnel-le-s et aux étudiant-e-s travaillant à l’éducation et à la formation de personnes ayant des besoins éducatifs particuliers sur le terrain, dans un cadre administratif ou dans le domaine de la recherche.
-
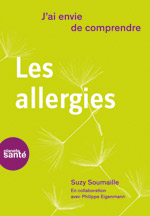 Pollen, gluten, animaux… Un individu sur cinq est touché par une allergie, ce qui en fait la maladie la plus commune du monde occidental. Les causes ne sont pas encore claires, mais il est certain que l’environnement et le mode de vie ont largement leur mot à dire.
Pollen, gluten, animaux… Un individu sur cinq est touché par une allergie, ce qui en fait la maladie la plus commune du monde occidental. Les causes ne sont pas encore claires, mais il est certain que l’environnement et le mode de vie ont largement leur mot à dire.L’allergie, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’une réponse disproportionnée de l’organisme à des substances d’origine végétale, animale ou chimique qui laissent indifférents la majorité des gens. Certains d’entre nous ont hérité d’une prédisposition les rendant plus sensibles à ce qui les entoure. Peut-on quelque chose contre un système immunitaire qui se croit attaqué à tort et réagit avec excès ?
L’objectif de ce livre est de répondre à toutes les interrogations, grandes et petites, concernant les allergies. Les huit chapitres très accessibles font le tour de la question : symptômes, pratiques à éviter, conseils utiles, témoignages, mesures de prévention, traitements disponibles et futurs.
-
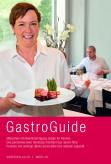 Ces établissements professionnels sont gérés par des institutions pour personnes avec handicap. Dans le cadre de leurs restaurants et hôtels, qui doivent aujourd’hui faire face à un contexte économique difficile, ils proposent à des hommes et à des femmes des places de travail et d’apprentissage protégées, proches du marché régulier du travail. Les restaurants et les hôtels sont des lieux d’intégration très particuliers : ils permettent aux personnes avec handicap d’avoir très facilement et naturellement des contacts avec les clients. Cela favorise la proximité et la compréhension réciproque, désamorce les réticences et contribue à jeter des ponts.
Ces établissements professionnels sont gérés par des institutions pour personnes avec handicap. Dans le cadre de leurs restaurants et hôtels, qui doivent aujourd’hui faire face à un contexte économique difficile, ils proposent à des hommes et à des femmes des places de travail et d’apprentissage protégées, proches du marché régulier du travail. Les restaurants et les hôtels sont des lieux d’intégration très particuliers : ils permettent aux personnes avec handicap d’avoir très facilement et naturellement des contacts avec les clients. Cela favorise la proximité et la compréhension réciproque, désamorce les réticences et contribue à jeter des ponts.Le succès de la première édition du GastroGuide a incité INSOS Suisse, l’association de branche nationale des institutions pour personnes avec handicap, à revoir ce guide gastronomique hors du commun, à le doter d’une nouvelle présentation et, surtout, à l’augmenter considérablement.
Le GastroGuide en couleurs et en trois langues (D, F, I) compte 176 pages et est disponible en librairie (ISBN 978-3-906033-69-3). Il peut également être commandé par mail à . CHF 19.- (plus port et emballage).
Site internet d’INSOS Suisse
-
Le Tribunal fédéral a considéré que le patient étant atteint à un stade avancé de la maladie d’Alzheimer, les bénéfices de soins fournis à domicile apparaissent ténus par rapport à des soins fournis dans un EMS.
Il a dès lors jugé que vu la disproportion entre les coûts, à charge de l’assurance-maladie, de soins à domicile et de soins en EMS (2,56 fois plus chers), les prestations de soins à domicile ne répondent pas au critère de l’économicité dans un tel cas. L’assurance-maladie du patient est ainsi fondée à limiter sa prise en charge à 108 fr. par jour correspondant au montant à sa charge en cas de soins dispensés dans un EMS. Il s’agira de suivre quelles conséquences cette jurisprudence aura sur la prise en charge des patients gravement dépendants.
Synthèse du jugement par Yvan Fauchère, juriste à l’ARTIAS, en format pdf.
-
Article spécialisé
 Dans un contexte global de vieillissement de la population, une meilleure connaissance des mécanismes conduisant à la perte d’autonomie constitue un objectif majeur, notamment pour mettre en œuvre des politiques de prévention efficaces. Le concept de « fragilité », élaboré initialement en géronto-gériatrie et désignant un état précurseur de la dépendance fonctionnelle, apparaît à ce titre comme un outil intéressant. Si plusieurs approches coexistent, le modèle de Fried, reposant sur cinq critères d’ordre physiologique – fatigue, diminution de l’appétit, faiblesse musculaire, ralentissement de la vitesse de marche, sédentarité – semble le plus opérationnel pour mesurer la fragilité et cibler des populations suffisamment en amont de la dépendance.
Dans un contexte global de vieillissement de la population, une meilleure connaissance des mécanismes conduisant à la perte d’autonomie constitue un objectif majeur, notamment pour mettre en œuvre des politiques de prévention efficaces. Le concept de « fragilité », élaboré initialement en géronto-gériatrie et désignant un état précurseur de la dépendance fonctionnelle, apparaît à ce titre comme un outil intéressant. Si plusieurs approches coexistent, le modèle de Fried, reposant sur cinq critères d’ordre physiologique – fatigue, diminution de l’appétit, faiblesse musculaire, ralentissement de la vitesse de marche, sédentarité – semble le plus opérationnel pour mesurer la fragilité et cibler des populations suffisamment en amont de la dépendance.En économie de la santé, l’approche retenue ici de la perte d’autonomie s’intéresse particulièrement aux causes et conséquences économiques et sociales du processus de fragilisation des personnes âgées et aborde des enjeux tant en termes de protection sociale que d’efficacité du système de soins.
Source : Pratiques en santé
L’article spécialisé en format pdf
-
 Selon les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS), extraites du dernier rapport « She Figures 2012 » de la Commission européenne, les femmes sont, en Suisse, peu présentes au plus haut niveau de la recherche scientifique.
Selon les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS), extraites du dernier rapport « She Figures 2012 » de la Commission européenne, les femmes sont, en Suisse, peu présentes au plus haut niveau de la recherche scientifique.Les institutions actives dans le domaine scientifique sont majoritairement dirigées par des hommes. Cette faible présence des femmes dans les postes clés des institutions scientifiques et académiques a un effet boule de neige sur les autres niveaux de la carrière scientifique des femmes. On constate par, exemple, que les fonds de recherche alloués par les agences de financement sont proportionnellement plus souvent attribués à des hommes qu’à des femmes et que, dans les hautes écoles, la part des femmes diminue à mesure que le niveau hiérarchique s’accroît.
Le rapport en format pdf
-
Une personne en deuil souffrirait de « dépression majeure » si elle n’arrive pas à surmonter son chagrin après deux semaines. Une personne très timide serait atteinte de « phobie sociale » et un enfant qui conteste les adultes et les règles, serait taxé de « trouble oppositionnel avec provocation ». Sommes-nous tous devenus fous ?
En 60 ans, le nombre de troubles mentaux répertoriés dans le DSM, la « bible » des psychiatres, est passé de 60 à plus de 400 alors que la consommation de psychotropes a augmenté de 4 800 % aux États-Unis au cours des 26 dernières années. Or, cette épidémie de « maladies mentales » est très largement fabriquée, nous explique J.-Claude St-Onge dans cet essai sur l’influence démesurée de l’industrie pharmaceutique sur la psychiatrie.
Tous fous ? cible les thèses de la biopsychiatrie, selon lesquelles la détresse psychologique résulterait d’un déséquilibre chimique dans le cerveau, sans égard au contexte social et personnel des patients. L’auteur remet en question la prescription massive d’antidépresseurs et d’antipsychotiques aux effets sous-estimés et souvent dévastateurs : anxiété, pensées suicidaires, diabète, AVC, atrophie du cerveau…
Mais l’exploitation du mal-être est extrêmement lucrative et les compagnies pharmaceutiques sont prêtes à tout pour satisfaire l’appétit insatiable de leurs actionnaires : médicalisation des évènements courants de la vie, essais cliniques biaisés, corruption des médecins, intimidation des chercheurs… Même les amendes salées contre ces agissements ne les font pas reculer.
Jean-Claude St-Onge est professeur de philosophie à la retraite et docteur en socio-économie. Il a publié, chez Écosociété, L’imposture néolibérale (2000), Les dérives de l’industrie de la santé (2006) et L’envers de la pilule (2008). Ce dernier ouvrage a obtenu le prix Orange de l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec.
-
Rédaction REISO : Ecrite dans un style limpide, cette brochure remarquable présente des exemples très concrets de situations conflictuelles vécues au quotidien dans les soins en EMS ou ailleurs (institution du handicap, CMS, autres). Les recommandations ne donnent pas une réponse toute faite mais présentent clairement les enjeux des diverses réponses possibles.
Six situations concrètes sont examinées :
- Refus de médicaments
- Contrainte (contention)
- Alimentation
- Violence
- Intimité
- Sécurité
Plusieurs concepts centraux, comme la capacité de discernement et la volonté présumée, sont également expliqués dans cette brochure. Si ces recommandations ne permettent pas de prendre infailliblement la seule bonne décision, elles permettent en revanche de comprendre les clefs d’une réflexion éthique et aident les professionnels à élaborer, avec leurs collègues, une décision réfléchie et motivée.
Des ateliers éthiques pour une culture commune
Pour permettre aux professionnels de s’approprier ces recommandations, des ateliers éthiques sont organisés dans les EMS. Animés par des membres du Conseil d’éthique, ils présentent des exemples concrets aux participants des diverses professions. La réflexion en groupe permet de mieux repérer les aspects déontologiques, les aspects juridiques et les aspects « techniques » ou cliniques de la situation. Ces ateliers, associés aux interventions « à la demande » du Conseil d’éthique sur des situations spécifiques, réservées à un EMS précis, devrait permettre aux EMS membres de la Fegems de se doter d’une culture commune en manière de réflexion et de résolution de problèmes éthiques.
Les recommandations en format pdf
-
Premier ouvrage qui explique concrètement comment orienter nos choix alimentaires et comment reprendre le contrôle sur notre alimentation.
Car face aux excès de l’agro-alimentaire industriel, un mouvement est en marche. Ces principales composantes : Manger sain, manger bio, manger équitable, manger proximité et diversité. Comment conjuguer ces cinq critères ? Cet ouvrage expose de façon simple et documentée les enjeux de ces cinq conditions à respecter pour retrouver notre souveraineté alimentaire. Très joliment illustré, il donne aussi de multiples références, des éclairages et des chiffres pour que les consommateurs, ainsi avertis, puissent faire les bons choix.
René Longet est un expert reconnu en développement durable. Auteur notamment de « Pourquoi manger local ? » et « Fruits et légumes de saison » parus aux éditions Jouvence.
-
 Les données de la statistique des bénéficiaires de l’aide sociale ont été appariées entre elles et constituent la base permettant les analyses longitudinales.
Les données de la statistique des bénéficiaires de l’aide sociale ont été appariées entre elles et constituent la base permettant les analyses longitudinales.Cette étude à caractère exploratoire met en évidence le potentiel que constituent ces analyses sur la base de quelques exemples dans le domaine de l’aide sociale.
La recherche montre aussi les limites de cette méthodologie. Cette publication est un condensé d’un travail de recherche réalisé par la Haute école bernoise (Travail social).
L’étude en format pdf
-
En France, la loi pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » porte en elle beaucoup d’espoir (un peu comme la LHand en Suisse, ndlr). Mais si cette politique est un grand pas en avant elle peut être aussi une source de malentendus. Cet ouvrage a pour but de faire le point sur l’inclusion scolaire en tant que visée et en tant que réalisation. Notre questionnement porte à la fois sur l’hiatus de l’inclusion, sur l’hiatus entre la règle et les normes, sur les contradictions et les paradoxes, sur les petits pas du quotidien qui permettent malgré les obstacles, de faire avancer cette idée de l’humanité qui est celle de l’homme « autrement capable ».
Les contributions de cet ouvrage s’intéressent à l’observation de l’activité de l’élève en situation en tant qu’élément constitutif d’un corps social. Mais les risques de glissements sont récurrents et demandent de relever des défis dont celui de passer d’un contrat social d’assistance individuelle à un contrat de construction de l’enseignement et de l’apprentissage.
Sur ce thème, lire l’article de Pierre Vianin : « Intégrer les porteurs de lunettes à l’école ? »
Les annonces du réseau
L'affiche de la semaine
 Bureaux partagés en sous-location à Lausanne-centre, dans un environnement propice aux échanges et aux synergies, notamment avec des associations axées sur la famille. (image : © Freepik)
Bureaux partagés en sous-location à Lausanne-centre, dans un environnement propice aux échanges et aux synergies, notamment avec des associations axées sur la famille. (image : © Freepik)