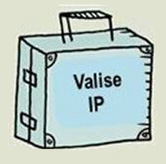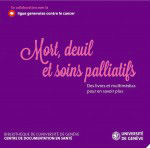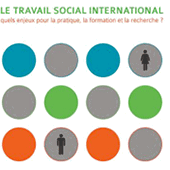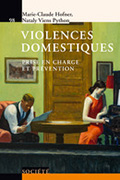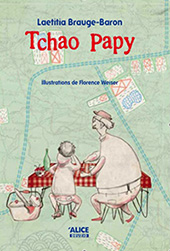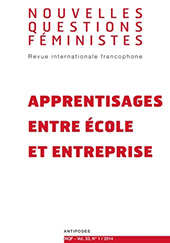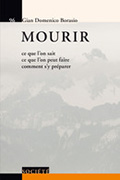Pour réunir les savoirs
et les expériences en Suisse romande
S'abonner à REISO
La liste des parutions
-
Dans le cadre du plan d’action sur la prévention du cannabis, l’Office fédéral de la Santé publique a lancé le Programme « Intervention précoce dans le champ de l’école et de la formation » afin de soutenir le plus tôt possible les jeunes dont les conditions de vie et/ou les comportements peuvent entraîner des difficultés et dont l’intégration risque d’être fragilisée. Il a favorisé la collaboration entre les différents acteurs : services spécialisés de la prévention, écoles de Suisse romande (du degré secondaire I et II), les semestres de motivation (SeMo), mais également les parents, ou encore d’autres services spécialisés.
Dans le cadre du mandat reçu de l’OFSP, la Haute école fribourgeoise de travail social a élaboré et dispensé deux cycles de formation pour les professionnel-le-s des services spécialisés responsables d’accompagner les établissements de formation qui mettent en place une « Intervention précoce » (IP).
Le contenu de ces cours, les expériences issues des projets de terrain, les échanges lors des ateliers ont permis la conceptualisation d’un processus d’accompagnement des projets IP des établissements de formation et d’outils articulés, didactiques et concrets, à disposition des professionnel-le-s des services spécialisés
Un dossier pédagogique est né, fruit de la capitalisation de ces savoirs qui comporte trois types de fiches portant sur les thèmes centraux de l’accompagnement des établissements dans leurs projets.
- Les fiches introductives présentent le programme OFSP « Intervention précoce »
- Les fiches de base décrivent le modèle d’intervention utile au projet d’établissement
- Les fiches d’approfondissement développent l’accompagnement comme un processus composé de différentes étapes et responsabilités des services spécialisés qui accompagnent les établissements
- Et les outils et références : articles, ouvrages de références, méthodes, vidéo, support de cours, expériences…
Le dossier pédagogique en kit (informatique et papier) : CHF 100.-
Le dossier pédagogique uniquement en format informatique (USB) : CHF 30.-Références et liens en ligne
-
Le colloque a eu pour thème : « L’intégration qui handicape. Influence de la gestion des ressources sur l’intégration ». Les interventions disponibles en ligne :
Prof. Dr Roland Reichenbach, professeur de sciences générales de l’éducation, Institut des sciences de l’éducation, Université de Zurich
- Dans l’ombre d’un idéal Pédagogie de l’intégration – motifs, rhétorique et interrogations. Un éclairage extérieur
- Exposé en allemand, résumé en français
Dr Beatrice Kronenberg, directrice CSPS, Fondation Centre suisse de pédagogie spécialisée
- Les bases légales, la gestion et le diagnostic
- Exposé en allemand, résumé en français
Dr Alexandra Schubert, Service de pédagogie spécialisée du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures
- Mise en œuvre de la Procédure d’évaluation standardisée (PES) dans les cantons : l’exemple d’Appenzell Rhodes-Extérieures et de la Suisse orientale
- Exposé en allemand, résumé en français
Julia Rennenkampff, responsable données et MIS (Management Informations- System), Service de l’enseignement de la Ville de Zurich
- Gestion des finances dans la Ville de Zurich. Point de vue économique et pédagogique – Convergence ou contradiction ?
- Exposé en allemand, résumé en français
Jean-Daniel Nordmann, pédagogue
- Je suis normal mais je me soigne…! Une réflexion sur la normalité et ses critères
- Exposé en français, résumé en allemand
Les exposés en format pdf
-
Extraits de l’article du Courrier - Des migrants menottés, des barbelés, des réfugiés « illégaux », ou encore des « vagues » d’immigration. Des images et des mots qu’on associe trop souvent à l’asile et qui en donnent une image négative et déformée. C’est en tout cas l’avis de Sophie Malka, responsable de la revue d’information sur le droit d’asile Vivre Ensemble. Depuis six mois, son association a mis en place une veille médiatique pour traquer les erreurs des journalistes. L’objectif ? « Lutter contre les idées reçues répandues dans l’imaginaire collectif en attirant l’attention des médias sur leur traitement des questions d’asile. »
Dans les faits, Le Comptoir des médias contacte directement les journalistes qui auraient fait un amalgame ou une erreur factuelle pour leur suggérer de modifier l’information en question. « Nous voulons travailler avec les médias, et non contre eux », tient à préciser Sophie Malka. Avant de poursuivre : « Les préjugés sur les demandeurs d’asile sont bien ancrés. A force d’être répétés, même les journalistes finissent par les intégrer. »
Pour signaler tout article ou émission problématique ou de qualité que vous avez lu, vu ou entendu : 077 497 41 00 et/ou
Le Comptoir des médias en ligne
-
Dossier spécialisé
Dans le cadre du dispositif d’aide sociale vaudois, les familles constituent un public cible prioritaire. Dans le canton de Vaud, 27% des bénéficiaires du revenu d’insertion (RI, équivalent de l’aide sociale des autres cantons) sont des familles, dont plus de la moitié sont monoparentales. Parmi ces familles monoparentales, un nombre non négligeable de mères ont moins de 25 ans, ce qui a mené le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) du canton de Vaud à porter un regard particulier sur leur situation et prise en charge. Plusieurs mesures et programmes mis en place par le service sont particulièrement adaptés aux jeunes mères monoparentales, même s’ils ne leur sont pas toujours exclusivement destinés.
Le canton de Vaud est conscient que des défis restent à relever pour améliorer le dispositif, notamment en termes d’accès à des solutions de garde et de soutien à la parentalité. Pour ce faire, le SPAS souhaite privilégier le travail en réseau en créant des liens entre le dispositif d’insertion, le dispositif d’accueil de jour des enfants, les structures de soutien à la parentalité et les employeurs.
Dossier en format pdf
-
En Suisse, l’égalité entre hommes et femmes existe dans la Constitution, mais pas dans la réalité. Or, elle aboutirait non seulement à plus de justice, mais aussi à des avantages économiques. La réalisation de l’égalité ne peut cependant pas être prescrite par en haut : elle doit être soutenue par tous les membres de la société. Telle est la conclusion à laquelle parvient le Programme national de recherche "Egalité entre hommes et femmes" (PNR 60) et ses 21 projets de recherche.
Le rapport de synthèse couvre les quatre champs :
1. Formation : les stéréotypes dominent
Dans les crèches et les écoles, on continue à appliquer des pratiques et à utiliser des moyens didactiques qui transmettent aux enfants des idées stéréotypées de ce que sont les comportements "féminins" ou "masculins". Les enseignants, les directions des écoles et les services d’orientation professionnelle soutiennent insuffisamment les orientations "atypiques" des jeunes gens et des jeunes filles. Au quotidien, l’école accorde trop peu d’importance à l’égalité, puisque tout le monde pense qu’elle est déjà réalisée.
Les tendances et les intérêts des jeunes sont pilotés par des images normalisées de la "féminité" et de la "masculinité". Les jeunes hommes anticipent leur futur rôle de soutien de famille au moment de décider de leur profession, tandis que les jeunes femmes choisissent des métiers qui peuvent être exercés à temps partiel ou malgré une pause consacrée à la famille. Cela consolide l’inégalité entre professions "typiquement masculines" et "typiquement féminines" tout comme le déséquilibre dans la répartition du travail rémunéré et non rémunéré entre hommes et femmes – au détriment de ces dernières.
2. Marché du travail : dès le début, les femmes touchent un salaire moins élevé
Lorsqu’elles entrent dans la vie professionnelle, les jeunes femmes touchent un salaire moins élevé pour un travail de même valeur. Cette inégalité est contraire au principe d’égalité, mais influence aussi le rapport entre hommes et femmes, puisqu’elle détermine qui, dans un couple et dans une famille, va assumer le travail familial non rémunéré. Les entreprises et le secteur public supposent a priori que les femmes vont s’occuper des tâches liées à la famille et les hommes consacrer leur vie exclusivement à l’exercice de leur métier. Les stéréotypes relatifs aux carrières dans des emplois rémunérés, à la disponibilité sur le lieu de travail ou aux compétences prévalent, surtout dans les branches dominées par les hommes.
Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail touche aussi bien les hommes que les femmes ; près d’une personne sur deux est confrontée à un comportement susceptible de constituer du harcèlement. Mais les femmes se sentent subjectivement bien plus concernées, parce qu’elles perçoivent ce comportement comme étant plus menaçant que les hommes, en raison de la répartition traditionnelle du pouvoir ainsi que des rapports de force physiques. Une culture d’entreprise marquée par le respect mutuel et par des principes éthiques a un effet préventif à cet égard.
3. Conciliation de la famille, de la formation et de l’emploi : trop peu de possibilités d’accueil extra-familial
Les impôts, les transferts sociaux et les frais de garde des enfants influencent également la décision des parents de savoir qui va aller travailler et qui va assumer les tâches domestiques non rémunérées. En matière d’offre d’accueil extra-familial, la Suisse est à la traîne en comparaison internationale. Une offre d’accueil abordable permet aux couples de revoir la répartition des tâches au sein de la famille et de réaliser plutôt en partenariat des modèles d’activité lucrative et de prise en charge des enfants.
Lorsque les entreprises s’occupent de la conciliation entre vie professionnelle et vie de famille, elles se concentrent sur les femmes jeunes et sur la fondation d’une famille. Les femmes et les hommes qui se trouvent dans la seconde moitié de leur carrière professionnelle ne sont pas pris en compte et sont exclus des mesures de formation continue.
4. Sécurité sociale : les femmes âgées sont insuffisamment protégées contre les situations de rigueur
Le travail à temps partiel, dans la plage des bas salaires et dans le domaine du care a fortement progressé ces dernières décennies. Ces formes de travail souvent précaires représentent pour beaucoup d’individus une base existentielle peu sûre, mais qui touche deux fois plus les femmes que les hommes. En raison de la connexion entre les cotisations d’assurances sociales et un parcours professionnel continu et à temps plein, les femmes de plus de 50 ans sont souvent défavorisées ou ne sont pas suffisamment protégées lorsqu’elles subissent une situation de rigueur et sont alors tributaires de l’aide sociale ou des prestations complémentaires de l’AVS/AI : à l’âge de la retraite, elles reçoivent une rente jusqu’à trois fois moins élevée que celle des hommes qui – dé-chargés du travail familial non rémunéré – travaillent souvent à temps plein et sans interruption et peuvent ainsi se protéger.
En Suisse, le moyen le plus important pour couvrir ses besoins vitaux est la formation : l’absence de formation après la scolarité obligatoire est le risque de pauvreté numéro un. Les femmes d’âge mûr sans travail n’ont pratiquement pas eu l’occasion de terminer une formation professionnelle dans leur jeunesse, et sont également trop peu stimulées par la suite.
Malgré des progrès réels, beaucoup reste à faire
Le comité de direction du PNR 60 parvient à la conclusion que les parents comme les éducateurs devraient être conscients de la grande influence qu’ils exercent sur le choix des études et de la profession des jeunes. Les employeurs doivent veiller à ce que tous les employées et employés puissent fournir, parallèlement à leur activité professionnelle, un travail de care non rémunéré, sans être défavorisés pour autant. La conciliation de la famille, de la formation et de l’emploi exige des offres d’accueil bon marché pour les enfants ainsi que pour les adultes ayant besoin de soins.
Pour qu’il vaille la peine d’exercer un travail rémunéré, il faut que le revenu, les impôts, les transferts sociaux et les frais de garde soient coordonnés les uns avec les autres de manière à ce qu’un salaire plus élevé entraîne un revenu disponible plus élevé. Une offensive de formation pourrait aider les personnes non qualifiées au chômage, qui sont plus souvent des femmes que des hommes, à achever une formation professionnelle complète. De façon générale, les instruments de la sécurité sociale (assurances sociales et aide sociale) devraient tenir compte de la diversité des modèles familiaux. Ce n’est que lorsqu’ils bénéficieront d’une protection sociale et d’une prévoyance appropriées, même en travaillant à temps partiel, que les hommes et les femmes auront les mêmes chances de couvrir leurs besoins vitaux de façon autonome.
Lire aussi sur REISO :
- Les enfants nous rendent traditionalistes, de René Levy
- Quand filles et garçons aspirent à des professions atypiques, de Mmes Gianettoni, Guilley et Carvalho
- Le genre est out, la diversité arrive, de Gudrun Sander et René Levy
- A l’école, l’égalité (ne) va (pas) de soi, de Farinaz FassaVidéos des interviews de Prof. Brigitte Liebig et Prof. René Levy sur cette page du site du FNS
La synthèse en format pdf
-
Ce livre restitue les résultats d’une vaste recherche menée par Stéphane Rossini avec des collaboratrices et collaborateurs et consacrée à l’allocation des ressources dans la politique de santé suisse. Les chercheurs ont étudié la cohérence des mécanismes d’allocation des ressources dans cinq champs de la Loi fédérale suisse sur l’assurance-maladie (LAMal) : la planification hospitalière ; le financement des soins ; la réduction des primes d’assurance-maladie ; la clause du besoin en matière de démographie médicale ambulatoire ; et les médicaments. Ces problématiques ont été analysées à travers leur mise en œuvre dans les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud. Il s’est agi de décrire par quels acteurs, dans quels espaces décisionnels, selon quels processus et à l’aune de quels critères les choix d’allocation des ressources ont été opérés ; d’apprécier le degré de cohérence des décisions entre les niveaux institutionnels et pour les différents acteurs ; de comprendre comment la dimension éthique sous-tend ces processus d’allocation des ressources.
C’est la première fois qu’une telle étude est réalisée en Suisse sur la gouvernance du système de santé en regard non pas des principes généraux, mais des pratiques cantonales effectives. Les cantons latins constituent le cadre de l’analyse. On y découvre, entre autres, une présentation unique des processus de planification hospitalière depuis cinquante ans, une description des mécanismes de fonctionnement du marché des médicaments et une comparaison des applications cantonales de la LAMal sur près de vingt ans.
Cette étude confirme la nécessité de repenser et de clarifier les modalités de gouvernance, d’organisation et, surtout, de détermination des objectifs et des moyens des politiques publiques en matière de santé. Allocation optimale des ressources publiques, économicité et efficience des prestations de santé, solidarité et justice sociale sont, dans cette perspective, des axes centraux, incontournables et complémentaires, qui orienteront la manière de définir l’offre, l’accès et la qualité des prestations, dans l’esprit du service public et de l’intérêt général.
Stéphane Rossini est un collaborateur de la revue REISO. Voir la liste de ses articles sur cette page
-
Martine Pernoud, musicothérapeute, formatrice Baschet et fondatrice de La Bulle d’Air, présente, avec de nombreux exemples, le fruit de trois années de pratique des instruments Baschet avec des bénéficiaires des cinq institutions de la Fondation Ensemble et leurs éducateurs. Elle donne également des pistes pour tenter soi-même l’expérience et encourager les institutions à utiliser ces structures sonores aux propriétés particulièrement intéressantes pour l’accompagnement des enfants et des adultes avec une déficience intellectuelle et/ou des troubles du spectre autistique.
Les sculptures ou structures sonores Baschet sont un ensemble de 14 instruments créés dans les années 80, en France, par les frères Baschet. Ces instruments dédiés à l’éveil sonore se composent de claviers métalliques encastrés sur des diffuseurs en fibre de verre. Métal, tiges de cristal et cordes permettent d’aborder aisément une palette infinie de gestes sonores, de varier les sensations de touchers, de perceptions vibratoires. Disposer d’un matériel solide et sensible dont on génère un son sans effort et immédiatement perceptible, différent, esthétique et valorisant a ouvert des perspectives nouvelles et très intéressantes comme outil d’éducation ou de rééducation pour les personnes, enfants et adultes, en situation de handicap.
Commande à la Fondation Ensemble
-
Pour marquer son 60e anniversaire, le Centre social protestant de Genève retrace quelques étapes de son histoire. Une chose frappante dans cette très originale « Ligne du temps » : la permanence des thèmes les plus importants comme le logement, l’intégration de toutes et tous, la pauvreté, la santé.
Parmi les coups de projecteurs, signalons par exemple :
- Dans les années 50 : les problèmes de logement
- Dans les années 60 : les premiers cours de gymnastique pour les personnes âgées
- Dans les années 70 : les minibus avec chauffeurs bénévoles pour les personnes à mobilité réduite
- Dans les années 80 : les cours de français pour les candidats à l’asile et la « Petite école » pour les enfants « clandestins » qui ne pouvaient pas aller à l’école publique
- Dans les années 90 : des actions et des réflexions sur le chômage, l’exclusion ou la fin de vie à domicile
- Depuis le tournant du millénaire : les campagnes de prévention de l’endettement des jeunes et toutes les activités liées aux thèmes historiques du CSP
A noter que le CSP Genève fête ce jubilaire avec un « tout-ménage » tout aussi original. Adressé aux habitants du canton, il a pour slogan « Devenez plus riches que jamais avec le CSP ». Grâce à un donateur qui souhaite rester anonyme, une pièce de 5 centimes est distribuée à chaque ménage dans l’idée que l’engagement en faveur d’une cause peut contribuer à rendre une vie plus riche (donner pour recevoir).
-
À l’heure où différentes mesures visant à « accélérer » la procédure d’asile sont mises en œuvre ou annoncées, peut-on réellement s’attendre à ce que chaque personne requérant la protection de la Suisse voie sa demande traitée de manière rapide et équitable ?
À l’appui de treize cas concrets, le présent rapport révèle que bien souvent des années s’écoulent entre le dépôt d’une demande d’asile et la décision de l’Office fédéral des migrations. En effet, l’administration a tendance à traiter rapidement les cas devant aboutir à un renvoi et à faire attendre les personnes dont le besoin de protection est manifeste. À travers cette publication, les Observatoires du droit d’asile et des étrangers souhaitent apporter des pistes de réflexion sur les choix opérés en matière de hiérarchisation des demandes, ainsi que sur les solutions proposées dans le contexte de la restructuration du domaine de l’asile.
Le rapport en format pdf
-
Bibliographie avec des livres, des DVD, des vidéos et des liens sur :
- Mort
- Deuil
- Témoignages sur le deuil
- Soins palliatifs, fin de vie, accompagnement
- Vie après la mort
- Débats et témoignages
- DVD et vidéos
- Liens web
La bibliographie en format pdf
-
Prendre soin rassemble des articles parus dans le « Bulletin des médecins suisses » sur des sujets très présents dans les débats, en médecine, au sein du système de santé et dans la société en général. L’auteur discute ces questions et enjeux dans leurs dimensions pratiques, éthiques, sociales et politiques au sens large – dans la vie de la polis, la chose publique. L’ouvrage comprend huit sections :
- Soignés et soignants
- Une médecine et un système en évolution rapide
- Ethique – Comment faire pour bien faire ?
- La société change
- Le monde dans lequel nous vivons
- Etrange, étranger… – Autres cultures et contextes
- Prendre soin de soi et du monde
- Découvertes, ailleurs
Avec une préface du Dr Bruno Kesseli, Rédacteur en chef du « Bulletin des médecins suisses ».
Jean Martin est médecin de santé publique. Après huit ans outremer sur quatre continents, il a intégré le Service de la santé publique vaudois où il a travaillé un quart de siècle (médecin cantonal de 1986 à 2003). Il a été amené à s’intéresser particulièrement aux enjeux éthiques au sein de la Commission nationale suisse d’éthique et du Comité international de bioéthique de l’UNESCO. Il est engagé dans des organisations des domaines médico-social, humanitaire et du développement et dans la vie civique vaudoise.
Trois éclairages de l’auteur
Quels critères dans la sélection faite ?
J’ai choisi les textes qui ont un caractère « durable », pour employer un mot à la mode, pas indûment anecdotiques ou datés. Basés sur l’expérience (la seule chose qui ne s’apprend pas dans les livres !) de ce que j’ai fait et vécu, et les préoccupations qui sont les miennes aujourd’hui. Mon idée est que ce livre peut retenir l’attention d’un large public intéressé par les enjeux auxquels est confronté la société d’aujourd’hui.
Sur les relations de voyages du dernier chapitre
Mon épouse et moi sommes partis pour aider les personnes de la partie amazonienne du Pérou, en 1968, et avons travaillé durant huit ans sur quatre continents. Cette expérience a été une leçon de modestie. Nous avons en effet découvert qu’il était illusoire de vouloir plaquer nos modèles et « solutions » sur des situations très différentes des nôtres. Mais nous avons toujours trouvé passionnant de rencontrer des gens qui ont d’autres cadres de référence, d’autres manières de vivre et de réagir.
Sur la mort et le mourir souvent présents dans les articles des dernières années
Comme chacun, je pense à la finitude inéluctable de notre existence. Il me semble que je suis assez serein à cet égard. L’immortalité dont rêvent aujourd’hui quelques beaux esprits dans des fantasmes de biomédecine-fiction serait un cauchemar et les enfants ne seraient plus du tout bienvenus dans une telle société. Par ailleurs, comme médecin cantonal et membre de la Commission nationale d’éthique, j’ai eu à me préoccuper de l’assistance au suicide. J’estime que chaque personne a le droit, qui doit être respecté, de pouvoir mettre fin à une existence devenue trop douloureuse et lourde. Dans ce contexte toutefois, les pouvoirs publics ne doivent en aucune façon et jamais donner l’impression qu’ils cautionnent le suicide.
Jean Martin est aussi bien connu des lecteurs et lectrices de la revue REISO à laquelle il fait l’honneur de collaborer régulièrement.
-
Avec les contributions suivantes :
- Paola Richard-de Paolis : Le Travail social international : quels enjeux pour la pratique, la formation et la recherche ?
- Jean-Christophe Bourquin : Le Travail social aujourd’hui : comprendre au-delà des frontières
- Marlène Hofstetter : Travail social international et recherche : une perspective à développer ?
- Geneviève Piérart : Migrations et handicaps : réinventer l’accompagnement au quotidien
- Théogène-Octave Gakuba : A la découverte de nouveaux territoires : acculturation et intégration des étudiant-e-s africain-e-s en HES santé-social en Suisse romande
- Joseph Coquoz : L’internationalisation du Travail social : quelle formation pour quel-le travailleur-se social-e ?
- Alida Gulfi et François Henry : Atelier A - Pratiques de l’intervention auprès des populations plurielles
- Marie-Christine Ukelo-Mbolo Merga et Amélie Sterchi : Atelier B - Interculturalisation de la formation du domaine du Travail social
- Bhama Steiger et Irena Gonin : Atelier C - Recherche dans des contextes sociopolitiques et professionnels divers
Les actes en format pdf
-
Guide
Ce guide est destiné aux professionnel-le-s travaillant dans le domaine social, des soins médicaux, de l’enseignement ou des crèches. Il a pour but de les informer sur la situation des enfants vivant dans une famille touchée par les problèmes d’alcool afin de leur donner des pistes pour les soutenir.
Ce guide a aussi comme objectif de leur montrer les possibilités d’intervention en répondant à des questions telles que : quand intervenir et comment ? Où trouver conseil et soutien ? Quels sont les aspects juridiques de la thématique ?
Le guide en format pdf
-
Recension par Jean Martin
Didier Pittet, champion de la prévention des risques infectieux dans les soins
Didier Pittet est professeur et directeur du Service de prévention et contrôle de l’infection aux Hôpitaux universitaires de Genève. Il s’est acquis au cours des vingt dernières années une reconnaissance mondiale et a eu un impact majeur par ses travaux liés à la lutte contre la transmission d’infections dans les soins.
Le livre qui vient de lui être consacré brosse la fresque d’une vie d’engagements et du Programme de l’OMS « Des mains propres sauvent des vies ». Cette opération mondiale lutte contre la pandémie silencieuse des infections nosocomiales responsables de 20’000 à 50’000 décès par jour dans le monde, nous dit-on.
Récit plein d’anecdotes petites ou grandes, tantôt drôles, tantôt poignantes dans certains pays en voie de développement. Avec des épisodes politico-culturels dans certains pays islamiques : ces pays craignaient que l’alcool entre dans le corps par la peau des mains et le programme a donc aménagé la solution de lavage préconisée pour qu’elle devienne acceptable face à ces exigences.
L’ouvrage bénéficie d’une préface de Margaret Chan, directrice générale de l’OMS, et de Sir Liam Donaldson, ambassadeur de l’OMS pour la sécurité des patients qui relève que le programme de l’OMS « Un soin propre est un soin plus sûr » (Clean Care is Safer Care) doit beaucoup à Didier Pittet : « Ce livre raconte l’histoire d’un leader, capable avec le concours de l’OMS de concrétiser son rêve de sauver des vies grâce à l’hygiène des mains (…) Peu de gens ont entendu son nom mais beaucoup lui doivent leur santé et leur vie. »
Crouzet souligne aussi comment Didier Pittet n’a à aucun moment cherché à faire de l’argent avec le développement d’un produit (solution hydro-alcoolique) et le « Geneva Model » d’hygiène qui s’est largement répandu dans le monde. C’est un signe fort d’accepter de mettre à disposition gratuitement les découvertes et les développements que l’on a permis. On souhaiterait voir ce genre de « service à la communauté mondiale », non seulement de la part de médecins et autres scientifiques mais aussi de la part les entreprises produisant des médicaments ou des équipements et matériels médicaux.
Je ne sais si l’intéressé est à l’aise avec tous les honneurs, y compris une haute décoration de la Couronne britannique, et compliments qui lui sont adressés, mais l’histoire et les faits que raconte « Le geste qui sauve » méritent d’être largement connus, débattus et enseignés. Procurez-vous ce livre… Dont, soit dit en passant, l’auteur cède ses droits au Fonds « Clean Hands Save Lives ».
Jean Martin, médecin spécialiste d’éthique et de santé publique
-
Longtemps cachée, déniée, considérée comme honteuse par ses victimes, la violence domestique n’en est pas moins une réalité concrète qui tue, dans notre pays, une femme toutes les deux semaines et qui coûte des millions de francs par an à la société civile.
Dès lors, ce type de violence ne peut plus être considéré comme relevant uniquement de la sphère privée. L’isolement des victimes, dû à l’incompréhension du phénomène, aux préjugés, à la peur et à l’ignorance de structures d’aides, n’est plus admissible.
Cet ouvrage parle de succès, d’échecs, d’espoirs, et il cherche avant tout à rendre sensible chaque citoyen à ce qui devrait être une évidence : prévenir la violence domestique et en faire une affaire de santé publique.
Site internet des Editions PPUR
-
Site internet
Ces pages internet sont dédiées à la lutte contre la traite des êtres humains. Elles répondent à la volonté de prévenir ce crime, de protéger les victimes et de poursuivre les réseaux criminels.
Il référence toutes les informations utiles à la compréhension et à la prévention de la traite des êtres humains dans le canton de Genève et donne la possibilité de télécharger et /ou commander les brochures de sensibilisation destinées aux victimes et aux témoins, disponibles en neuf langues.
Les colloques, conférences, films, festivals, etc organisés sur ce thème seront également signalés en ligne.
Contact : Fabienne Bugnon, secrétaire générale adjointe,
Lire aussi, dans la revue REISO, l’article de Fabienne Bugnon : « La déqualification des femmes issues de la migration »
- Pages internet Traite des êtres humains
-
Cet ouvrage vient de remporter le Prix Chronos 2014, prix littéraire intergénérationnel organisé par Pro Senectute.
Léo refuse d’accepter l’attitude de ses parents envers son grand-père Hippolyte. En effet, ces derniers ne s’adressent plus à lui que pour le réprimander pour ses frasques ou lui reprocher son dernier oubli en date. Parce que, de fait, à 79 ans, Hippolyte est clairement en train de perdre les pédales… mais Léo préfère l’aimer ainsi que se prendre la tête.
Quand ses parents décident de placer le vieillard dans une maison de retraite (remplie, aux dires de ce dernier, de dégénérés qui ne savent pas tenir une fourchette), Léo se révolte vraiment, et manigance avec son grand-père de partir ensemble faire un petit voyage en cachette… Ils prévoient des alibis crédibles, une carte de banque, un itinéraire, et l’aventure commence. C’est Hippolyte qui a choisi la destination : un endroit où il a séjourné durant sa jeunesse, avant son mariage, et qu’il a toujours voulu revoir.
Léo découvrira sur place que les charmes de la région ne sont pas les seuls que son grand-père voulait retrouver et que les années et les mariages de raison n’effacent pas toujours les véritables passions…
-
Le minimum vital social est au cœur de l’aide sociale et une référence centrale dans la politique sociale suisse. Il permet aux personnes en situation de pauvreté de mener une vie dans la dignité et de participer à la vie de la société. La CSIAS a élaboré un document de base qui présente la conception du système du minimum vital social dans l’aide sociale. Par ailleurs, il explique le développement et les raisons historiques de ce système.
Rappelons que, selon les normes CSIAS, le minimum vital social a pour but non seulement d’assurer la survie physique, mais également de permettre la participation à la vie sociale et professionnelle. Le minimum vital social comprend plusieurs composantes liées aux besoins : frais de logement, frais de santé, forfait pour l’entretien et prestations circonstancielles. Le minimum vital social est complété par des prestations à caractère incitatif.
La brochure en format pdf
-
La formation professionnelle, et en particulier le système dual (ou par alternance) qui combine apprentissage théorique en école professionnelle et apprentissage pratique en entreprise est le modèle dominant en Suisse et en Allemagne. Lieu de socialisation professionnelle privilégié, la formation professionnelle a cependant peu été étudiée dans une perspective féministe.
Au carrefour entre système scolaire et marché du travail, la formation professionnelle est traversée par les mécanismes de discrimination de ces deux espaces distincts, tous deux largement étudiés. L’objectif de ce numéro est de questionner la formation professionnelle comme espace propre de production du genre, dans le sens où l’enjeu est de produire de futur·e·s professionnel·le·s prêt·e·s à entrer dans un marché du travail et des professions sexuées.
Les articles abordent le système de formation professionnelle dans son ensemble, des filières spécifiques, comme les formations agricoles, les interactions en classe ou encore le choix professionnel des jeunes femmes. A partir de perspectives croisées entre France, Allemagne et Suisse, se dégagent des lignes de force. Ainsi, la conformité aux normes de genre apparaît-elle comme enjeu dès l’orientation professionnelle, mais également lors des procédures de sélection et tout au long de la formation. Les jeunes apprennent que les frontières du genre ne doivent pas être transgressées. Ces frontières leur étant en outre rappelées au travers de l’usage massif des stéréotypes et de la division sexuelle du travail. Autre élément récurrent : l’hostilité face à une présence plus massive de l’autre sexe dans les métiers. Cette peur de l’avancée en mixité permet d’expliquer la permanence du discours sur les pionnières et les pionniers, dans le champ professionnel comme dans celui de la recherche sur l’orientation et la formation professionnelle.
-
L’Allemagne négocie le tournant démographique, privilégiant le bénévolat citoyen et le soutien aux proches aidants, créant des solutions de quartier et des modèles d’habitat qui favorisent le maintien à domicile et la continuité de la vie sociale des plus âgés.
Durant trois jours, une cinquantaine de directrices et directeurs, cadres et membres des conseils et comités des EMS genevois ont participé au voyage d’étude 2013 organisé par le Fegems, entre Düsseldorf, Duisburg et Arnsberg, dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Ils ont découvert une autre réalité de la prise en charge de la personne âgée, dans un contexte où le modèle communautaire et la dimension intergénérationnelle occupent une place prépondérante.
Les Actes de ce voyage analysent le contexte, notamment les divers degrés de l’assurance « Dépendances », les expériences particulières, notamment l’accueil multiculturel à Duisburg, et des projets pilotes en matière de vie citoyenne.
Les actes en format pdf
-
De la naissance à la mort, les existences individuelles suivent des cheminements qui, loin d’être déterminés par la seule volonté ou le hasard, s’inscrivent dans des causalités sociales et psychologiques fortes. Les auteurs, psychologues et sociologues, se fondant sur de vastes enquêtes réalisées en Suisse, aux Etats-Unis et en Allemagne, apportent un éclairage original sur les « parcours de vie ».
De l’adolescence au grand âge, cet ouvrage analyse les étapes et les transitions marquant ces trajectoires, en soulignant les défis propres à chacune et les stratégies d’adaptation déployées par les individus. Si ces trajectoires sont marquées par des contraintes biologiques et le contexte historique, elles le sont tout autant par l’horloge sociale qui, tant du point de vue familial que professionnel, rappelle à chacun son heure.
De cette combinaison d’influences se dégagent, dans toute leur complexité, les « parcours de vie » caractéristiques du temps présent.
Site internet des Editions PPUR
-
La peur de souffrir, celle de ne plus se sentir respecté comme individu et celle de la perte de contrôle sont parmi les plus grandes préoccupations des malades en fin de vie. C’est pourquoi, à travers cet ouvrage, l’auteur voudrait nous aider à porter un regard lucide et serein sur la finitude de notre existence.
Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire de médecine palliative au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, s’est spécialisé dans la médecine de la fin de vie d’abord en Allemagne, puis en Suisse. Son livre est une invitation à réfléchir dans le calme et sans tabou à nos priorités, nos valeurs, nos convictions et nos espoirs, si possible dans un dialogue avec les êtres qui nous sont chers.
Au cours de notre existence, ces réflexions restent rares et nous nous y consacrons souvent tardivement. C’est notre liberté de prendre, ici et maintenant, le temps nécessaire à cette introspection.
ndlr: une 2e édition est sortie en 2017
-
Revue spécialisée
Cette édition 2014 de la revue d’égal à égalE ! apporte un éclairage particulier sur la conciliation entre emploi et famille au travers du travail à temps partiel des pères. Le titre « Temps partiel. Pour des hommes 100% performants » postule que la réduction du temps de travail des hommes contribue à une pleine performance dans tous les domaines de leur vie. Il contribue aussi à changer les mentalités dans le monde du travail, pour une meilleure répartition et un meilleur équilibre des domaines professionnel et privé. D’après les chiffres 2013 de l’Office fédéral de la statistique, 58% des femmes exerçant une activité professionnelle sont à temps partiel contre seulement 14% des hommes.
Ce 14ème numéro donne la parole aux actrices et acteurs d’institutions publiques et d’entreprises privées.
La brochure en format pdf
-

- Page d’accueil

- Trimestriel
Créée en 2002 grâce au soutien de la Fondation Leenaards, la méthode des « quartiers solidaires » menée par l’unité Travail social communautaire de Pro Senectute Vaud vise à créer, renouer, développer et entretenir les liens sociaux pour améliorer la qualité de vie et l’intégration des aînés dans un village ou un quartier. Elle encourage les habitants, et en particulier les plus âgés, à influer sur leur propre environnement, en organisant eux-mêmes des projets selon leurs besoins, ressources et envies.
Ce programme compte désormais dix-sept « quartiers solidaires » (de 3000 à 12’000 habitant·e·s) et deux « villages solidaires » (pour les communes plus petites) dans treize communes vaudoises. 300 seniors sont impliquées de manière continuelle, 3’000 participent aux projets et activités et 16’500 citoyen·ne·s sont informés.
Les « quartiers solidaires » ont désormais leur propre site internet, qui s’adresse à toute personne intéressée par le travail social communautaire. Chaque projet en cours ou abouti possède sa page, qui comporte un agenda, la liste des activités proposées et les publications dans les médias. Avec des dizaines d’articles de presse, vidéos et témoignages, le site valorise l’action des seniors dans leur quartier ou commune.
Par ailleurs, le premier numéro du trimestriel « Quartiers solidaires : regards croisés sur les pratiques communautaires vaudoises » vient de paraître. Tirée à 10’000 exemplaires, cette publication est destinée aux personnes et institutions impliquées dans les divers projets communautaires. Pour Alain Plattet, responsable de l’unité Travail social communautaire de Pro Senectute Vaud, ces deux outils désormais indispensables donnent une large place à celles et ceux qui font vivre les projets et assurent la réussite de la méthode.
-
Directives anticipées
La réactualisation de cette brochure devrait permettre de répondre à une demande constante et importante – près de 15’000 exemplaires déjà diffusés dans les éditions précédentes, tant de la part de patients que d’institutions hospitalières, d’associations ou de médecins privés.
Cette brochure, d’une cinquantaine de pages, offre des conseils pratiques pour rédiger des directives anticipées en vue d’une hospitalisation en psychiatrie et répond à des questions telles que : « Quand a-t-on perdu le discernement ? » « Quelles conditions remplir pour que vos directives anticipées soient valables et applicables ? » « A qui les communique-t-on ? » « Combien de temps sont-elles valables ? » Elle propose aussi un schéma de rédaction possible et des pistes de réflexion pour que leur rédaction soit la plus précise et exhaustive possible.
Shirin Hatam est juriste, LL.M. et titulaire du brevet d’avocate. Elle est responsable des questions juridiques chez Pro Mente Sana Suisse romande.
La brochure en format pdf