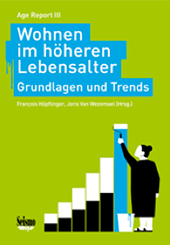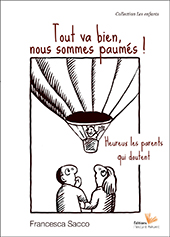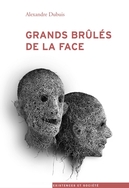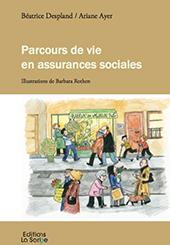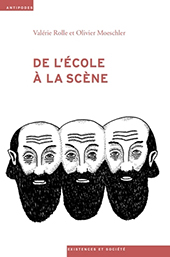Pour réunir les savoirs
et les expériences en Suisse romande
S'abonner à REISO
La liste des parutions
-
La politique des addictions est traversée par de multiples incohérences et contradictions. La consommation d’alcool dans l’espace public est perçue comme un problème mais on libéralise davantage le marché de l’alcool. D’un côté on souhaite élargir l’offre des jeux d’argent sur internet et de l’autre se profile l’abandon des ressources pour la prévention du jeu excessif. Le soutien à la production du tabac reste égal aux moyens attribués à la prévention du tabagisme, et des restrictions plus conséquentes de la publicité, telles qu’elles existent ailleurs en Europe, se heurtent encore à une opposition vigoureuse dans notre pays.
Ces incohérences ne favorisent certainement pas la crédibilité de la politique des addictions en Suisse. Celle-ci semble plutôt être conduite sur la base de positions idéologiques figées et non pas sur la base des connaissances que l’on a de son impact sur les personnes concernées, leur entourage et la société. Il importe donc de revenir à une analyse de la situation en Suisse et sur les enjeux qui lui sont liés. C’est pour répondre à ce besoin qu’Addiction Suisse publie pour la première fois un dossier de presse annuel intitulé "Panorama Suisse des Addictions". Il comprend une analyse des développements dans les domaines de l’alcool, du tabac, des drogues illicites et des jeux d’argent en Suisse.
Les chapitres :
- Moins d’alcool mais toujours beaucoup d’ivresses
- Le tabac : la baisse est-elle finie ?
- Drogues illicites : moins d’héroïne, plus d’ecstasy
- Beaucoup de jeux, beaucoup de perdants
- Accessibilité : désormais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, partout
- Certains comportements changent mais la plupart des dommages restent
- Politique : le parlement face à une opportunité historique
En savoir plus en ligne
-
Livre
Recension par Jean Martin
Une épopée, médicale et humaine mais aussi politique et organisationnelle
Cet ouvrage brosse un portrait multidimensionnel de la prise en charge de l’insuffisance rénale au cours des soixante dernières années en France. Seize témoignages ont été recueillis par les auteurs, Yvanie Caillé, ingénieure qui vit depuis l’enfance avec une maladie rénale, aujourd’hui transplantée, et Frank Martinez, médecin du service de transplantation de l’Hôpital Necker, à Paris.
Cette saga va de 1950, alors que rien ne peut être fait pour les patients urémiques qui décèdent en quelques jours ou semaines, à aujourd’hui, où des millions de personnes dans le monde suivent une dialyse chronique et où des centaines de milliers de patients ont bénéficié d’une greffe de rein. Ces chiffres ne doivent pas faire oublier les difficultés, au cours de décennies de leur propre existence, de ceux qui ont vécu des trajectoires faites de maladie, de souffrance, de hauts et de bas, d’espoirs et de déceptions. Malades qui, avec les médecins et autres scientifiques, les psychologues, les assistantes sociales, plus tard les agents coordinateurs de transplantation, sont les acteurs (les héros pourrait-on dire) de cette histoire.
Le récit de Régis Volle, 71 ans aujourd’hui, est très intéressant. Il a vécu tout un périple médical personnel et a fondé la Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux (Fnair), première association de patients concernés. « Très tôt, la Fnair a revendiqué le droit pour le malade d’être traité, d’accéder à la survie, mais aussi de choisir son traitement à partir d’éléments factuels, médicaux, pratiques, ainsi qu’en fonction de ses aspirations personnelles ».
A propos d’un malade de 77 ans qui ne veut plus du régime « officiel » de trois séances par semaine, le médecin E. Tomkiewicz s’arrange, non sans difficulté, pour qu’il ait deux séances : « Il arrive un âge où la qualité de vie et les choix du patient doivent primer sur d’autres considérations. Mais ce constat n’entre que lentement dans la culture des néphrologues. » Le même médecin : « Un autre patient avait fait le choix de deux séances par semaine. Quand il partait en vacances, le centre susceptible de l’accueillir disait : Ici c’est trois séances ou rien. Aucune souplesse, aucune adaptation, aucune réflexion. » Raisons de cette rigidité ? Pas seulement de nature médicale mais certainement aussi pour le confort des soignants et des institutions, pour ne pas bousculer les routines voire éviter de réactions de type syndical.
Parole d’une mère qui donné un rein à son fils : « J’ai vite compris que recevoir ce rein n’était pas chose aisée pour Bruno. [Son long cheminement] était probablement une nécessité pour lui. Ce temps, il en avait besoin pour accepter le don, physiquement et moralement. Il faut être généreux pour recevoir, bien plus que pour donner. C’est infiniment plus difficile. »
Sur la question, discutée en Suisse récemment encore, des modalités de consentement au don d’organe (présumé ou au contraire qui doit être explicite) : « Le don et la greffe font désormais partie des choix de notre société. S’il est essentiel de respecter les libertés individuelles, il est tout aussi important de rappeler que notre société est basée sur le principe de solidarité. Dans ce contexte, si chacun veut pouvoir bénéficier d’une greffe pour lui-même ou un de ses proches en cas de nécessité, il faut aussi que chacun soit prêt à donner le cas échéant ; il s’agit d’un altruisme du type donnant-donnant » (Dr Tenaillon). Le débat sur ce point n’est probablement pas clos !
Cette présentation de la « scène » française se situe à l’interface de la recherche médicale, des pratiques de soins, d’une médecine sociale qui cherche à atteindre tous ceux qui en ont besoin, des budgets de la santé et de dimensions humaines majeures. De plus, des notes de bas de page expliquent les termes scientifiques et font que, tout en étant de grand intérêt pour les professionnels eux-mêmes, l’ouvrage est aisément compris de tout lecteur intéressé.
Dans la conclusion, ce bémol : « Nos regards sur le passé nous incitent à ne pas nous contenter de ce qui a été acquis mais, au contraire, à continuer à progresser pour tenter de permettre aux patients de vivre mieux. Peu de très grands progrès ont été réalisés, ces vingt dernières années, dans le domaine de la dialyse. Rien qui ait modifié ses contraintes ou amélioré sensiblement la qualité ou l’espérance de vie des malades. Portant les soulager de ce fardeau, les libérer de cette ‘prison sans barreaux’, tout en faisant diminuer les coûts associés, aurait dû apparaître comme un impératif. »
Jean Martin, ancien médecin cantonal vaudoise et membre de la Commission nationale d’éthique
-
Cet article tente d’analyser l’absence apparente des femmes dans les premiers articles et émissions concernant les attentats parisiens. Cherchant cette présence dans les interstices, l’auteure montre en quoi les témoignages de femmes sont multiples dans toute leur diversité mais révèlent combien ce que procurent les femmes au monde commun est loin de toute médiatisation et est un impensé social. Quelle place occupent-elles dans le monde social s’agissant de ce qui est en premier lieu impliqué dans ces assassinats, à savoir les vulnérabilités et fragilités humaines dont celles des enfants dans un monde devenu si inhumain où la violence des rapports sociaux prédominent et se manifestent dans des gestes individuels de désespérance voire suicidaires ? Et en outre, quelle reconnaissance est faite des « mémoires et blessures cachées » de l’enfant qu’elles furent et que furent ces jeunes devenus tueurs ? Ces « blessures cachées » telles que celles vécues durant leur enfance et/ou vues vivre par leurs parents manifestent de l’absence de considération, de bienveillance et de limites dont auraient besoin les enfants dans tous les actes pédagogiques qui accompagnent leur advenue au monde social dans lequel ils sont, pour beaucoup d’entre eux, devenus surnuméraires.
En s’appuyant sur ses travaux de recherche sur la transmission intergénérationnelle et sur la prise en charges des enfants, Françoise Bloch analyse certains de ces témoignages ou récits - comme le parcours de vie des trois jeunes, devenus tueurs - et dévoile la difficulté de toute transmission dès lors que celle-ci est marquée par l’absence de considération et par l’expérience du mépris et de l’humiliation que vivent beaucoup de jeunes dont ceux des classes populaires françaises, entre autres issues de l’immigration, reléguées socialement et « racialement » dans les banlieues.
Au delà, elle s’interroge sur la désespérance sociale à l’heure du capitalisme financier et pose en préambule cette question : A quoi répondent ces assassinats perpétués par ces jeunes hommes, devenus tueurs, et par les policiers qui les ont abattus ? Il semblerait bien que nous soit renvoyé un écho foudroyant entre la violence suicidaire de ces jeunes – provoquant leurs exécutions – et le vide abyssal de sens qu’ont à l’heure actuelle la financiarisation du monde et la guerre de tous contre tous. Echo foudroyant aussi entre le monde virtuel dans lequel vivent les financiers et autres traders, un monde sans limite, et celui dans lequel vivaient ces jeunes, qui ne connurent de limites que celle des armes qui les abattirent.
L’analyse en format pdf
-
Comment expliquer que certains d’entre nous soient homosexuels, d’autres hétérosexuels et plusieurs plus ou moins bisexuels ? D’où vient notre orientation sexuelle, et l’homosexualité en particulier ? Est-elle normale ? Contre nature ? Naît-on ainsi ? Résulte-t-elle de déterminismes biologiques ? De l’éducation familiale ? D’expériences précoces ? S’agirait-il plutôt d’un choix ? Et pourquoi certains sont-ils homophobes ?
L’étendue de l’ignorance en matière d’orientation sexuelle est, encore de nos jours, aussi consternante que regrettable, et notre système d’éducation ne semble pas vouloir remédier à la situation. L’information existe pourtant mais, selon toute apparence, elle est encore très mal diffusée et, lorsqu’elle l’est, souvent confuse. C’est pourquoi l’auteur propose ici une présentation à la fois synthétique et vivante des connaissances actuelles. Ce livre s’adresse à quiconque s’intéresse à ces questions qui, pourtant, nous concernent tous.
Patrick Doucet enseigne la psychologie au collège Marie-Victorin (Montréal). Grand voyageur, il est également l’auteur d’un conte, Foucault et les extraterrestres (Triptyque, 2010) ainsi que de récits de voyage, La tentation du monde (Espaces, 2007)
01.09.2015 : ce livre sorti au Canada au printemps est désormais aussi disponible en Europe.
Site internet Ediitions Liber
-
La Confédération, les cantons, les villes et les communes mettent en œuvre, de 2011 à 2015, le programme national de prévention « Jeunes et violence ». Ce programme a pour but d’élaborer une base de connaissances commune dans le domaine de la prévention de la violence juvénile. Parallèlement, avec le soutien de l’Office fédéral des assurances sociales, de l’Oak Fondation et de la fondation UBS Optimus, le Fonds suisse pour des projets de protection de l’enfance s’est fixé pour mission d’identifier, d’encourager et de diffuser des approches d’excellence, prometteuses dans le domaine de la prévention de la violence envers les enfants.
Les responsables des deux programmes ont publié une synthèse rassemblant les connaissances scientifiques internationales.
Le présent rapport livre ainsi pour la première fois un aperçu des vingt-six principales approches de prévention aux niveaux de l’individu, de la famille, de l’école, de l’espace social et de l’aide aux victimes. Reposant sur des bases scientifiques, il expose en termes concis les conditions nécessaires pour que les approches préventives aient des chances d’aboutir, décrit les facteurs influençant leur efficacité et présente la situation actuelle en Suisse. Ainsi, les responsables de la prévention de la violence actifs sur le terrain ou dans le monde politique pourront s’en servir comme d’une boussole ou d’un guide pour le choix, la mise en œuvre et l’adaptation des mesures concrètes. En un mot, ce rapport entend contribuer au développement d’une prévention efficace de la violence en Suisse.
-
Basée à Zurich, la Fondation Age vient de publier son rapport sur l’habitat des seniors. Cette troisième édition du Age Report est l’aboutissement d’une large enquête, réalisée en 2013, pour connaître les besoins et les conditions cadres en matière d’habitat des personnes âgées en Suisse alémanique. Cette démarche ayant été initiée en 2003, nous disposons aujourd’hui d’une vision sur 10 ans. Et si les aspirations en matière de logement n’ont pas fondamentalement évolué, on voit poindre de nouvelles exigences de la part des baby-boomers qui arrivent désormais au seuil du troisième âge et entendent prendre une part active à la définition de leurs modes de vie. Une invitation à la réflexion, au dialogue et à l’action pour tous les partenaires concernés !
Quelques constats :
- Le modèle de la colocation entre seniors, souvent gratifié d’un brillant avenir comme réponse aux attentes des soixante-huitards, ne semble pas tellement les séduire.
- Les baby-boomers ne rechignent pas à déménager si le déménagement apporte des avantages évidents.
- Les personnes âgées contraintes d’ajuster leur habitat en raison d’une diminution de leurs capacités physiques sont les plus pénalisées. Pour rester indépendantes, elles recherchent des petits logements adaptés mais ils font défaut sur le marché du logement.
- L’attitude vis-à-vis des EMS a évolué : ils sont prioritairement considérées comme un mode d’habitat destiné aux personnes dépendantes du quatrième âge.
Site internet Editions Seismo
-
Article spécialisé
Cette recherche a obtenu le Premier Prix du concours « Medical humanities » des Académies suisses des sciences.
Cette recherche qualitative regroupe trois études menées dans une collaboration entre chercheurs des sciences humaines et sociales de la HES-SO et des professionnels d’un service d’oncologie autour de la population âgée atteinte de cancer.
Les résultats ont pour but de contribuer à une meilleure connaissance du champ de l’oncogériatrie et d’élargir la perspective médico-soignante aux aspects de la sociologie et de l’anthropologie. Ils ébranlent entre autres les représentations du cancer et de la vieillesse, et ainsi différents changements dans la pratique oncologique du service partenaire ont été possibles.
Le cancer n’est plus toujours synonyme de souffrance et de mort. Les patients traités restent actifs et l’autonomie et l’indépendance sont importantes pour la personne malade. Il s’agit de maintenir le dialogue entre les approches médico-soignantes et les sciences sociales pour mieux comprendre les problématiques spécifiques à cette population.
L’article en format pdf
-
Les enfants et les jeunes évoluent de plus en plus dans un monde marqué par la culture de la consommation. Il faut être bien armé pour y trouver ses marques, éviter d’être manipulé par la publicité et ne pas tomber dans le piège de l’endettement. Comment les enfants et les jeunes relèvent-ils ces défis ? Comment sont-ils courtisés par la publicité ? Comment acquièrent-ils un comportement réfléchi en matière d’argent et de consommation ?
Ces questions, parmi d’autres, sont au cœur du rapport qui vient d’être publié par la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ) sous le titre « Critiques ou manipulés ? Pour de jeunes consommateurs responsables ».
Le rapport fournit un éclairage sur les questions relatives à l’argent et à la consommation en les abordant sous différents angles : apprentissage de la gestion de l’argent et de la consommation par les enfants et les jeunes, stratégies publicitaires, facteurs d’endettement, mais aussi facteurs de protection et bonnes pratiques en matière de prévention de l’endettement. Les textes de ce rapport ont été rédigés par des spécialistes du marketing, de la protection des consommateurs, de la prévention et de la recherche.
Les enfants et les jeunes ont eux aussi pu exprimer leur vision de manière créative au moyen de courts-métrages. Réalisés pour un concours organisé par la CFEJ, ceux-ci sont présentés dans le rapport.
Sur la base de ce rapport et du séminaire qui s’est tenu à Bienne en 2013, la CFEJ a formulé six recommandations concrètes à l’adresse du monde politique, de l’économie et de la société. Elle demande notamment de développer assez tôt les compétences des jeunes en matière de consommation, car de jeunes consommateurs informés, critiques et aptes à prendre leurs propres décisions maîtrisent mieux leur quotidien.
-
Revue spécialisée
Le nombre d’ayants droit qui n’ont pas recours aux diverses prestations sociales ou prestations de santé semble important dans l’ensemble des pays occidentaux. L’information à ce propos est peu établie et mal diffusée. C’est au contraire l’impression d’abus dans les prestations qui domine dans les représentations sociales et les discours politiques. Le non-accès aux prestations publiques, en particulier dans les domaines de la santé et du social est un problème relativement peu traité dans la littérature scientifique.
Ce numéro tente d’éclairer cette question sous divers aspects en décryptant certains des mécanismes en cause et en cherchant à montrer sur différents registres les risques sociaux encourus. Les auteurs, de disciplines variées, mettent au jour des logiques politiques qui peuvent expliquer les difficultés d’accessibilité aux services, des obstacles qui se dressent sur le chemin de ceux pour lesquels les dispositifs sont pensés, ainsi que des dispositifs innovants pour les dépasser.
Présentation du thème en format pdf. Site de la revue Les Politiques Sociales
Résumés des articles en format pdf
-
Les cafés sexologiques sont un lieu idéal pour communiquer et améliorer la compréhension entre hommes et femmes.
Ils permettent de poser des questions, de parler de ses appréhensions et difficultés avec d’autres et de reprendre confiance en soi en trouvant des moyens pour apprivoiser et surmonter ses craintes face à la sexualité.
La médiatique sexologue Juliette Buffat explique comment se déroulent ces rencontres d’un nouveau type, en les illustrant avec des dialogues rebondissant entre différents participants.
Elle aborde ainsi un large éventail de thématiques liées à la sexualité : différences de libido entre hommes et femmes, masturbation, orgasme, infidélité, sexualité des seniors, etc.
Site internet Editions Favre
-
Livre
Comme il est difficile d’être parent aujourd’hui : mon enfant va-t-il réussir à l’école, sera-t-il heureux dans sa vie adulte, puis-je lui éviter de faire des erreurs ?
Les éducateurs qui sont à l’origine de ce livre ont longtemps été tentés de trouver des stratégies pour maîtriser ces risques, mais on ne peut pas « contrôler » les jeunes. Cette impuissance n’est pas un signe de défaut de maîtrise, et encore moins d’échec. Il s’agit tout simplement de la réalité !
C’est justement en partant de ce constat que les éducateurs ont pu commencer à oser prendre le risque de restituer aux jeunes la possibilité de faire usage de leur libre-arbitre. Il n’y a pas d’apprentissage de l’indépendance pour les jeunes, sans prise de risques éducatifs pour les adultes. L’expérience qu’ils ont voulu raconter dans ce livre est celle d’un changement profond dans leur manière d’aborder l’éducation. Et plus exactement d’un changement d’état d’esprit qui se traduit par une attitude de non-jugement et de bienveillance.
Ce livre est le résultat d’une immersion au foyer du Grand-Saconnex, géré par la Fondation Officielle de la Jeunesse (FOJ). L’équipe éducative composée alors de Bruno Chevrey, Sandro Reginelli, Bastien Carrillo, Isabelle Aurora, Frank Wunderlich, Geneviève Gilliand, Florence Crisinel, Patricia Cerqueira d’Onofrio et Mireille Chenevard a ouvert les portes du foyer à la journaliste indépendante Francesca Sacco afin de restituer sur papier l’expérience faite avec une nouvelle méthode éducative basée sur la prise de risque.
Francesca Sacco est journaliste indépendante et correspondante pour une dizaine de journaux suisses et français. La Fondation Officielle de la Jeunesse lui a laissé carte blanche pour la rédaction de ce livre.
Editions L’Instant Présent
-
Prise de position
Nous sommes professeurs en Seine-Saint-Denis. Intellectuels, adultes, libertaires, nous avons appris à nous passer de Dieu et à détester le pouvoir. Nous n’avons pas d’autre maître que le savoir. Ce discours nous rassure et notre statut social le légitime. Ceux de Charlie Hebdo nous faisaient rire ; nous partagions leurs valeurs. En cela, cet attentat nous prend pour cible. Même si aucun d’entre nous n’a jamais eu le courage de tant d’insolence, nous sommes meurtris. Nous sommes Charlie pour cela.
Mais faisons l’effort d’un changement de point de vue, et tâchons de nous regarder comme nos élèves nous voient. Nous sommes bien habillés, confortablement chaussés, ou alors très évidemment au-delà de ces contingences matérielles qui font que nous ne bavons pas d’envie sur les objets de consommation dont rêvent nos élèves : si nous ne les possédons pas, c’est peut-être aussi parce que nous aurions les moyens de les posséder.
Nous partons en vacances, nous vivons au milieu des livres, nous fréquentons des gens courtois et raffinés. Nous considérons comme acquis que La Liberté guidant le peuple et Candide font partie du patrimoine de l’humanité. On nous dira que l’universel est de droit, et non de fait, et que de nombreux habitants de cette planète ne connaissent pas Voltaire ? Quelle bande d’ignares… Il est temps qu’ils entrent dans l’Histoire : le discours de Dakar le leur a déjà expliqué. Quant à ceux qui viennent d’ailleurs et vivent parmi nous, qu’ils se taisent et obtempèrent.
Des crimes odieux qui parlent français
Si les crimes commis par ces assassins sont odieux, ce qui est terrible, c’est qu’ils parlent français, avec l’accent des jeunes de banlieue. Ces deux assassins sont comme nos élèves. Le traumatisme, pour nous, c’est aussi d’entendre cette voix, cet accent, ces mots. Voilà ce qui nous a fait nous sentir responsables.
Nous, c’est-à-dire les fonctionnaires d’un Etat défaillant, nous, les professeurs d’une école qui a laissé ces deux-là et tant d’autres sur le bord du chemin des valeurs républicaines, nous, citoyens français qui passons notre temps à nous plaindre de la hausse des impôts, nous contribuables qui profitons des niches fiscales quand nous le pouvons, nous qui avons laissé l’individu l’emporter sur le collectif, nous qui ne faisons pas de politique ou raillons ceux qui en font, etc. : nous sommes responsables de cette situation.
Ceux de Charlie Hebdo étaient nos frères, tout comme l’étaient les juifs tués pour leur religion, porte de Vincennes, à Paris : nous les pleurons. Leurs assassins étaient orphelins, placés en foyer : pupilles de la nation, enfants de France. Nos enfants ont donc tué nos frères. Telle est l’exacte définition de la tragédie. Dans quelque culture que ce soit, cela provoque ce sentiment qui n’est jamais évoqué depuis quelques jours : la honte.
Dire la honte, en assumer la responsabilité
Alors, nous disons notre honte. Honte et colère : voilà une situation psychologique bien plus inconfortable que chagrin et colère. Si on a du chagrin et de la colère, on peut accuser les autres. Mais comment faire quand on a honte et qu’on est en colère contre les assassins, mais aussi contre soi ?
Personne, dans les médias, ne dit cette honte. Personne ne semble vouloir en assumer la responsabilité. Celle d’un Etat qui laisse des imbéciles et des psychotiques croupir en prison et devenir le jouet des manipulateurs, celle d’une école qu’on prive de moyens et de soutien, celle d’une politique de la ville qui parque les esclaves (sans papiers, sans carte d’électeur, sans nom, sans dents) dans des cloaques de banlieue. Celle d’une classe politique qui n’a pas compris que la vertu ne s’enseigne que par l’exemple.
Nous sommes aussi les parents de trois assassins
Intellectuels, penseurs, universitaires, artistes, journalistes : nous avons vu mourir des hommes qui étaient des nôtres. Ceux qui les ont tués sont enfants de France. Alors, ouvrons les yeux sur la situation, pour comprendre comment on en arrive là, pour agir et construire une société débarrassée du racisme et de l’antisémitisme, laïque et cultivée, plus juste, plus libre, plus égale, plus fraternelle.
« Nous sommes tous Charlie, juifs, policiers… », peut-on porter au revers. Mais s’affirmer dans la solidarité avec les victimes ne nous exemptera pas de la responsabilité collective de ce meurtre. Nous sommes aussi les parents de trois assassins.
Catherine Robert, Isabelle Richer, Valérie Louys et Damien Boussard
Publié notamment par le blog du Monde Diplomatique « Nouvelles d’Orient », le 12 janvier 2015, et par Le Monde du 13 janvier.
-
Livre
À en croire les fictions cinématographiques et littéraires, les personnages affligés par une défiguration sont placés devant un cruel dilemme : se cacher, ou du moins dissimuler leur disgrâce, ou, plus rarement, l’afficher ostensiblement.
Or, les progrès de la médecine permettent de sauver un plus grand nombre de grands accidentés, même s’ils sont presque entièrement brûlés. On pourrait alors penser que la médecine ne se préoccupe guère de la vie posthospitalisation.
À dire vrai, on ne dispose que de peu de données sur le vécu des personnes défigurées. Ce livre comble cette lacune en laissant une large place aux propos de celles et ceux qui ont vécu une atteinte sévère de la face ; il permet ainsi au lecteur "d’endosser" la perspective de qui est regardé, stigmatisé, de se placer donc en rupture avec le point de vue plus habituel et banal de celui qui regarde.
Si l’attention s’est portée sur l’expérience vécue de grands brûlés de la face, elle n’est pas "confinée" à ce groupe. Ce livre s’ouvre à toute personne, tout groupe d’individus stigmatisés dérogeant temporairement ou de manière permanente à une norme corporelle.
Site internet Antipodes
-
Dossier spécialisé
Le revenu de base inconditionnel consiste en une allocation mensuelle, versée à chaque citoyen, suffisante pour permettre une existence digne. Le revenu de base se substitue jusqu’à hauteur de son montant aux revenus de l’activité lucrative ou aux prestations sociales qu’il remplace. Octroyé sans condition, il rend inutiles les mesures de contrôle. Il permet une répartition de l’emploi choisie plutôt que subie, n’induit aucun effet de seuil freinant l’insertion professionnelle et encourage l’esprit d’entreprise.
Au sommaire :
- Quel montant du revenu de base ?
- Pourquoi aujourd’hui ?
- Est-il juste que tout le monde ait de l’argent sans rien faire ?
- Avantages attendus d’un revenu de base
- Financement
- Qui voudra encore travailler ?
- Mesures transitoires
Télécharger le dossier en format pdf
-
Ce petit guide pratique regroupe une foule de bons plans et adresses pour manger, s’habiller ou se divertir à moindre frais à Genève. La brochure, qui n’existait jusqu’ici qu’en format électronique, est désormais distribuée dans les tous les lieux d’accueil de l’Hospice général.
Les rubriques de ce guide :
Alimentation
- Denrées alimentaires bon marché
- Ateliers de cuisine : bien manger à petits prix
Seconde main
- Vêtements, meubles, livres …
- Trocs & vide-greniers
- Informatique
Culture & loisirs, vacances
- Culture & loisirs
- Transports
- Vacances
Consommation alternative
- Réseaux d’échanges et de savoirs
- Objets gratuits
Conseils budget
Divers
- Coiffure et manucure à petits prix
- Wi-fi Internet gratuit
- Communes et mairies
La brochure en format pdf
-
Revue spécialisée
Le 150ème numéro de Vivre Ensemble a traduit en français l’analyse de Peter Sutherland, président de la London School of Economics, qui rejoint précisément ce qui fait la raison d’être de Vivre Ensemble : informer, fournir des éléments factuels et une analyse alternative au brouhaha politique et médiatique. Quelques extraits.
Trop d’immigrés ?
- Interrogés sur la question de savoir si les États-Unis hébergeaient un trop grand nombre d’immigrés, 38% des répondants américains ont répondu par l’affirmative. Or, lorsqu’on les informe sur le nombre exact d’étrangers résidant effectivement aux États-Unis avant de leur poser la question fatidique, leur opinion se révèle significativement différente : seuls 21 % considèrent alors les immigrés comme trop nombreux.
- Au Royaume-Uni, 54 % des premiers répondants ont affirmé déplorer un trop grand nombre d’étrangers ; ce pourcentage passe à 31% dès lors que les répondants connaissent les chiffres exacts.
- En Grèce, on observe un passage de 58 % à 27 %.
- En Italie, le chiffre passe de 44 % à 22 %, etc.
Combien d’immigrés ?
- Au Royaume-Uni, le citoyen lambda estime en moyenne à 34 % la proportion de résidents britanniques immigrés ; le chiffre exact s’élève tout juste à 11 %. (…)
Des faits, des faits, des faits…
- Conclusion de Peter Sutherland : « L’existence d’un débat public informé constitue la condition sine qua non de tout régime démocratique. En son absence, préjugés et populisme sont voués à l’emporter. Le débat sur l’immigration ne sera jamais une discussion facile, mais il a vocation à se révéler moins tendancieux et plus ouvert lorsque ses participants y intègrent la réalité des faits. »
Couverture de cette édition spéciale : Ambroise Héritier.
L’article en anglais de Peter Sutherland sur cette page du site Project Syndicate, The World’s Opinion Page.
-
L’analyse de Mme Zbinden Sapin met en lumière certaines pratiques intéressantes et le chemin restant à parcourir pour offrir une prise en charge tout à fait adaptée aux besoins d’adultes atteints d’autisme et souffrant de graves troubles du comportement.
La Maison de Trey est un projet pilote de prise en charge adaptée aux adultes atteints d’autisme et/ ou souffrant de graves troubles du comportement. Cette structure, ouverte 365 jours par année et 24h sur 24 a pour objectif de proposer une pédagogie de type TEACCH, en vue de diminuer les troubles du comportement et les hospitalisations en milieu psychiatrique. Ce foyer est l’aboutissement d’un long combat mené par Solidarité-Handicap mental pour améliorer la qualité de vie des personnes avec autisme, favoriser une meilleure compréhension des troubles du comportement.
Ouverte en 2009, la Maison de Trey accueille six jeunes adultes. Elle est soutenue et subventionnée par le Service de Prévoyance et d’Aides Sociales du Département vaudois de la Santé et de l’Action sociale.
Quatre années après avoir créé la Maison de Trey et géré son fonctionnement, Solidarité Handicap mental en a transmis la gestion à la Fondation de Vernand qui en assume la responsabilité depuis le 1er janvier 2014.
Sur ce thème, voir aussi la présentation du livre « Pour en finir avec les malheurs de Sophie », sur cette page de REISO.
Le rapport en format pdf
-
Accident, maladie, mort, deuil ou encore exil nous écorchent, nous brisent parfois, nous déstructurent. Dans ces circonstances, l’être humain peut perdre le fil de sa propre existence et se perdre dans les méandres de la maladie et des différents systèmes de santé.
Le sens de l’existence oublié, effacé, l’être humain, le malade, ne se comprend plus. Dans cet essai collectif, les auteurs réunis autour de Jacques Quintin parlent du besoin qu’a l’homme de se raconter face à l’adversité pour redevenir l’auteur de sa vie. Et la présence du professionnel de la santé produit une différence puisqu’il a la capacité de faire apparaître ce qui n’apparaît pas encore : un sens à une histoire de vie. Il ne fait rien d’autre que des gestes tout simples qui aident l’être humain à se tenir debout dans le temps qui passe et qui bouscule.
« La parole est le propre de l’homme. Elle lui permet de dire ce qui est et ce qui n’est pas. Le problème est que les mots sont terriblement imparfaits (…). Qu’en est-il lorsque les êtres humains racontent leur vie ? Là aussi, ils utilisent des mots imparfaits. Dans une relation de soin, ils les utilisent pour se faire connaître, établir un lien, arriver à une intelligence commune. Mais l’essentiel est que narrer sa vie c’est la créer. Les mots imparfaits que j’utilise pour parler de moi sont créateurs d’un autre moi. Nul ne sait totalement ce qu’il est. Lorsque l’homme se raconte, il découvre dans les interstices des mots cet autre lui-même qu’il ne connaît pas et qui surgit de l’imperfection des mots. En se racontant, il advient. Et lorsque, en tant que soignant, on se met à l’écoute du soigné qui se raconte, ce n’est pas là un simple acte d’écoute, mais un acte catalyseur de création. » Extrait de la préface de Gilles Voyer.
Site internet Editions Liber
-
Phénomène tabou, méconnu, où les cas dénoncés ne représentent que la pointe de l’iceberg, la violence domestique est une réalité vécue par un trop grand nombre de personnes. Un chiffre : vingt-quatre, c’est le nombre de victimes décédées, en Suisse l’an passé, d’un homicide dans un contexte domestique. “Je suis passée très très prêt de la mort. La situation s’est dégradée de plus en plus, jusqu’au jour où il m’a fait comprendre que c’était fini, qu’il allait s’occuper de moi”, raconte Liria*. Cette jeune maman de 30 ans a été la victime des coups de son conjoint pendant deux ans. “La mort ne me faisait plus peur. Mourir sous ses coups, oui, mais la mort elle-même, non. Lorsque l’on vit ça, mourir c’est une délivrance !”.
En Valais, chaque année, environ 250 auteurs de violences conjugales sont identifiés par la Police et quelque 400 personnes s’adressent aux centres LAVI (Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions). Depuis 2004, les centres de Monthey, Sion et Brigue, voient leurs fréquentations augmenter. “ Ce n’est pas évident d’interpréter ces chiffres. Nous ne pouvons pas savoir si c’est le nombre de personnes qui osent venir nous en parler qui est en augmentation ou si c’est le nombre de cas de violences conjugales qui augmente”, observe une professionnelle, intervenante LAVI.
Derrière la froideur de ces chiffres se cache une réalité qui se traduit notamment par des insultes, des menaces, des humiliations, des contraintes ou des coups. Les femmes en sont les principales victimes ? Pour Suzanne Lorenz, professeure à la HES-SO Valais, cette question fait l’objet de beaucoup de controverse. “En Suisse, nous avons plusieurs études qui montrent que les femmes sont les principales victimes de la violence conjugale. Quand on regarde les statistiques qui viennent de la justice et de la police, c’est le même constat. En cas d’homicide, en Suisse, il y a en moyenne vingt-deux femmes qui meurent chaque année de leur partenaire, contre 4 hommes.”
La violence conjugale n’est pas une fatalité. Il faut avoir le courage de la dénoncer. C’est ce qu’ont fait deux mamans. A travers leurs témoignages, ce nouveau numéro de “Cosmopolis” tente de délivrer un message de prévention. Il est important d’agir en amont. Tout d’abord chez les auteurs, avant qu’ils ne commettent des actes plus graves, et auprès des jeunes qui ont vécu des situations afin d’éviter qu’ils reproduisent les mêmes gestes lorsqu’ils seront adultes. Et puis surtout, il est important de détecter précocement les comportements à risque. Si aujourd’hui ce phénomène touche majoritairement les femmes, le message de prévention délivré dans cette émission peut également toucher des hommes maltraités par leur partenaire.
*Prénom modifié
Page internet Cosmopolis
-
Un ouvrage tout public (avec tout de même des références légales en aparté et dans le cd-rom), qui met en scènes 8 familles habitant la Rue Ludwig-Forrer, rue imaginaire dans une ville romande imaginaire, mais familière. Les familles parcourent la vie et ses aléas dans 52 situations posant des questions d’assurances sociales et parfois de droit du travail.
Elles nous effrayent, nous déconcertent et paraissent opaques. Et pourtant, les assurances sociales font partie de notre quotidien. Pour les apprivoiser, les auteures, juristes, proposent une démarche originale, accessible à tous, fondée sur des situations concrètes vécues par les membres, proches ou lointains, de huit familles imaginaires, dans lesquelles chacun peut se retrouver. Les personnages du livre connaissent les aléas de la vie, des plus anodins aux plus graves, des plus heureux aux plus tristes.
L’ouvrage s’articule autour de cinquante-deux situations de la vie courante, qui soulèvent des problèmes d’assurances sociales. Les lecteurs trouveront, dans l’ouvrage, des énoncés de solutions qui leur permettront de répondre aux questions posées par les situations et, dans le CD-Rom annexé, les références légales applicables.
Béatrice Despland et Ariane Ayer sont toutes deux docteures en droit et ont une expérience dans l’enseignement de la législation sociale. Elles ont collaboré à de nombreuses recherches scientifiques dans le domaine des assurances sociales. Elles ont eu l’occasion de travailler ensemble quelques années et de publier plusieurs ouvrages consacrés essentiellement à l’assurance-maladie.
L’idée du présent ouvrage s’est développée à partir de situations de la pratique, de la nécessité d’illustrer les assurances sociales pour les enseigner et de la volonté de transmettre cette matière à un large public.
Préface de Pierre-Yves Maillard, conseiller d’Etat
Site internet Editions La Sarine
-
Il s’agit du récit croisé des différents protagonistes qui ont œuvré à la liberté retrouvée d’une jeune femme atteinte d’autisme. Au moment où cette histoire commence, Sophie (nous l’avons appelée ainsi) vit à l’hôpital, attachée depuis presque deux ans. Plusieurs médecins prétendent qu’elle ne pourra jamais vivre détachée et d’aucuns vont même jusqu’à demander qu’une exception soit prévue dans les directives légiférant les mesures de contrainte : une exception qui permette de contenir Sophie à jamais, devenue dans le jargon des spécialistes, « une situation extrême ».
Les auteur·e·s :
- François Grasset (ancien médecin-chef responsable du DCPHM / CHUV)
- Marion Guichardière (éducatrice sociale à la Fondation Vernand et membre de l’équipe Projacind accompagnant Sophie)
- Jean-Louis Korpes (professeur à la Haute Ecole fribourgeoise de travail social et administrateur de la Fondation Vernand)
- Isabel Messer (secrétaire générale de Solidarité-Handicap mental)
- Mireille Scholder (directrice de la Fondation Vernand)
- Erwan Ugo (éducateur social à la Fondation Vernand et chef de projet pour Projacind)
Préface de Pierre-Yves Maillard
Editions Alphil
-
Lors de la Journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre 2014, les vingt-deux associations membres de Forum Handicap Vaud ont annoncé la couleur de leurs prestations à la fois particulières et complémentaires. L’événement a eu lieu sur les escaliers du Palais de Rumine où le Grand Conseil siégeait.
Les associations membres : ASRIM, Association Romande Trisomie 21, Autisme Suisse Romande, AVIVO Lausanne, Cap-Contact, Cerebral Vaud, CORAASP, Eclipse, Fédération Suisse des Aveugles, Fondation Coup d’Pouce, forom écoute, Fragile Vaud, GERSAM, Graap-Fondation, Insieme Vaud, Intégration Pour Tous, Pro Infirmis Vaud, Procap Lausanne et environs, Procap Nord Vaudois, Société suisse de la sclérose en plaques, Solidarité-Handicap mental, Vaincre les Maladies Lysosonales.
La plaquette de présentation des associations est déclinée à la façon d’une gamme Pantone pour montrer les spécificités de chaque association et le but collectif commun. D’un côté de la gamme, les informations pratiques, de l’autre des citations et témoignages personnels.
Commander la plaquette auprès de Forum Handicap Vaud
-
Depuis le mouvement de tertiarisation des formations supérieures, la question de "l’insertion professionnelle" a gagné en importance. La situation dans les professions artistiques reste peu investiguée. Comment comprendre alors le formidable pouvoir d’appel exercé par ces métiers pourtant réputés précaires ?
Au travers du cas des comédiens et des comédiennes issu·e·s de la Manufacture, seule haute école de théâtre active en Suisse romande, cet ouvrage prend le parti d’interroger le phénomène, non pas comme un problème politique ou économique, mais sous un angle sociologique, existentiel et critique.
Détenir un titre de haute école spécialisée fait-il une différence sur le marché ? Y a-t-il des stratégies et des circonstances d’entrée dans le métier respectivement plus payantes ou favorables que d’autres ? Bref, comment s’en sortir ? Et comment garder foi et goût dans le théâtre alors que le maintien en emploi demeure plus qu’incertain ?
En examinant les conditions structurelles, institutionnelles et individuelles d’arrivée dans le métier, ce sont les configurations et les profils spécifiques aux débuts de carrière dans un univers artistique à la fois saturé et toujours en quête de sang neuf que ce livre propose de mettre au jour.
Valérie Rolle est sociologue, rattachée à l’Université de Lausanne. Elle s’intéresse à la structuration des marchés et des carrières dans des métiers situés aux frontières de l’art, de l’artisanat et des services. Elle a publié L’art de tatouer. La pratique d’un métier créatif (Éditions de la Maison des sciences de l’homme).
Olivier Moeschler est sociologue et chercheur associé à l’Université de Lausanne. Ses travaux portent sur la culture, les pratiques et les politiques culturelles. Il a publié Cinéma suisse. Une politique culturelle en action (PPUR), Nouveaux regards sur les pratiques culturelles (éd. avec André Ducret, L’Harmattan), et un ouvrage sur l’art en public, Kunst und Öffentlichkeit (avec Dagmar Danko et Florian Schumacher, Schüren).
Site internet Editions Antipodes
-
Statistiques
En 2012, près d’une personne sur trois de 15 ans et plus était en surpoids et une sur dix était obèse. La prévalence de l’obésité a pratiquement doublé ces vingt dernières années (5,4% en 1992 contre 10,3% en 2012) (G1). Cette tendance se retrouve dans tous les pays industrialisés occidentaux. Si la Suisse affiche certes des valeurs faibles par rapport aux autres pays, ses taux de croissance figurent parmi les plus élevés.
Profonds écarts socio-économiques
Les groupes de population avec un faible niveau de formation et de bas revenus sont plus souvent affectés par le surpoids et l’obésité (G 4). Ce gradient social se fait nette- ment plus sentir chez les femmes que chez les hommes : les femmes dont le niveau de formation ne dépasse pas l’école obligatoire ont un risque 3,6 fois plus élevé d’être obèses et 2,5 fois plus élevé d’être en surpoids que les femmes ayant achevé une formation tertiaire.
La synthèse en format pdf
-
La charte de l’ASSM s’adresse en priorité aux professionnels, aux associations et aux institutions du système de santé ; elle entend refléter l’esprit de coopération des professionnels de la santé et constitue la base du virage culturel souhaité.
Les patients se situent au cœur de la prise en charge. Cela signifie que les prestations éducatives, consultatives, préventives, diagnostiques, thérapeutiques, soignantes, réhabilitatives et palliatives de tous les professionnels de la santé impliqués doivent être coordonnées. La responsabilité est assumée selon les compétences professionnelles. L’information réciproque est garantie à tout moment ; le travail est basé sur le respect mutuel et sur des standards reconnus et définis de concert.
Le premier des neuf éléments-clés de la charte ? « La collaboration interprofessionnelle inclut le patient comme partenaire. »
La charte en format pdf
Les annonces du réseau
L'affiche de la semaine
 Bureaux partagés en sous-location à Lausanne-centre, dans un environnement propice aux échanges et aux synergies, notamment avec des associations axées sur la famille. (image : © Freepik)
Bureaux partagés en sous-location à Lausanne-centre, dans un environnement propice aux échanges et aux synergies, notamment avec des associations axées sur la famille. (image : © Freepik)