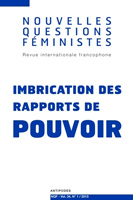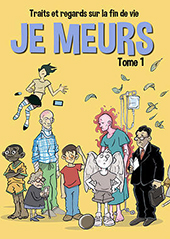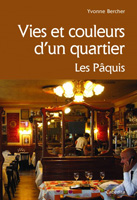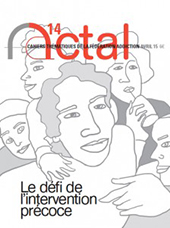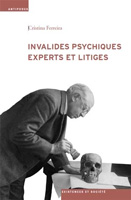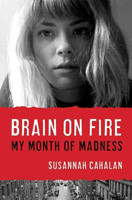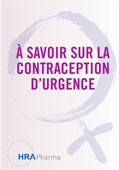Pour réunir les savoirs
et les expériences en Suisse romande
S'abonner à REISO
La liste des parutions
-
À l’appui du Black Feminism et des Postcolonial Studies, les études féministes francophones se sont réorientées vers une analyse des discriminations spécifiques que vivent les femmes selon des marqueurs sociaux tels que leur origine, leur couleur, leur culture, leur classe sociale, leur âge, etc. Dans un contexte professionnel par exemple, en quoi le vécu d’une femme maghrébine confrontée à des discriminations à la fois sexistes et racistes diffère-t-il de celui d’une de ses collègues blanches ?
Considérant que les femmes ne constituent pas une catégorie homogène, la recherche féministe vise désormais à prendre en compte les effets d’autres systèmes d’oppression que le genre et à analyser leur imbrication. Le Grand angle de ce numéro est consacré à des recherches empiriques illustrant comment fonctionne l’imbrication des rapports de pouvoir. De tels rapports divisent parfois les femmes, y compris les féministes, ce que montre l’article de Nouria Ouali avec une analyse du racisme imprégnant les discours et l’organisation du mouvement féministe bruxellois. Dans un domaine différent et en France cette fois, Lucile Ruault déplace notre regard sur un autre rapport de pouvoir : l’âge, et montre comment les gynécologues normalisent les parcours de vie des femmes et leur sexualité à l’intersection des rapports sociaux de sexe et d’âge. Le troisième article, de Salima Amari, interroge les liens entre le genre et le lesbianisme et en décline les différentes configurations à partir du rapport que des lesbiennes entretiennent avec leur famille en France. Sa contribution nuance le célèbre postulat de Monique Wittig selon lequel "les lesbiennes ne sont pas des femmes". Avec des données quantitatives recueillies en Suisse, le dernier auteur du Grand angle, Jonathan Fernandez, propose de considérer le spécisme (division hiérarchique entre humains et animaux) comme un système d’oppression fonctionnant selon les mêmes logiques que le sexisme et le racisme. Les quatre articles permettent ainsi de réfléchir aux manières dont les différents rapports de pouvoir se renforcent mutuellement ou, au contraire, comment l’un d’entre eux peut atténuer les effets d’un autre.
-
La participation des jeunes à la vie publique et leur statut de citoyen sont des sujets fréquemment mis sur le devant de la scène, que ce soit aux niveaux local, national ou international. Partant de ces déclarations d’intentions, les actions menées sur le terrain permettent-elles une participation réelle et une citoyenneté active ?
- Quels sont les enjeux aux niveaux du vivre-ensemble, de la cohésion sociale, de la démocratie ?
- Quel est le rôle du travail social ?
- Comment le jeune perçoit-il ses propres actions dans ce processus ?
En prenant le Conseil delémontain des jeunes comme terrain d’analyse, cet ouvrage propose des pistes de compréhension et d’action concrètes pour la pratique professionnelle.
Site internet des Editions EESP
-
Le professeur Stephan Eliez reçoit depuis plus de vingt ans des parents d’enfants qui présentent des troubles graves du développement – autisme, schizophrénie, psychose, retard intellectuel, maladies rares. Il les écoute, les informe, les conseille et les oriente. C’est le fruit de toute l’expérience qu’il a accumulée qu’il nous livre ici.
Cet ouvrage se veut un guide d’accompagnement pour toutes celles et tous ceux qui vivent aux côtés d’enfants pas tout à fait comme les autres. Aux préoccupations directement exprimées par les parents en consultation, il apporte les réponses de l’un des plus grands spécialistes européens dans le domaine du handicap.
Comment faire établir le bon diagnostic ? Comment organiser la prise en charge ? Comment limiter l’impact du handicap sur la vie de couple, la dynamique familiale, les relations avec la fratrie ? Comment accompagner au mieux les grandes étapes du développement de son enfant ?
Les parents trouveront ici les informations et les conseils dont ils ont besoin pour élever leur enfant. Ils découvriront aussi, pour les aider dans leur vie quotidienne, de nombreux entretiens avec d’autres parents confrontés aux mêmes difficultés. Ils prendront connaissance, enfin, de pistes pour mieux s’orienter et sortir de la solitude que connaissent si souvent les familles d’enfants en situation de handicap.
Stephan Eliez est pédopsychiatre, spécialisé dans le handicap. Il a une longue pratique clinique auprès d’enfants handicapés et de leurs familles. Il est actuellement directeur de l’Office médico-pédagogique de Genève.
Site des Editions Odile Jacob
-
Francophone, indépendant et sans but lucratif, ce forum est formé par différents partenaires du handicap visuel et des personnes qui, à titre privé, sont concernées par cette problématique. Il est dédié à tout ce qui se passe en Suisse et plus particulièrement en Suisse romande dans le domaine du handicap visuel.
Katia Gille est à l’origine de la création du forum. Atteinte de cécité corticale, elle est reconnue pour ses qualités de webmaster. Forte d’une longue expérience professionnelle dans le domaine de la gestion et de la création de sites Internet, elle connaît les différent aspects du handicap visuel. Elle a travaillé durant plusieurs années dans différents services de l’État de Genève et l’État du Valais. Sa formation dans les relations publiques, culturelles et sociales lui ont permis d’organiser plusieurs manifestations. Elle est très proche des associations régionales en faveur des personnes en situation de handicap et collabore activement avec plusieurs institutions dont elle défend les intérêts en diffusant les informations susceptibles de leur venir en aide.
Sont ainsi regroupées sur un seul site les événements et les informations sur :
- Activités sportives
- Bibliothèques et médiathèques
- Cinémas en audio description
- Cours et ateliers créatifs
- Hôtels
- Livres
- Musées
- Parcs
- Passeports vacances
- Radio
- Télévision en audio description
- Théâtre en audio description
Dans une mise en page claire et précise, Forum Handicap Visuel fournit également de très nombreux hyperliens aux associations et institutions en lien avec le handicap visuel.
Les partenaires :
- Association pour le bien des aveugles et malvoyants (ABA)
- Action Caritas Suisse des aveugles (CAB)
- Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA)
- Je guide tes pas
- Radio Alpha Bravo
- Revue REISO
- Restaurant Hong Kong City
- Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA)Site internet Forum Handicap Visuel
-
Les relations entre parents et personnel enseignant sont parfois tendues et la confiance mutuelle profitable à l’enfant rompue. De multiples raisons peuvent donner naissance à des conflits : parents jugés trop peu concernés ou au contraire trop intrusifs, mauvaise compréhension des réformes scolaires, de l’évaluation ou de l’orientation, méfiance et disqualification réciproques, etc.
Cet ouvrage pratique, grand public et accessible est un outil indispensable aux parents et aux acteurs du milieu enseignant pour mieux comprendre et gérer les problèmes de communication, apprendre à collaborer de façon efficace et ainsi permettre aux enfants de bénéficier d’un climat d’apprentissage sain et productif.
Site internet Editions Favre
-
Article spécialisé
Une application scrupuleuse de l’interdiction de la maternité de substitution entraîne une violation des droits de l’enfant. Ce dilemme, la Suisse doit aujourd’hui s’y confronter, dans la mesure où, en dépit de l’interdiction, il existe une réelle demande pour des mères de substitution et que l’on connaît plusieurs cas concrets de maternité de substitution.
Cet article présente entre autres les aspects relevant des droits humains qui sont depuis quelques années en discussion sur le plan international et présentent de sérieuses pistes pour la Suisse aussi.
Pertinence pratique
- La maternité de substitution est interdite en Suisse, comme dans la plupart des pays européens, ce qui n’empêche pas nos autorités de reconnaître un lien de filiation établi à l’étranger.
- Lorsqu’un cas de maternité de substitution se pose, il faut respecter les droits de toutes les parties prenantes et, en tout premier lieu, ceux de l’enfant (notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à connaître ses origines et la protection contre la traite des enfants).
- En vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), l’article 8 CEDH (intérêt supérieur de l’enfant, garantie des relations familiales de l’enfant, droit à l’identité et à connaître ses origines) fonde le droit de l’enfant à la reconnaissance de la filiation avec les parents d’intention s’il est uni à ceux-ci par un lien biologique. Les autorités ne peuvent refuser cette reconnaissance en invoquant l’ordre public. Les modalités de l’interdiction de la maternité de substitution ne doivent pas entraîner de graves conséquences pour l’enfant.
- Toute ingérence dans la vie familiale entre les parents d’intention et l’enfant né d’une mère de substitution, n’est licite que lorsque le bien de l’enfant est en danger ; la réserve de l’ordre public ne constitue pas de motif suffisant en l’espèce.
- Selon le droit international privé, la Suisse doit reconnaître les actes de naissance établis en bonne et due forme à l’étranger dans la mesure où les requérant-e-s produisent une déclaration de renonciation dûment signée par la mère porteuse et son conjoint.
- Le droit de l’enfant de connaître son origine doit être garanti lors d’une maternité de substitution. Si le Tribunal administratif de Saint-Gall a tracé une voie à cette fin, son arrêt doit toutefois encore être examiné par le Tribunal fédéral.
- Les efforts en cours à l’échelon européen et international pour s’attaquer aux problèmes inhérents à la maternité de substitution et pour formuler une réglementation internationale pourraient garantir, à l’avenir, le respect des droits humains de toutes les parties intéressées.
Article complet en format pdf
-
Bande dessinée
Recension par Jean Martin, médecin de santé publique
Centre de soins palliatifs de la Chaux-de-Fonds, la Fondation La Chrysalide a pour mission de promouvoir la qualité de l’accompagnement en fin de vie dans les lieux de soins à domicile, dans les institutions et les hôpitaux.
Dans une démarche originale, la fondation a publié en 2012 une brochure qui a retenu l’attention, « A la vie… à la mort ! » et organisé une tournée romande de théâtre-forum (présentation dans REISO : « La mort ? Parlons-en et "s’aidons" le passage »). En 2015, elle publie une série de trois bandes dessinées. « Je meurs » est la première et vient de sortir. Treize histoires courtes, par des auteurs de bandes dessinées de notre pays.
- La première contribution illustre le dialogue de petits-enfants avec un grand-père dont la santé décline. Une autre histoire raconte le grave AVC d’un adolescent, de ses parents à son chevet et des soignantes dont les efforts n’éviteront pas l’issue fatale.
- Plus loin, une jeune femme mourante pense aux rapports avec ses proches, à leur douleur, à sa colère (« de n’avoir pas su guérir, qu’on me parle de tout et de rien comme si tout allait bien, contre moi-même d’exiger que vous acceptiez l’inacceptable »). Apparaissent aussi des dialogues entre le patient et son corps qui a mal, qui cache des choses, qui ne veut plus bouger (est absent), qui s’affaiblit, qui « m’attire vers les grands fonds ».
- Une BD évoque le chagrin amoureux d’une jeune fille, ses pulsions suicidaires puis, comme des clips télévisuels, la voit écrasée par une voiture alors qu’elle consulte son téléphone mobile. Une histoire se passe en Afrique dans un contexte d’exactions violentes.
- Des grands-mères sont à plusieurs reprises au centre du récit ; ainsi, fille et petite-fille visitant dans son EMS une patiente qui glisse dans un état de type Alzheimer. Des processus de deuil.
- Enfin, dernière histoire du recueil, évocation d’un patient « mort durant quelques minutes » après un accident de voiture et qu’on parvient à réanimer sans séquelle neurologique - « J’étais [à nouveau] vivant. »
La plupart de ces histoires sont réalistes. Certaines ont une dimension plus ou moins onirique, fantasmée : rencontre avec la Mort faucheuse ou pincée de science-fiction, avec survenue d’engins spatiaux et d’animaux fantastiques… On trouve aussi le fameux tunnel au bout duquel luit la lumière. Le dessin va du « bien propre sur soi », si je peux dire, à des styles très originaux, parfois poétiques, parfois côtoyant le trash.
On retrouve, explicitement ou entre les lignes, les stades popularisés par Elisabeth Kubler Ross dans la confrontation à la maladie grave : surprise/dénégation, colère, marchandage, dépression, acceptation. Parmi les publications qui fleurissent autour de la fin de vie, « Je meurs » retiendra l’attention du public familier de bandes dessinées, mais pas seulement. Cet album se prêtera bien à des animations pédagogiques dans des groupes de jeunes ou dans les écoles. Il stimulera les réflexions et les discussions.
Je veux croire que cette BD rencontrera le succès et que sera insuffisant le premier tirage de 1500 exemplaires. Et je me réjouis de voir « Tu meurs » et « Il meurt », les deux tomes qui suivront.
Présentation de la démarche et des auteurs en format pdf, 18 pages
-
Guide
Le travail social et la santé publique sont régulièrement confrontés au vocabulaire relatif au marché du travail. Retrouvez les termes techniques et leurs définitions dans ce répertoire. Ce travail de bachelor a été réalisé par Diane Carron à la Haute Ecole de travail social - HES-SO Valais sous la direction de Marie-Luce Délez, avec des dessins de Mix et Remix.
Dans ce répertoire, les concepts liés au marché du travail en Suisse ont été regroupés sous huit thèmes principaux :
- Marché du travail
- Politique du marché de l’emploi
- Entreprise/ Société
- Travail/ Emploi
- Salaire/ Revenu
- Chômage
- Insertion professionnelle
- Protection sociale
Dans le texte, les mots en bleu sont ceux de l’index des notions principales du marché du travail. Les mots écrits en rouge représentent les notions supplémentaires et les abréviations énumérées dans le glossaire.
Quelques notions de l’index : chômage structurel, décroissance économique, employabilité, marché caché, sous-emploi, travail au noir, etc.
Les numéros des pages indiqués dans l’index, le glossaire et la table des matières sont ceux figurant au bas des pages et non les numéros du pdf.
Le répertoire en format pdf
-
Fresque contrastée du quartier le plus panaché de Genève, l’ouvrage propose une rencontre des principaux acteurs des Pâquis, en privilégiant ceux qui y sont établis depuis longtemps. De l’artisan à l’artiste contemporaine, du vendeur de cocaïne au propriétaire de bar à champagne, du musicien de jazz au prédicateur musulman, la diversité de l’échantillonnage suffit à illustrer la richesse d’un microcosme toujours mouvant et propice au mythe.
Entre incendies et explosions, vie nocturne et action sociale, derrière leur muraille de prestigieux palaces, les Pâquis stimulent l’imagination et pulvérisent les clichés. L’approche proposée s’effectue sous différents angles qui n’excluent pas la poésie. Les récits d’incidents vécus par l’auteur alternent avec les portraits et le discours des principaux acteurs du quartier.
L’ouvrage s’adresse à tout un chacun, du sociologue au géographe en passant par le simple citoyen qui désire mieux connaître les coulisses de son pays.
Yvonne Bercher, docteur en droit, habite les Pâquis depuis 1991. Elle a publié un ouvrage sur la prison, un récit de voyage en Syrie et en Egypte avant la révolution et de nombreux articles dans la presse tunisienne. Elle pratique l’aïkido, étudie l’arabe depuis une quinzaine d’années et prospecte avec passion le Moyen-Orient.
Site internet des Editions Cabédita
-
Revue spécialisée
Le numéro 14 d’Actal, Cahiers thématiques est consacré à l’intervention précoce sous tous ses aspects : méthodes, enjeux et pratiques. Il a été élaboré avec le Groupe Romand d’Etudes des Addictions (GREA)et propose des regards suisse, français, belge et québécois sur la thématique.
Exceptionnellement, la version numérique de ce numéro est mise gratuitement à disposition du lectorat.
Le dossier a été coordonné par Jean-Félix Savary (GREA) qui signe l’éditorial.
Parmi les articles, citons notamment le chapitre sur les pratiques dans le travail communautaire :
- Expérience « In medias » : le dialogue philosophique, outil de prévention – Nathalie Arbellay
- L’addiction à l’épreuve de sa diction : entre le pré, le loup et la rue – Vincent Artison
- En Suisse, des partenariats avec les collectivités pour une meilleure prévention – Interview Christophe Mani
La revue Actal en ligne.
Actal 14 en format pdf
-
Recension par le Dr Jean Martin
Agence pour l’éducation, la science et la culture, l’UNESCO assume depuis les années 1990 le leadership au sein des Nations-Unies sur les préoccupations éthiques multiples de la société d’aujourd’hui. Elle travaille en collaboration avec d’autres, en particulier l’OMS qui a évidemment sa partie à jouer dans ce domaine. Deux organes jouent un rôle de conseil pour l’UNESCO, le Comité international de bioéthique [1] et le Comité intergouvernemental de bioéthique. Le premier est formé de 36 experts de disciplines diverses (médecine et biologie, philosophie, éducation, droit et notamment droits humains), s’exprimant de manière indépendante, ad personam. Le second est formé de 36 représentants de pays qui en font partie à tour de rôle. Rappelons qu’une grande réalisation du CIB est l’élaboration de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme (DUBDH), adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO en octobre 2005 à Tokyo.
D’autres documents majeurs sont la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme (1997) et la Déclaration internationale sur les données génétiques humaines (2003). Le CIB a aussi rédigé une vingtaine de rapports sur des thèmes liés à la génétique (confidentialité, dépistage, thérapie), sur l’éthique et les neurosciences, sur l’éducation en bioéthique ; ainsi que des documents d’élaboration substantielle d’articles de la DUBDH : ainsi sur le consentement, la responsabilité sociale et la santé, la vulnérabilité humaine, la non-discrimination et non-stigmatisation.
A l’occasion du 20e anniversaire de son Programme de bioéthique, l’UNESCO publie une attrayante plaquette incluant des textes courts de trente auteurs qui ont joué des rôles d’importance en bioéthique, au sein du CIB entre autres. Ces auteurs issus du monde entier incluent Federico Mayor, qui dirigeait l’UNESCO lors de la mise en œuvre du Comité, l’actuel et deux anciennes président·e·s du CIB, deux de ses anciens Secrétaires généraux. Quelques citations.
- Sur l’état des lieux : « Des découvertes extraordinaires sur le génome humain ont ouvert des perspectives infinies d’intervention au cours de la vie d’un individu et même au niveau de la conception de cette vie… ouvrant des boîtes de Pandore. En arrière plan surgissent les vieux fantômes de l’eugénisme et de la libération de Prométhée. »
- Sur le but : « Depuis la nuit des temps, l’Homme s’est penché sur le conflit entre ce qui est possible et ce qui est admissible, puisque le savoir est toujours positif, mais son application ne l’est pas toujours […] La bioéthique cherche à inclure les conséquences du développement technoscientifique dans la société que nous souhaiterions voir advenir, en prenant en compte la question essentielle de la nature humaine, de la conception à la mort […] L’objectif est double : construire un cadre de référence pour réguler et orienter la gouvernance du savoir technologique et scientifique, et permettre une clarification sociale des alternatives éthiques. »
- Sur le mode de travail : « Ce sont les processus de délibération et la construction collective d’opinions, dans le cadre de l’impératif du respect des autres et des différences intrinsèques, qui [en] forment la pierre angulaire, en encourageant un dialogue tripartite entre les experts, les décideurs et les citoyens […] L’expérience de la négociation sur un pied d’égalité et l’exercice d’un débat pluraliste renforcent la cohésion sociale. »
On pourra trouver ces formulations très générales mais les articles individuels incluent des informations et réflexions pointues. Aussi, nous dit-on, « le contenu de ce livre n’est délibérément pas homogène, cependant il présente une diversité convergente ». Des impulsions fortes au niveau mondial sont à l’évidence indispensables en matière de bioéthique et il est impératif de tirer profit du cadre planétaire qu’offrent les Nations-Unies, en contact avec les Commissions nationales d’éthique et d’autres instances concernées. Impératif de maintenir haut le drapeau des valeurs éthiques et de la réflexion à leur sujet, même si la très inquiétante violence ambiante, internationalement et au sein des pays, met sur le devant de la scène des préoccupations lourdes plus immédiates.
Jean Martin, médecin de santé publique et expert en éthique médicale
L’étude en format pdf
-
La politique cantonale de réinsertion des chômeurs en fin de droits a été profondément remaniée ces dernières années. L’objectif visé est désormais le retour en emploi plutôt que la prise en charge financière. L’accès aux mesures de réinsertion est également favorisé pour les bénéficiaires de l’aide sociale.
L’évaluation menée par la Cour des comptes conclut toutefois que les résultats sont mitigés. Si une hausse des retours en emploi a pu être constatée, elle est notamment liée à l’amélioration du profil des personnes arrivant en fin de droits.
Par ailleurs, l’accès à des mesures de réinsertion ne concerne qu’un chômeur en fin de droits sur cinq, ce qui s’avère insuffisant. Ainsi, le recours à l’aide sociale a doublé, tout comme la proportion de personnes occupant des emplois faiblement rémunérés.
En outre, la mise en œuvre des mesures actuelles se révèle trop standardisée pour prendre en compte les besoins spécifiques de leurs participants.
Les recommandations émises par la Cour visent à faciliter l’atteinte des objectifs de retour en emploi et de prévention de la marginalisation en adaptant davantage les interventions aux besoins des personnes arrivées en fin de droits.
Le rapport en format pdf
-
Brochure
La revue "d’égal à égalE" 2015 interroge la contraception sous l’angle de l’égalité entre femmes et hommes
ll y a 55 ans, le premier contraceptif médicalisé pour femmes était commercialisé aux Etats-Unis. Un an après, la pilule était autorisée à la vente en Suisse. La pilule représente un élément charnière de l’émancipation des femmes. Elle est maintenant le principal moyen contraceptif utilisé en Suisse, comme le confirment des chiffres récents de l’Office fédéral de la statistique (Enquête sur les familles et les générations 2013). Avant l’arrivée de la pilule contraceptive et son utilisation massive, les hommes avaient davantage de responsabilités en matière de contraception. Quelle place occupent-ils aujourd’hui ? Et qu’en est-il de la pilule pour hommes qui reste au stade de l’étude depuis des décennies ? Est-ce qu’aujourd’hui la répartition dans le couple de la responsabilité et des "coûts" de la contraception est discutée, notamment suite aux récentes polémiques autour des pilules contraceptives féminines de dernières générations ?
Le 15ème numéro de la revue d’égal à égalE aborde le thème de la contraception sous l’angle de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette publication apporte un éclairage sur le rôle que les hommes jouent ou ont à jouer en matière de contraception. Elle esquisse les pratiques contraceptives des Jurassiennes et des Jurassiens et leurs représentations de la contraception au travers du travail de différent∙e∙s acteurs et actrices du milieu de la santé, mais également par des témoignages de personnes concernées.
Télécharger la brochure en format pdf
-
Article spécialisé
Un nombre rapidement croissant de nouvelles substances psychoactives (New Psychoactive Substances / NPS) est proposé aujourd’hui, souvent sur internet, comme alternatives aux drogues illicites existantes. Le contenu, les effets et les risques liés à ces substances sont peu ou pas connus et les consommateurs font souvent office de cobayes pour les apprentis sorciers qui les produisent et les vendent. Même si ce phénomène n’est pas nouveau en soi, il s’inscrit cette fois dans une nouvelle dynamique liée à la globalisation des échanges commerciaux et au développement d’Internet.
Addiction Suisse fait le point sur la situation dans une publication de la série Focus et recommande une grande prudence vis-à-vis de ces substances.
L’article spécialisé en format pdf
-
Livre
Les adolescents, ultra-connectés mais inaptes aux relations ? Les médias sociaux jouent un rôle primordial dans leur quotidien, et cette omniprésence interroge nombre d’adultes. Ce livre invite à une plongée dans l’univers relationnel adolescent, dévoilant l’usage que les jeunes font des réseaux sociaux et la nature des rapports qu’ils établissent entre eux à l’école, entre 12 et 15 ans. L’observation de ces pratiques, inscrites dans le contexte social et identitaire qui est le leur, a permis à Claire Balleys de replacer au centre du débat un aspect trop peu souvent évoqué : la force des liens d’amitié et d’amour entre adolescents et leur rôle fondamental dans l’acquisition de l’autonomie.
L’auteure nous invite ainsi à découvrir un système de relations entre adolescents empreint de sentimentalisme, dans lequel les notions d’intimité, d’échange et de partage de l’expérience vécue sont au cœur des préoccupations comme des engagements. A travers cette sociabilité entre pairs, autant dans les rapports directs que dans les rapports médiatisés, c’est à une quête de soi qu’ils se livrent. Le débat est ainsi recentré sur ce que font ou cherchent à faire, la plupart du temps, les adolescents entre eux : tisser des liens les uns avec les autres, se construire et grandir, selon des modalités propres à une époque caractérisée par l’individualisme, l’omniprésence de l’image et l’immédiateté des échanges.
-
Pour permettre à des adolescents de se dégager du sentiment d’abandon, d’exclusion et d’errance dans leur cité, les Maisons chaleureuses veulent être un lieu d’ancrage. S’installant dans des quartiers dits sensibles, elles offrent un lieu qui accueille sans contrainte administrative et qui porte comme règle fondamentale : « il est interdit d’exclure ». Dans leur maison chaleureuse, les jeunes peuvent remailler une trame sociale et communautaire. Ils peuvent élaborer une projection de leur devenir à travers le dialogue avec les adultes qui les reçoivent. Chaque rencontre étant fondée sur l’écoute, le respect mutuel et la bienveillance.
Les Maisons chaleureuses, veulent aussi être un lieu pour penser l’adolescent en difficulté. Les éducateurs sont formés pour accompagner le mal être et la souffrance de l’adolescent selon une approche intégrée, analytique, sociale et éducative. Les principes de la médiation sociale, interculturelle et institutionnelle nourrissent à la fois la formation des éducateurs et l’accompagnement des jeunes afin que ceux-ci puissent aménager une passerelle, un espace transitionnel entre eux – comme sujet – et l’institution.
A partir d’un parcours parfois complexe et difficile, mené de Paris à Jérusalem et qui s’égrène de Madagascar à Tahiti, cet ouvrage veut permettre de pérenniser une chaleureuse expérience d’accueil et de transmission.
-
Déficit financier et abus : ces thèmes prégnants dans les débats publics masquent la complexité des désaccords autour de l’invalidité.
À partir d’une enquête documentaire, ce livre retrace les controverses qui ont cours depuis les années 1990 dans le monde de l’expertise des maladies psychiques. Doutes et soupçons entourent ceux dont l’incapacité de travail est causée par des douleurs corporelles dites « inexplicables ». À leur propos, des questions anciennes resurgissent :
- Au fond, qu’est-ce qu’un invalide ?
- Qui peut réellement avoir le droit à une rente ?
Les rapports de force tendent à s’intensifier sur le front politique à l’occasion de chaque révision législative. De son côté, quoique critiquée, l’expertise médicale est de plus en plus appelée pour produire une vérité sur ce qu’être incapable veut dire. Et au tribunal, comme le montrent les 275 affaires analysées, les magistrats se confrontent à une kyrielle de situations qui ne se laissent pas volontiers enfermer dans une interprétation univoque.
La lame de fond des réformes est une innovation gestionnaire majeure. Parce que la maladie psychique évolue de manière imprévisible et fluctuante, on accorde des droits sociaux à titre provisoire. S’il est trop tôt pour tirer toutes les conséquences de cette politique, une chose semble néanmoins sûre : pour certaines personnes, la sécurité sociale n’est plus de saison.
-
Une augmentation, même modeste, du nombre de femmes élues au sein des partis de droite est susceptible de mener à un changement au niveau des politiques publiques mises en oeuvre, et ceci notamment en faveur de lois visant à défendre la cause des femmes.
Tel est le résultat de cette enquête portant sur le comportement législatif des député·e·s suisses. Dans cet ouvrage, l’auteure teste l’argument utilitaire avancé par de nombreu·x·ses féministes qui postule qu’intégrer des femmes dans les parlements permettrait au champ politique de prendre en compte des expériences sociales qui étaient jusque-là marginalisées.
Grâce à la base de données des votes nominatifs au Conseil national, elle parvient à montrer que le genre exerce une influence non négligeable sur le comportement des législateurs, notamment au sein des partis de droite et, contre toute attente, également au sein du parti de l’Union démocratique du centre, de tendance populiste.
Editions Seismo
-
Recension par Jean Martin
Aux prises avec une maladie auto-immune méconnue
Cet ouvrage est le récit autobiographique de Susannah Cahalan, une journaliste du New York Post qui, au début 2009, alors âgée de 24 ans, est atteinte de troubles d’allure neuro-psychiatrique qui ont représenté une énigme pour le New York University Langone Medical Center et sa division d’épileptologie. Après de multiples examens infructueux (« tout est normal »), c’est une biopsie de cerveau qui a permis aux médecins (notamment les neuropathologistes S. Najjar et J. Dalmau) de conclure à une maladie auto-immune, la Anti-NMDA receptor encephalitis, pouvant être traitée par une thérapeutique comprenant des stéroïdes, une plasmaphérèse et des immunoglobulines par voie intraveineuse. Si Susannah Cahalan dit avoir été le 217e patient pris en charge, des milliers de nouveaux patients ont depuis lors également été diagnostiqués et plusieurs fondations consacrées à ce type de maladies ont vu le jour* ; le « First International Symposium on Autoimmune Encephalitis s’est tenu en mars 2014 à Durham, North Carolina – avec pour but de développer un consensus sur une définition et des critères diagnostiques. La parution de ce livre et les interviews très médiatisés à son sujet ont occasionné d’importants retentissements qui ont permis de mieux faire connaître les encéphalites auto-immunes. Des centaines de personnes/familles se sont adressées à l’auteure en racontant leurs parcours, marqués eux aussi par les incertitudes médicales, les transferts d’un service à l’autre (neurologie, psychiatrie), le manque de connaissances sur ces maladies et leur traitement.
Après quelques semaines de comportement surprenants et un « mois de folie », et une fois le traitement instauré, Susannah Cahalan s’est progressivement rétablie et a repris son métier, quelques huit mois plus tard. Elle décide alors d’écrire son histoire en s’adonnant à un travail conséquent de recherches pour tenter de reconstituer les faits : elle recueille des informations auprès de ses proches, grâce à leurs témoignages et aux notes qu’ils avaient alors rédigées (elle-même n’a pas de souvenir de la période critique), en interrogeant les médecins, en étudiant son dossier médical ou encore en s’intéressant à la littérature scientifique. Dans cette autobiographie, l’auteure consacre une large partie à la description, parfois anecdotique, de sa vie depuis les premières manifestations surprenantes, succédées ensuite par les crises épileptiformes ou de type psychotique. L’aggravation de son état demandera l’hospitalisation. Au final, c’est une biopsie de cerveau qui donnera la réponse et un traitement d’immuno-modulation sera mis en œuvre.
La dernière partie de l’ouvrage aborde des problématiques plus générales dans plusieurs chapitres dont l’un est intitulé « Survivor’s Guilt ». A juste titre sans doute - mais des évaluations quantitatives seraient bien difficiles, Susannah Cahalan se demande combien de (milliers de) patients dans le passé ont été étiquetés comme atteints de schizophrénie ou de maladies dégénératives diverses alors qu’ils souffraient en réalité d’une telle encéphalite. Elle discute les situations lourdes, frustrantes, de personnes présentant une maladie manifestement grave mais sur laquelle on ne parvient pas à poser de diagnostic (le livre est d’ailleurs dédicacé aux patients sans diagnostic). Suite aux échos médiatiques de son histoire, elle relève le soulagement exprimé par les personnes et milieux concernés : celui de savoir que ce type de maladie bénéficie enfin d’un peu d’attention et que l’information à son égard devient disponible en plus grande qualité et quantité.
Nous retiendrons de cet ouvrage notamment deux citations : « Je vis avec ce refrain constant : pourquoi mon corps a-t-il décidé de se retourner contre lui-même ? Pourquoi chez ceux qui sont touchés et pas les autres ? » Et, à propos du premier médecin consulté - qui a jugé qu’elle était sous l’effet d’un sevrage aigu d’alcool : « Ce neurologue connu n’avait jamais entendu parler de cette maladie. En quelque sorte, il est l’exemple de ce qui ne va pas en médecine. Il est le produit d’un système qui oblige les médecins à ne passer que quelques minutes avec chaque patient. Je peux me considérer heureuse, alors que mon cas était exceptionnel et demandait patience et attention individualisée, de n’avoir pas été victime de cette situation. Je réalise à présent que ma survie, ma guérison – ma capacité à écrire ce livre – est la partie étonnante. » (« is the shocking part »). Il ne s’agit pas de jeter indûment le blâme, mais le fait est que les porteurs d’affections méconnues ont probablement besoin, plus souvent que d’autres, d’une dose de chance pour que le diagnostic soit posé et que la bonne thérapeutique soit entreprise en temps utile.
Jean Martin , ancien médecin cantonal vaudois et membre de la Commission nationale d’éthique
*Autoimmune Encephalitis Alliance, site internet ; the Anti-NMDA Receptor Encephalitis Foundation, site internet ; The Encephalitis Society, site internet
-
La nouvelle brochure « Intervention précoce dans les écoles et les communes : l’essentiel », met à disposition de manière condensée des bases importantes sur l’intervention précoce, les facteurs de succès pour une telle démarche, ainsi que des exemples pratiques et des références. Il s’adresse aux intervenants, chargés de projets et responsables liés aux politiques, à l’école, à l’administration, à l’animation, aux loisirs et au sport ainsi qu’à toute personne intéressée par ce thème.
Les contenus sont issus tant de la littérature scientifique actuelle que d’une expérience de plusieurs années. Sur mandat de l’OFSP et en partenariat avec les cantons, la Fondation suisse pour la santé RADIX a mené pendant plusieurs années des projets dans les écoles et les communes qui implantent l’Intervention précoce.
La brochure en format pdf
-
Le guide « Facile à surfer » donne des clés pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs et utilisatrices de sites internet avec limitations cognitives – soit des personnes avec une déficience intellectuelle ou rencontrant des difficultés d’apprentissage, de mémorisation, d’attention ou linguistiques.
C’est le premier guide qui se focalise sur cette clientèle. Il complète les règles pour l’accessibilité web et les recommandations en matière d’ergonomie web. Simple et pratique, « Facile à surfer » présente 14 recommandations essentielles sur les sujets suivant :
- 1. Facile à lire
- 2. Lisibilité (polices de caractères)
- 3. Contenu clair
- 4. Navigation et orientation
- 5. Eléments interactifs
- 6. Design épuré
- 7. Eléments graphiques
- 8. Animations
- 9. Photos
- 10. Vidéos et éléments audio
- 11. Synthèses vocales
- 12. Fonctions d’aide en ligne
- 13. Protection des données
- 14. Responsive design
Il offre également une check-list et un tableau recoupant besoins particuliers et éléments d’interface. Le guide s’adresse à la fois aux professionnel·le·s du web ainsi qu’aux directeur·trice·s de projet internet n’étant pas du métier. Aux premiers, il présente les éléments clés à prendre en compte. Aux seconds, il offre un support pour mieux communiquer avec leurs prestataires de services internet.
« Facile à surfer » est le fruit de la collaboration entre Insieme Suisse, la Fondation « Accès pour tous » et la Haute Ecole du Travail social FHNW.
Télécharger le guide en ligne
-
Livre
Cet ouvrage pose la question des "effets secondaires des psychotropes sur l’anthropologie pénale". Qu’en est-il de l’économie du droit criminel au moment où la psychiatrie diagnostique souvent chez le contrevenant un sujet dépressif agissant sous l’influence de médicaments désinhibiteurs ? Que reste-t-il de ces notions essentielles - la volonté, l’intention coupable, la conscience - qui le fondaient jusque-là ? Comment imputer des actes à des sujets qui n’en sont plus ? Que vaut sur le plan juridique la concurrence de deux expertises psychiatriques partisanes ?
L’auteur invite les acteurs du droit criminel à élucider les liens unissant soigner et punir, à distinguer le champ de la psychiatrie de celui de la rationalité pénale.
Site internet Editions Liber
-
L’association 360 groupe Homoparents et l’association faîtière Familles arc-en-ciel lancent la brochure d’information Familles arc-en-ciel, en partenariat avec la Ville de Genève. Cette brochure a été initialement éditée en allemand par l’association faîtière Familles arc-en-ciel. Traduite en français et adaptée, elle a été gracieusement mise à disposition pour le groupe Homoparents de l’association 360.
Cette brochure a pour but de présenter les familles arc-en-ciel comme une configuration familiale existante parmi bien d’autres. Elle se veut, d’une part, source d’informations fondamentales sur les familles arc-en-ciel en Suisse à destination des enseignant·e·s, des éducateurs et éducatrices et des professionnel·le·s intervenant auprès de la jeunesse et des familles. D’autre part, elle est une invitation aux familles arc-en-ciel à donner plus de visibilité à leur configuration familiale.
La brochure en format pdf
-
Brochure
Toutes les informations importantes sur la contraception d’urgence en Suisse sont réunies sous la forme d’une brève brochure. Les femmes et hommes intéressés par le sujet y trouveront des réponses à des questions telles que « Qu’est-ce que la contraception d’urgence ? », « Comment et quand prendre la contraception d’urgence hormonale ? Où l’obtenir ? À partir de quel âge ? », « Que faut-il faire après la prise d’une contraception d’urgence ? ».
En petit format pratique, cette brochure est remise lors d’un conseil sur la contraception d’urgence en pharmacie ou dans un centre de consultation en santé sexuelle. Elle peut être donnée dans le cadre d’un travail général de prévention, de manière ciblée, comme matériel d’information.
Site internet Santé Sexuelle Suisse
-
Commentaire
Le 14 juin prochain, le peuple suisse se prononcera sur une modification de l’article 119 de la Constitution fédérale. Elle concerne la loi sur la procréation médicalement assistée (PMA) et autorise, dans des limites précises, la pratique du diagnostic préimplantatoire (DPI). On sait que le DPI est admis dans des pays qui nous sont proches, France et Belgique notamment, où les couples suisses sont contraints de se rendre pour bénéficier de cette technique.
Les débats à ce propos seront vifs sur la place publique. Certains jugent qu’il y a là une dérive inacceptable de type eugénique et critiquent une poussée vers l’enfant parfait (alors qu’on parle en réalité d’éviter des maladies graves).
Rappelons ici que le diagnostic prénatal (DPN) est autorisé en Suisse. Il s’agit d’examens durant la grossesse, avec la possibilité d’une interruption si une anomalie est détectée. De son côté, le DPI a lieu in vitro, en laboratoire, avant toute grossesse. Un embryon sans le défaut génétique qui mènerait à une affection grave y est choisi en vue de l’implantation.
Aujourd’hui déjà, des décisions sont prises que personne ne conteste : indépendamment de toute technique médicale, les couples choisissent le moment auquel ils souhaitent des enfants et leur nombre. Avoir cinq enfants représente aujourd’hui une grande famille alors que, biologiquement, la femme peut en avoir une vingtaine ; de très nombreux enfants ne naissent pas alors qu’ils pourraient naître.
Or, c’est notamment au motif de tels choix délibérés que les opposants ne veulent pas du DPI. Alors que des décisions interviennent fréquemment au sein des familles, est-il défendable de refuser que la médecine assiste celles qui sont à grand risque d’avoir des enfants porteurs d’importants déficits ? Au nom de quoi ? De l’idée qu’il est impératif de les laisser dépendre d’une « nature » qui joue aux dés avec leurs gamètes ?
Autre argument, la crainte que les personnes porteuses de handicaps, si elles deviennent de plus en plus rares, ne soient plus acceptées - et assistées - de la même manière. Le risque qu’elles soient ostracisées serait plus grand du fait que tout un chacun a moins d’occasions de les rencontrer. Cette préoccupation mérite tout notre respect. Cela étant, tendrait-on à dire que, pour être solidaire, une collectivité devrait comporter tel ou tel pourcentage de personnes porteuses de déficits ? Et comment préserver notre vivre ensemble en refusant la possibilité, dans des cas qui le justifient, d’éviter la naissance d’enfants avec de sérieux handicaps ou affections ? Dans un débat récent à la radio romande, les représentants des familles concernées faisaient bien la part des choses. Ils ne s’opposent pas au DPI dans le cadre prévu en Suisse et, tout en donnant beaucoup d’amour à leur enfant handicapé, reconnaissent qu’ils seraient heureux d’avoir, par le DPI, la possibilité d’un autre enfant qui n’aurait pas ce grave souci de vie.
On a entendu un philosophe dire qu’on ne saurait laisser à « l’arbitraire des parents » des choix tels que ceux qu’implique le DPI ! Mais, on vient de le rappeler, des choix procréatifs sont constamment faits en toute liberté au sein des familles. J’ai été médecin officiel et une longue carrière m’a convaincu que l’Etat est bien avisé de faire preuve de retenue avant de se mêler de régler la vie privée des citoyens. Une « élite » craindrait-elle que des personnes prennent des déterminations frivoles, pour des motifs discutables de pure convenance ? Il ne s’agit pas de nier que cela puisse arriver, mais ce que j’ai appris au cours des années me fait penser que, pour l’essentiel et notamment sur ces thèmes, les gens sont responsables ! Dans un pays comme le nôtre qui valorise tellement la liberté de détermination du citoyen, veut-on dire que telle commission officielle ou tels fonctionnaires fédéraux seront plus « intelligents » que les couples dans ces décisions (dont on sait au reste combien elles sont lourdes) ?
Il est clair que la médecine et ses avancées lancent de sérieux défis. Cela exige qu’on y réfléchisse en termes d’éthique, en considérant la réalité de notre vie actuelle et en faisant preuve de bon sens quotidien. Au risque de me montrer indûment terre-à-terre, un élément encore : en refusant le DPI, avec l’idée d’être meilleur que les voisins, on maintient une inégalité. Les familles aisées obtiennent sans autre cette prestation à l’étranger, alors que cette option n’est pas envisageable pour les personnes moins aisées. Argument matériel, c’est vrai, mais qui ne peut être sommairement balayé du dos de la main. Là aussi, il s’agirait de maintenir une société un peu solidaire.
Dr Jean Martin, Echandens
Les annonces du réseau
L'affiche de la semaine
 Bureaux partagés en sous-location à Lausanne-centre, dans un environnement propice aux échanges et aux synergies, notamment avec des associations axées sur la famille. (image : © Freepik)
Bureaux partagés en sous-location à Lausanne-centre, dans un environnement propice aux échanges et aux synergies, notamment avec des associations axées sur la famille. (image : © Freepik)