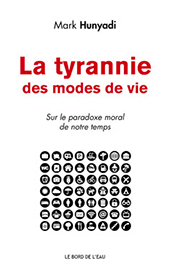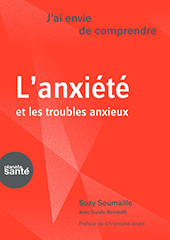Pour réunir les savoirs
et les expériences en Suisse romande
S'abonner à REISO
La liste des parutions
-
Ce livre retrace l’histoire des 40 ans de la Fondation Clair Bois, pionnière dans la prise en charge des personnes polyhandicapées dans le canton de Genève.
Reposant sur diverses sources écrites et sur des entretiens, l’ouvrage retrace les grandes évolutions structurelles et les actions des principaux protagonistes de la Fondation. Il propose également un ancrage historique plus large du handicap en parcourant les périodes antérieures depuis l’Antiquité, et en s’intéressant aux débuts de l’Association genevoise des parents d’enfants infirmes moteurs cérébraux (actuelle association Cerebral Genève), créée en 1958.
Déployant ses activités dans un domaine du handicap encore très mal connu du public, cette Association relève notamment le défi de promouvoir la première institution d’accueil et d’éducation de Clair Bois, ouverte en 1975.
En quatre décennies, la Fondation Clair Bois va s’agrandir de quatre foyers supplémentaires et de structures annexes en élargissant ses prestations, évoluant dans un contexte sociopolitique local et international également rappelé dans le livre.
Mariama Kaba est spécialisée en histoire sociale, de la médecine et du handicap. Elle a abordé ces thèmes dans de nombreux articles et dans sa thèse de Doctorat en Lettres (2011), portant sur l’histoire du corps handicapé en Suisse romande.
Ce livre peut être commandé à la Fondation Clair Bois au prix de 40 francs (eh oui, 40 ans à 40 francs !) par simple mail à :
Site internet Fondation Clair Bois
-
Social interaction is part of human life and is the engine which drives an individual’s psychological development, creating changes on all levels of society.
Through a collection of essays by internationally renowned academics from a range of disciplines, including social psychology, international relations and child development, Social Relations in Human and Societal Development examines the effect of this integral force on human life.
Each chapter explores the role of social relations in a particular domain to provide a broad understanding of the role of social relations in human and societal development.
- Charis Psaltis is Assistant Professor of Social and Developmental Psychology at the University of Cyprus.
- Alex Gillespie is Associate Professor of Social Psychology at the London School of Economics.
- Anne-Nelly Perret-Clermont is Professor Emeritus in the Institute of Psychology and Education at the University of Neuchâtel, Switzerland, with a special interest in cultural and social psychology. She is co-editor, with N. Muller Mirza of Argumentation and education : theoretical foundations and practices and co-editor, with J.M. Barrelet of Jean Piaget and Neuchâtel. The Learner and the Scholar.
-
Dossier spécialisé
Ralph Kundig est président de BIEN-Suisse (réseau mondial pour le revenu de base, section suisse) et coprésident de la Campagne nationale pour le revenu de base inconditionnel.
Considérée hier comme utopique, l’idée du revenu de base inconditionnel (RBI) est aujourd’hui présentée par divers acteurs de la vie publique comme une solution aux problèmes systémiques de notre société. Le peuple suisse sera appelé à se prononcer sur une initiative populaire fédérale pour un revenu de base inconditionnel, probablement l’an prochain.
Le revenu de base est une allocation mensuelle, versée sans condition à chaque citoyen et suffisante pour permettre une existence digne. En Suisse, quasiment toute la population dispose déjà au moins d’un revenu d’un tel montant. La nouveauté réside dans l’inconditionnalité.
Le revenu de base permet une répartition de l’emploi choisie plutôt que subie, il rend inutiles les mesures de contrôle social, n’induit pas d’effet de seuil qui freine l’insertion professionnelle et encourage l’esprit d’entreprise. Il représente aujourd’hui le progrès social majeur nécessaire pour notre société du XXIe siècle.
- Lire aussi « Pour ou contre le revenu de base inconditionnel ? », Albert Jörimann, revue REISO, 6 juin 2011.
- Lire aussi, plus récemment « Quelles politiques de lutte contre la pauvreté ? », Ueli Tecklenburg et Felix Bühlmann, revue REISO, 20 octobre 2014
Le dossier en format pdf
-
Article spécialisé
Le projet européen de la European Patients’Academy on Therapeutic Innovation - EUPATI (Académie européenne de patients sur l’innovation thérapeutique) vient d’être lancé en Suisse. Son objectif : offrir une meilleure information sur la recherche médicale et le développement des médicaments. Les patients participent à cette entreprise, ainsi que le monde scientifique et celui de l’industrie pharmaceutique.
Explications de Geraldine Canny, responsable de la plate-forme romande, dans le dernier numéro de Diagonales, le magazine de Graap-Fondation.
Présentation EUPATI en format pdf
-
L’Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) du Réseau Santé Région Lausanne (RSRL) dispose d’un nouveau dépliant de présentation. Sa présentation a été harmonisée avec celle des équipes mobiles des autres réseaux.
Le dépliant présente brièvement les activités de l’Equipe Mobile qui peut accompagner tant les personnes concernées, les proches que les professionnels de la santé.
Télécharger le dépliant en format pdf
-
Le génocide des Tutsi du Rwanda en 1994 a été qualifié très justement de génocide de proximité. Dans un tel contexte, une politique de réconciliation volontaire impulsée d’en haut, travail de longue haleine, ne peut porter ses fruits qu’en allant à la rencontre d’un mouvement ascendant émergeant des communautés de base. C’est là que se conjuguent, étroitement imbriqués dans le quotidien, les enjeux de la reconstruction : la lutte contre la pauvreté, la restauration de la confiance, le partage des récits qui joue un rôle décisif tant au niveau national que dans les relations intrafamiliales et entre voisins.
Comment, en s’associant au sein de communautés, affronte-t-on l’ensemble de ces enjeux ? C’est ce que des chercheurs du Centre de Gestion de Conflits de Butare et de la Haute Ecole de Travail Social de Genève ont voulu éclairer à travers la coopération qu’ils ont instaurée avec trois associations de la société civile, impliquant différents groupes divisés par le génocide. En développant une recherche-action, les chercheurs ont mis en place au sein de trois projets pilotes, un dispositif de formation des acteurs et de renforcement de leurs capacités pour qu’au delà de la réconciliation, ceux-ci tracent le chemin d’une véritable citoyenneté démocratique.
Site internet Editions IES de la HETS Genève
-
A l’heure de la globalisation, la mobilité internationale des étudiants est considérée comme un atout fondamental par les établissements d’éducation supérieure et les gouvernements européens. Effectuer tout ou partie de ses études à l’étranger est perçu comme une opportunité d’accroître le capital humain des étudiants et leur employabilité sur un marché du travail qui s’internationalise. Les Etats et les établissements cherchent donc à attirer les « cerveaux » d’où qu’ils viennent.
Toutefois, en observant la situation d’une majorité d’étudiants en provenance de pays africains et latino-américains en Europe, on constate une précarisation de leurs conditions de vie au cours de leur formation, tant sur le plan juridique que socio-économique, celle-ci pouvant péjorer leurs performances académiques. En outre, ces diplômés voient leur employabilité limitée par les législations en cours dans le pays de formation et peinent à trouver un travail en lien avec leur curriculum dans leur pays d’origine.
Ibrahim Guissé et Claudio Bolzman analysent les paradoxes et les limites des politiques migratoires en lien avec l’internationalisation de la formation des Hautes écoles en Europe et en Suisse en particulier, et mettent en lumière le glissement d’un brain gain vers un processus de brain waste.
Postface de Jacques Neirynck
-
Statistiques
AVS. En décembre 2014, 192’000 personnes ont touché une prestation complémentaire (PC) à leur rente de vieillesse, soit 7’100 ou 3.8% de plus qu’à fin 2013. La part des personnes au bénéfice d’une rente de vieillesse et tributaires de PC est de 12.4%.
AI. A fin 2014, 112’900 personnes ont touché une PC à leur rente AI, soit 1500 personnes, ou 1.3% de plus que l ’année précédente. La part des rentiers AI bénéficiant de PC atteint 44.1%.
Coûts. En 2014, les dépenses pour les PC ont augmenté de 3.3% pour atteindre 4.7 milliards de francs. La Confédération supporte environ 30% de ces coûts, le reste étant assumé par les cantons.
Homes. Les PC jouent un rôle primordial dans le financement des séjours en home. Environ la moitié des résidents en sont tributaires. Fin 2014, 70’600 bénéficiaires de PC vivaient dans un home. Ils ont perçu en moyenne 3200 francs par mois, soit plus de trois fois plus que les bénéficiaires de PC vivant à domicile.
L’étude en format pdf
-
Site internet
Un nouveau portail web informe la population genevoise sur les prestations d’aide et de soins disponibles sur le canton.
Dans une volonté d’améliorer l’accès de la population genevoise aux prestations d’aide et de soins, le Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS) a mis en ligne un nouveau portail internet "Réseau de soins". Ce portail vise à faciliter la rencontre entre les usagers – notamment les personnes âgées atteintes dans leur santé ou leur autonomie et leurs proches aidants – et les organismes prestataires. Le site a été conçu et développé avec le soutien et en collaboration avec les membres de la Commission de coordination du réseau de soins.
Le canton de Genève dispose d’un réseau riche et varié d’organismes publics et privés qui offrent une gamme étoffée de prestations de soins et de soutien. Or trop souvent, il arrive que les personnes âgées, malades ou en perte d’autonomie, ou leurs proches ignorent l’existence des prestations de soins, de soutien sur le plan social, d’encadrement et de répit disponibles dans le canton. Il s’agit donc d’optimiser la diffusion des informations concernant l’accès à ces prestations, afin de favoriser le maintien à domicile de ces personnes et soulager leurs proches.
« Notre objectif est double, résume M. Mauro Poggia, ministre en charge des affaires sociales et de la santé. A travers ce portail, nous souhaitons aider la population genevoise dans ses démarches et améliorer son accès aux informations. Nous cherchons également à renforcer les synergies entre les différents partenaires du système de soins et de prise en charge et ce, afin de mieux répondre aux besoins de cette catégorie de la population et de leurs proches aidants, notamment leur entourage familial qui joue un rôle de soutien essentiel. »
Le nouveau site Réseau de soins informe donc la population sur les prestations de soins, d’aide, d’accompagnement et de répit disponibles dans le canton de Genève pour les personnes âgées, atteintes dans leur santé physique ou mentale ou en situation de perte d’autonomie, ainsi que pour leurs proches. Des soins jusqu’à l’aide à domicile en passant par les possibilités de rencontres et de loisirs, le maintien de la forme physique, la santé mentale, les mesures de répit ou encore l’entrée en EMS, le portail "Réseau de soins" cherche à recenser et à couvrir l’ensemble des thématiques qui peuvent concerner ce public cible.
Le portail se veut évolutif et pourra ainsi s’enrichir au fur et à mesure du développement du réseau de soins genevois. Tout organisme qui propose des prestations de soins, de soutien, d’accompagnement, d’encadrement ou de répit sur le canton de Genève, pourra figurer sur ce portail pour autant qu’il réponde à un certain nombre de critères, lesquels sont également référencés sur le portail.
Réalisé avec le concours de la Commission de coordination du réseau de soins genevois, le nouveau portail s’inscrit dans le cadre des politiques de maintien à domicile et de soutien aux proches aidants, politiques développées par le canton de Genève en réponse au double défi que représentent le vieillissement de la population et l’évolution des besoins des personnes en perte d’autonomie.
Source : DEAS, Genève
-
La précarité touche de plus en plus de personnes en Suisse romande et l’affluence dans les foyers de jour et de nuit ne cesse de grandir. De nombreux foyers arriveront bientôt à saturation. Une institution fribourgeoise, Banc Public, a par exemple enregistré plus de 26’000 visites l’an passé, soit 15% de plus qu’en 2013.
L’invité de l’émission est Jean-Pierre Tabin, professeur de la Haute école de travail social et de la santé l EESP et membre du comité de REISO.
Lire également le dernier article de Jean-Pierre Tabin : « Lutter contre la pauvreté » paru dans la revue REISO
L’émission en ligne
-
Actuellement, quelque 116’000 personnes en Suisse sont atteintes de démence. D’ici 2050, ce chiffre aura triplé pour dépasser la barre des 300’000. L’Association Alzheimer et Pro Senectute souhaitent mettre en lumière l’importance de la démence dans notre société et faire comprendre que cette maladie ne concerne pas seulement les personnes qui en sont atteintes et leurs proches, mais toute la population.
Une campagne nationale d’affiches et un nouveau site internet sensibilisent le public à cette thématique de santé publique.
A Genève, une étude scientifique montre que les coûts généraux engendrés par la démence dans le canton se montent à 448 millions de francs par an. Au vu de l’augmentation du nombre de personnes touchées, la prise en charge des démences représente l’un des plus grands défis de notre société. C’est pourquoi le "plan cantonal Alzheimer" a été mis en consultation auprès des partenaires du réseau de soins. Il s’agira en particulier de favoriser la pose d’un diagnostic au moment opportun, ainsi que le conseil et le suivi sur mesure des personnes concernées, d’améliorer la coordination entre partenaires du réseau de soins, de développer la formation pour les professionnels et les mesures de soutien aux proches aidants, notamment.
L’Association Alzheimer Genève et Pro Senectute Genève offrent des prestations spécialisées pour les personnes atteintes de démences et leurs proches : foyers de jour, accompagnants à domicile, conseil et informations aux famille, solutions de répit, groupes d’entraide et vacances Alzheimer sont autant de solutions qui permettent aux personnes concernées par la maladie d’Alzheimer de rester le plus longtemps possible à domicile, de demeurer insérées dans la société et d’y participer pleinement.
Site internet memo-info.ch
-
Le Conseil fédéral a adopté le rapport des expert-e-s et les 8 recommandations d’action pour améliorer la situation des personnes atteintes d’autisme en Suisse.
L’équipe de recherche :
- Prof. Andreas Eckert - Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zurich
- Prof. Christian Liesen - Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zurich
- Prof. Evelyne Thommen - Haute école de travail social et de la santé, EESP, Lausanne
- Prof. Véronique Zbinden Sapin - Haute école de travail social Fribourg, HETS-FR
Parmi les mesures susceptibles d’améliorer la situation des personnes atteintes d’autisme, les experts ont relevé une meilleure formation spécifique pour les professionnels en contact avec des enfants ou des jeunes autistes. Autres points cités, une meilleure coordination entre les différentes offres institutionnelles, ou encore des offres de coaching destinées aux enseignants. Des coopérations entre cantons peuvent être judicieuses pour assurer la couverture des besoins. Par ailleurs, il faudrait garantir le financement des offres pour toutes les familles une fois le diagnostic posé.
La plupart des recommandations émises ne relèvent toutefois pas de la compétence de la Confédération. Coordonné par l’OFAS, un groupe de travail comprenant des représentants des cantons, de la Confédération et des autres acteurs concernés (associations de parents, sociétés médicales) sera chargé de passer en revue les recommandations exprimées dans le rapport afin de développer une vision commune, de définir les axes d’intervention, et de rendre compte au Conseil fédéral des résultats des travaux d’ici fin 2016.
Le rapport en ligne
En savoir plus sur cette page du site de la HETS-FR
-
Recension par Jean Martin, ancien membre de la Commission nationale d’éthique
Mark Hunyadi, né en 1960, est un philosophe suisse. Après ses études à Lausanne et Genève, il a passé par le Québec et, depuis 2007, est professeur de philosophie morale et politique à l’Université catholique de Louvain. Il écrit d’emblée : « Nous vivons un paradoxe si manifeste que nous ne le voyons plus. Une véritable inflation éthique, par la multiplication des comités, chartes, conseils, tous censés protéger les droits individuels, [fait que] des modes de vie de plus en plus contraignants, qui échappent à tout contrôle, étendent leur emprise. Tout ce dispositif sert à blanchir un système et les modes de vie qui en découlent, ainsi pasteurisés. »
Tous ceux qui se préoccupent d’éthique, dans le domaine biomédical ou ailleurs, se demandent effectivement si l’éthique est « vassale du système ». Servons-nous de « feuille de vigne », donnant un blanc-seing aux avancées tous azimuts des sciences ? L’auteur utilise une métaphore pour cerner combien nous nous arcboutons sur les libertés individuelles : « C’est comme si nous luttions avec acharnement pour la liberté de choisir la couleur des briques de notre propre prison. »
S’agissant d’éthique globale, l’empereur est nu. C’est ce que nous dit Hunyadi. A mon sens, on ne saurait lui donner tort. Muni de ce constat, comment avancer mieux ? Définir, formaliser et mettre en œuvre des droits communautaires, sociétaux ? On sait, dans le domaine de la santé publique par exemple, les difficultés qu’il y a à définir/circonscrire l’intérêt général. La difficulté aussi à respecter les intérêts des générations futures ! Je suis de l’avis d’Hunyadi que l’emphase mise sur des droits individuels toujours plus nombreux et affinés, dont chacun exige haut et fort la concrétisation, doit être revisitée dans un sens plus frugal et solidaire.
Après d’autres (je pense notamment au « Conseil de l’Avenir » imaginé dans la Constitution vaudoise de 2003), Mark Hunyadi demande la création d’un Parlement des modes de vie. Cette institution remplacerait la « Petite éthique » qui sert à pasteuriser un système insoutenable par une « Grande éthique » porteuse de sens, avec des options mûrement débattues. Cette « troisième chambre parlementaire » mettrait au défi le système démocratique où chacun vote pour l’essentiel selon son intérêt propre à court terme. A condition d’éviter une République despotique des Sages, elle permettrait de faire passer la démocratie à un âge/palier supérieur.
Sur un thème proche, voir aussi le Dossier 2014 de REISO « Solidarité et santé ».
-
Quand une campagne de prévention est conçue par des élèves créatifs, elle a une tout autre allure. Quel style !
Cinq clips vidéo ont été réalisés sur mandat du Centre social protestant Vaud par 29 élèves de l’Ecole romande d’art et communication (ERACOM) et du Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV), dans le cadre du programme de prévention du surendettement (PPS).
Après avoir été sensibilisés par le CSP, des jeunes ont abordé le thème de l’argent, de la consommation et du surendettement, sans jugement moral mais avec lucidité, en mettant en oeuvre leurs compétences de futur·e·s professionnel·le·s pour s’adresser à d’autres jeunes… non sans humour !
Dans le cadre d’un concours, l’un de ces films, Bodypaint, réalisé par Cédric Gottet, Chrystel Mermoud, Yan Decoppet, Chloé Vuignier, Thalles Piaget et Johann Pélichet, a été primé par un jury composé de jeunes et de professionnel·le·s de différents pôles (communication, cinéma, pédagogie, prévention, politique de la jeunesse). Tous ces films seront utilisés lors des actions de prévention en milieu scolaire ou extra scolaire.
Source : CSP Vaud
Ne ratez pas non plus Le revers de la boîte, clip moins esthétisant mais très original, La course, où le marathon du consumérisme est pris au sens littéral, I love my credit card, où l’on s’aperçoit qu’une carte bancaire est un partenaire de lit assez cruel, et Shopping, où on finit la tête dans le carton.
Site internet CSP Vaud
-
Statistiques
- Une association faîtière, Association suisse des services d’aide et de soins à domicile (ASSASD), 24 associations cantonales et 579 organisations locales
- Environ 80% de parts du marché (heures fournies)
- 33’500 collaborateurs et collaboratrices, soit 15’289 emplois à plein temps
- 220’000 clientes et clients pris en charge (sur 261’000 au total)
- 179’917 personnes (sur 219’555 au total) ont bénéficé de prestations de soins, dont 90’000 personnes ayant au moins 80 ans
- Soutien à 110’842 personnes (sur 118’197 au total) dans la gestion de leur vie quotidienne. Quelque 52’000 personnes d’entre elles avaient au moins 80 ans
- 1,7 milliard de francs de chiffre d’affaires
- 572 millions de francs de recettes proviennent de l’assurance obligatoire des soins
- 14,3 millions d’heures de prestations facturées (66 % de prestations de soins, 30 % de prestations d’aide à domicile, 4 % de prestations diverses)
- 48% du financement est assuré par les cantons et les communes
- 88 % des personnes aimeraient être soignées par les services d’aide et de soins à domicile si, une fois âgées, elles deviennent tributaire d’une aide régulière. (Enquête de l‘Institut de recherche gfs-zürich, 2014)
Sources : Statistique de l’aide et des soins à domicile 2013, OFS ; pool de données, Santésuisse ; estimations de l’Association suisse des services d’aide et de soins à domicile
-
A propos de la conférence, à Genève, du médecin et bioéthicien américain Ezekiel Emanuel
Ezekiel Emanuel, 58 ans, est un oncologue connu aux USA dans le domaine de la bioéthique, issu d’une famille de brillants sujets (son frère Rahm a été conseiller du président Obama et est actuellement maire de Chicago). Il était à Genève début juin 2015, pour parler du thème qu’il a traité dans The Atlantic, grand magazine de la Côte Est des USA [1].
« Notre espérance de vie a fortement progressé. Il s’agit certes d’un progrès mais cet allongement de la vie s’est accompagné d’une augmentation du nombre d’années vécues avec des handicaps. » Correct : nos homes hébergent beaucoup de vieilles personnes (très) dépendantes. Mais doit-on pour autant oublier comment les avancées de l’orthopédie ou de la cardiologie interventionnelle, par exemple, procurent encore à des gens âgés une bonne qualité de vie ?
« Nous avons à faire face à des limitations physiques et mentales, nos attentes diminuent. Sans choix conscient, nous ne remarquons pas que nous n’avons plus guère d’aspirations. » Je comprends bien cela chez quelqu’un marqué par le « Rêve américain », mais d’autres (dont j’espère être) pensent que cette évolution vers le moins, et le moins efficace, est l’occasion d’une réflexion sereine, d’une bénéfique prise de recul.
« Chose importante : quel souvenir voulons-nous laisser ? Nous ne voulons pas qu’on se souvienne de nous comme des fardeaux. A 75 ans, nous atteignons ce moment unique où nous avons vécu une vie riche et avons, on peut l’espérer, apporté à nos enfants et petits-enfants des choses dont ils garderont la mémoire ; plus tard, ces souvenirs de grande vitalité vont être poussés de côté par les manifestations (the agonies) du déclin et nos besoins croissants de soins et d’aide. » Comment, alors, Emanuel entend-il faire ? « A partir de 75 ans, je devrai avoir une vraiment bonne raison pour voir un médecin. Je n’accepterai plus de traitements curatifs, seulement des palliatifs. Je ne voudrai plus de tests préventifs. Donc, plus de colonoscopies ou autres dépistages. Je ne serai pas intéressé par un résultat de PSA. Plus d’épreuve cardiaque d’effort, plus de pacemaker ni de défibrillateur implantable » etc.
« Ce que j’aimerais, dit-il dans une interview parue dans Le Temps [2], c’est que les gens s’interrogent sur ce qu’ils souhaitent pour leur fin de vie. Si on y réfléchissait vraiment, seul un petit nombre d’entre nous souhaiteraient arriver jusque là. » Là, nous sommes entièrement d’accord. Mais sur l’approche à adopter ? Il semble tomber sous le sens que l’attitude qu’il prône ne va pas beaucoup diminuer les situations d’inconfort et de dépendance avant de mourir, les périodes pénibles pour la personne comme pour ses proches. Ou imagine-t-il que, par son refus des antibiotiques notamment, la formule de nos prédécesseurs « la pneumonie est l’amie des grands vieillards » va trouver une nouvelle jeunesse (si on peut dire !). Chez nous en tout cas, il y a déjà une retenue devant les traitements héroïques maximalistes. Mais il est vrai qu’aux Etats-Unis, Emanuel le relève, l’« obligation technologique » (de tout faire) reste un écueil d’importance.
Ce qui interpelle, c’est que cet auteur s’exprime depuis des années contre le suicide assisté ou l’euthanasie. Pour ma part, je ne suis pas membre d’Exit tout en étant ouvert à la problématique. Je peux imaginer que l’assistance au suicide ne se passe pas toujours de manière optimale mais j’entends des témoignages dans le sens que, au lieu d’être forcément un évènement dur, déchirant, elle peut être une occasion de dialogue, voire de réconciliation, de bilan marqué par la sérénité (ceci entre autres parce qu’une date est fixée pour la fin). Et, comme beaucoup, j’apprécie la notion que, en cas de dépendance et souffrance irréversible, je pourrais obtenir une aide à mettre un terme à mon existence. Alors que, dans l’approche d’Emanuel, tout en ne voulant plus de mesures efficaces à intention curative, on attend que son propre état se dégrade totalement. Peu riante perspective.
Dernières phrases de notre confrère (1) : « 75 ans est tout ce que je souhaite vivre. Mes filles et mes amis vont continuer à essayer de me convaincre que j’ai tort. Et je garde le droit de changer d’avis, ce qui après tout voudrait simplement dire rester créatif au-delà de 75 ans ». Même venant d’une éminente personnalité, n’est-ce pas là une pirouette ?
1. Emanuel E.J. « Why I Hope to Die at 75 ». Washington, D.C. : The Atlantic, October 2014 issue, en ligne
2. « Pourquoi je souhaite mourir à 75 ans » (interview par P. Minet). Le Temps (Lausanne), 9 juin 2015, p.14.
-
Le Réseau de consultations pour les victimes de racisme analyse 249 incidents racistes recensés par quinze centres de consultation dans toute la Suisse en 2014. La majorité des cas se sont produits sur le lieu de travail et dans l’administration publique. Pour l’année sous revue, le racisme a le plus fréquemment revêtu la forme de propos discriminatoires, liés en premier lieu à de la xénophobie, puis à du racisme anti-noir.
On observe de légères variations par rapport à 2013 et notamment une augmentation des cas de discrimination non verbale comme les gestes dénigrants, les bruits et les mimiques, mais aussi le mobbing au travail et les agressions physiques. Les discriminations envers les noirs ont également connu une hausse notable.
L’importance de ce rapport ne tient pas qu’aux statistiques et aux exemples qu’il présente. Il met également en lumière la qualité durable et la diversité qui caractérisent le travail des quinze centres de consultation. Ceux-ci fournissent des informations générales et des conseils juridiques, apportent un soutien psychosocial et une précieuse contribution en matière de résolution des conflits.
Le réseau a enregistré un nombre particulièrement élevé de cas, par exemple dans le milieu scolaire, où les centres de consultation ont cherché une solution pragmatique à un conflit avec les enseignants, les parents et les enfants concernés. Si nécessaire, les centres savent en outre aiguiller leurs clients vers d’autres services spécialisés comme des cabinets d’avocats, des psychologues et d’autres professionnels de la santé, voire vers la police.
En 2014, quatre centres ont rejoint le réseau de consultations, qui compte désormais quinze membres et dont l’assise garantit dorénavant un recensement des cas de discrimination raciale d’autant plus représentatif du point de vue géographique. Il s’agit de poursuivre sur cette lancée et de renforcer encore la collaboration avec les services cantonaux et municipaux.
Source : BCI, Vaud
Le rapport en format pdf
-
La population helvétique est vieillissante et cette tendance va s’accentuer. L’arrivée des baby-boomers dans le grand âge, de même que l’allongement de la durée de vie impliquent de répondre à des nouveaux besoins, en matière de logement notamment. La binarité Soins à domicile ou placement en EMS n’est plus d’actualité, les alternatives se dessinent et l’on voit partout émerger des solutions innovantes.
Fédéralisme oblige, chaque canton cuisine ses propres recettes et surtout les nomme à son goût. Cette hétérogénéité et le manque de visibilité qui en suit n’aident évidemment en rien les décideurs politiques, les investisseurs et les entrepreneurs sociaux du domaine dans leurs tâches, ni les personnes concernées et leurs proches dans leurs choix.
Pour eux, CURAVIVA Suisse publie Habitat Senior – Proposition de lexique romand unifié, première étude gérontologique nationale sur le sujet, complétée d’un lexique comparatif romand.
Auteur·e·s : Neil Ankers, en collaboration avec Christine Serdaly, d’après H. Rüegger (2014) « Wohnformen im Alter, eine terminologische Klärung », Curaviva (éd), Berne
Editeur : CURAVIVA Suisse
Lire : Un lexique romand des logements pour seniors, de Neil Ankers sur ce même sujet, 3 août 2015
Lire aussi une sélection d’articles parus ces dernières années sur ce thème important dans la revue REISO :
- Habitat protégé : un eldorado pour les aînés ?, de Camille Sigg, 9 août 2012
- Le rôle des foyers de jour pour personnes âgées, de Catherine Clément, 24 mai 2012
- Au cœur des coopératives d’habitation, de Marie Boillat, 15 août 2013
- Pour les personnes âgées, pensez réseaux ! de Christina Zweifel, 20 juin 2013
- Environnement et santé : des liens trop souvent négligés, de Pascal Haefliger, 20 mars 2014
- Le jour où il faut se réinventer un « chez-soi », de Josée Grenier et Danielle Pelland, 17 juin 2014
- Comment habiter en vieillissant ? recension par René Levy de l’ouvrage Age Report III, eds François Höpflinger & Joris Van Wezemael, 20 avril 2015
Proposition de lexique romand de l’habitat senior en format pdf
-
Un monde du travail toujours plus sélectif laisse souvent sur la touche les jeunes que la vie, en raison de difficultés ou d’échecs répétés, a rendus plus vulnérables.
Comment, dès lors, les aider à mobiliser leurs ressources pour qu’ils reprennent confiance en eux et croient, à nouveau, en la possibilité d’apprendre un métier ? Un accompagnement individualisé peut, en fait, contribuer à les soutenir dans la définition et la concrétisation d’un projet de vie.
Cet ouvrage est le résultat d’une étude effectuée en Suisse romande auprès de travailleurs sociaux spécialisés dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle. Il recense une quarantaine d’outils utilisés en entretien, ainsi que des propositions de résolution de situations concrètes illustrant les difficultés que rencontrent ces jeunes. Ces différents éléments sont ensuite discutés afin de mieux comprendre les caractéristiques de cette forme d’intervention.
Les professionnels actifs dans l’insertion des jeunes adultes trouveront dans ce livre matière à alimenter leur réflexion sur leur propre pratique. Il s’adresse, plus généralement, à toute personne concernée par cette question sociale.
Damien Quaglia travaille pour une Fondation active dans l’action sociale. Il est responsable de plusieurs structures d’insertion socioprofessionnelle à l’intention de différents publics (jeunes adultes, personnes confrontées à des problèmes d’addiction, de santé mentale ou physique). Auparavant, il a notamment œuvré comme chef de projet dans la mise en place de centres de formation professionnelle au Sénégal. Il est titulaire d’un Bachelor en pédagogie curative clinique, d’un Master en administration publique, d’un MBA, ainsi que d’une spécialisation en santé mentale publique. Il s’est aussi formé à différentes approches de suivi individualisé.
Lire aussi l’article de l’auteur paru dans REISO : « Insertion des jeunes adultes : une approche partagée », le 15 octobre 2015.
Editions Chronique sociale
-
Anxiété généralisée, trouble panique, anxiété sociale, phobies, trouble obsessionnel compulsif : chez près d’une personne sur cinq, les troubles anxieux induisent une souffrance et une difficulté à fonctionner au quotidien.
En se faisant du souci pour tout et pour rien, les angoissés accumulent les évitements et voient leur vie se rétrécir. Guettés par l’épuisement et la démoralisation, ils ont un risque élevé de basculer dans la dépression.
Symptômes, causes, diagnostic, traitements efficaces et prévention des rechutes : connaître sa maladie est le premier pas pour sortir du cercle vicieux de l’anxiété.
Ce livre accompagne les patients tout au long de leur parcours vers le retour au calme. Il constitue aussi un soutien pour leurs proches, souvent démunis face à des peurs qui les dépassent.
Editions Médecine et Hygiène
-
Au devant de la scène et à l’intersection de questions sociales multiples, le travail de rue, désigné en Suisse romande sous l’appellation « travail social hors murs » (TSHM), se caractérise essentiellement par l’action d’« aller vers » dans la rue et les milieux de vie des populations.
Si le mandat est essentiellement de natures éducative et sanitaire, il naît bien souvent sur la base de problématiques d’insécurité. A quoi renvoient les termes de sécurité et d’insécurité ? Comment le travail social de rue est-il perçu ? Soumis à une même logique d’Etat, comment cohabite-t-il avec les professions dévolues au maintien de l’ordre et à l’action répressive ? Quel cadre éthique cela présuppose-t-il ? Avec des professionnels concernés, des représentants des forces de l’ordre et des publics en situation de rue, l’auteur contribue à y répondre.
Une pierre à l’édifice pour la profession qui a le mérite de dévoiler une méthodologie d’actions, de souligner des limites partenariales, d’explorer des notions taboues sous l’angle de la philosophie, de faire émerger des questions d’éthique et d’ouvrir de nouveaux chantiers relatifs à la pratique, à la recherche et à la formation.
Lire aussi les articles de Vincent Artison dans la revue REISO :
-
Ce recueil permet de découvrir des parcours de vie de personnes âgées, migrantes ou non. Des jeunes bénévoles du Centre d’intégration culturelle (CIC) de la Croix-Rouge genevoise ont recueilli leurs récits. Des liens et une complicité ont ainsi été créés entre des générations et des cultures différentes.
Trois ans ont été nécessaires pour rédiger et illustrer cet ouvrage. Les jeunes qui ont recueilli les récits des personnes âgées ont été soigneusement sélectionné-e-s et formé-e-s. Il s’agit avant tout de bénévoles désireux-euses de se lancer dans cette expérience. Ils et elles ont également été exercé-e-s par des professionnel-le-s aux techniques journalistiques afin de garantir des récits de qualité. Afin de choisir les personnes âgées, des établissements médico-sociaux ont été sollicités, ainsi que l’entourage des bénévoles du CIC : professeur-e-s, participant-e-s aux cours de français, habitué-e-s de la bibliothèque interculturelle. « La phase la plus délicate a été la création des duos bénévole – personne âgée », mentionne Adriana Mumenthaler.
Une fois les duos formés, la personne âgée a rencontré à plusieurs reprises son interviewer-euse. Il était important que la confiance et l’entente s’installent afin de faciliter l’expression et l’évocation des questions sensibles. La magie a opéré à tel point que ces « rencontres d’âmes », comme les qualifiera une des seniors, se sont transformées en 18 histoires, toutes passionnantes et enrichissantes. Elles sont magnifiquement accompagnées par des photos et des portraits des protagonistes de Laurence Favre.
-
Les adultes avec une déficience intellectuelle (DI) manifestent, quand on les questionne, une grande envie d’acquérir de nouvelles connaissances. C’est ce que constatent des chercheurs de l’Institut de pédagogie curative de l’Université de Fribourg et de la Haute école de travail social et de la santé · EESP · Lausanne. Selon leur étude menée sur trois ans auprès de soixante participants, 88% des personnes interrogées estiment qu’elles peuvent encore apprendre à l’âge adulte. Elles ne sont que 3% à exprimer un avis clairement négatif et 9% un avis fluctuant.
En plus des résultats, de la méthodologie de l’enquête et des perspectives ouvertes par l’étude, le site internet comprend des extraits d’entretien.
On constate qu’il leur est plus facile d’identifier les facteurs qui ont influencé les apprentissages déjà réalisés que d’anticiper ceux qui pourraient peser sur les projets qu’elles souhaitent entreprendre. Les premiers sont deux à trois fois plus nombreux à être mentionnés que les seconds. Les facteurs personnels sont plus souvent cités comme des obstacles alors que les facteurs environnementaux sont davantage mentionnés comme des facilitateurs. De façon générale, les facteurs qui facilitent l’apprentissage sont plus souvent évoqués que ceux qui l’empêchent et les facteurs
L’ensemble de ces constats montrent que les personnes adultes avec une déficience intellectuelle manifestent pour la plupart une disposition positive et une confiance dans la possibilité d’apprendre tout au long de la vie. Elles le font sans nier le défi que représente l’apprentissage, conscientes de leurs compétences et de leurs limites personnelles ainsi que de l’importance du soutien en provenance de l’extérieur. Ni l’âge, ni le genre, ni encore l’étiologie, n’influencent les positions qu’elles expriment.
Site internet Déficiences intellectuelles et la brochure en format pdf, 55 pages
-
Cette campagne vise à sensibiliser les femmes à l’importance d’arrêter de fumer avant d’être enceintes et à soutenir celles qui sont enceintes dans une démarche d’arrêt. En Valais en 2012, on comptait 29% de fumeuses (23% en moyenne nationale). On sait qu’entre 15% et 20% de femmes continuent de fumeur durant leur grossesse.
Les conséquences de la consommation de tabac sur la grossesse et pour le bébé sont souvent méconnues, alors qu’elles sont bien documentées dans la littérature. Fumer augmente le risque de grossesse extra-utérine, de saignement ou encore de fausses couches à n’importe quel stade de la grossesse. Pour le bébé, les complications observées sont une tendance à la prématurité, un trop faible poids de naissance, un risque augmenté de maladies des voies respiratoires, entre autres.
Souvent les femmes concernées se sentent coupables et évitent d’aborder le sujet.
Toutes ces raisons motivent le CIPRET à développer une campagne spécifique. La première phase de cette campagne débute lundi 1er juin 2015 (la deuxième aura lieu en automne). La campagne se décline sous la forme suivante :
- Affichage dans l’espace public, près des centres commerciaux (2 semaines)
- Annonces presse (2 semaines)
- Documentation usuelle (brochure, flyers) dans les cabinets médicaux, pharmacies, maternités, etc.
- Annonces dans les pharmacies membres de pharmavalais.Les femmes enceintes fumeuses peuvent ainsi s’adresser à différents professionnels de la santé pour des conseils en désaccoutumance sages-femmes, gynécologues, pharmaciens, tabacologues, CIPRET, etc.
Site internet CIPRET Valais
-
Enjeux juridiques et conséquences sur le plan humain de la pratique suisse en matière de renvois d’étrangers à la santé précaire.
Lorsque des personnes étrangères vivant en Suisse sans statut légal ou avec un statut administratif incertain tombent gravement malades, comment examine-t-on le risque qu’elles encourent en cas de retour dans leur pays d’origine ? C’est la question que se posent depuis des années l’Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers (ODAE romand) et le Groupe sida Genève, qui publient aujourd’hui leur deuxième étude sur la question, fondée sur 11 cas concrets.
Et le constat est sans appel : ce n’est qu’en bataillant pendant de longues années, et à l’aide de laborieuses démarches, que les personnes concernées parviennent parfois à faire reconnaître la gravité de leur situation et à obtenir une régularisation ou une admission provisoire pour raisons médicales. De tels cas de figure sont prévus par la loi mais les dysfonctionnements dans la pratique sont nombreux. Et ils ne font qu’empirer depuis 2012.
Le rapport en format pdf
Les annonces du réseau
L'affiche de la semaine
 Bureaux partagés en sous-location à Lausanne-centre, dans un environnement propice aux échanges et aux synergies, notamment avec des associations axées sur la famille. (image : © Freepik)
Bureaux partagés en sous-location à Lausanne-centre, dans un environnement propice aux échanges et aux synergies, notamment avec des associations axées sur la famille. (image : © Freepik)