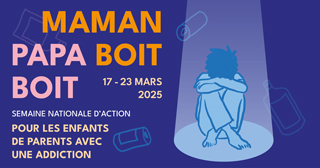Les violences de genre dans l’espace public
Les violences à l’encontre des femmes dans les espaces publics suscitent des débats nourris. Désormais « légitime », cette question apparaît souvent en lien avec le thème des villes sûres, gentrifiées et blanches.
Par Marylène Lieber, sociologue, professeure associée en Etudes Genre, Université de Genève
Les violences à l’encontre des femmes dans les espaces publics ont depuis longtemps été dénoncées par les féministes, sans pour autant réellement faire l’objet de l’attention des pouvoirs publics [1]. Depuis quelques années toutefois, cette question semble à nouveau faire l’objet de débats, notamment sous l’impulsion d’une nouvelle génération de féministes. Sous quelles formes cette question réémerge-t-elle ? Quels sont les enjeux qu’elle soulève ? Cette contribution a pour ambition de donner quelques éléments de compréhension pour expliquer pourquoi cette question apparaît comme légitime aujourd’hui, quand bien même, elle est longtemps restée ignorée.
1. Genre et mobilité dans les espaces publics
Les travaux de géographie féministe ont mis en évidence la dimension sexuée des espaces et de la mobilité, en insistant sur l’expérience que font les femmes des violences, et le rôle que jouent ces dernières dans les assignations spatiales et sexuées. Ce type de travaux souligne la naturalisation des liens entre féminité, espaces publics et danger et engage à une réflexion sur la dimension socio-politique des espaces. D’une part, les rapports sociaux de sexe produisent de la différenciation spatiale en définissant des territoires masculins, féminins ou mixtes, en associant le féminin aux espaces domestiques ou à leur proximité. D’autre part, dans le même mouvement, la dimension spatiale est constitutive des identités masculines et féminines et de la différenciation sexuée. La gestion du danger et l’apprentissage des moyens pour y faire face apparaissent en effet comme éléments centraux de la construction de l’identité féminine. Et les femmes sont amenées à mettre en œuvre des stratégies et des tactiques pour pouvoir sortir et être autonomes, notamment le soir, malgré leur perception du danger (Lieber, 2008).
A priori, cette perception du danger peut être considérée comme largement construite, sans lien réel avec les formes effectives de victimation. En effet, les femmes sont plus nombreuses à déclarer avoir peur de l’extérieur quand bien même elles sont moins souvent victimes d’agression que les hommes dans les espaces publics et qu’elles sont, comme l’ont aussi souligné les féministes, le plus souvent victimes d’hommes qu’elles connaissent (Jaspard et al., 2003). Elles auraient donc peur de crimes dont elles seraient relativement épargnées. Mais ce constat doit être nuancé dans la mesure où les statistiques policières ne recensent pas le continuum d’actes effectifs - des remarques, des sifflements, des interactions trop intimistes avec des inconnus, des agressions sexuelles – qui rappellent aux femmes les risques de subir des violences, en tant que femme. Ces intrusions qu’elles expérimentent couramment lorsqu’elles se déplacent dans les espaces publics participent de la réaffirmation de la ségrégation spatiosexuée, des hiérarchies entre les sexes, tout comme elles consolident les normes de l’hétéronormativité.
Au-delà de sa dimension contraignante, l’espace peut également être une ressource pour la contestation. De nombreuses actions ou initiatives révèlent que les femmes, imprégnées des discours sur « l’égalité déjà là », revendiquent désormais leur droit à sortir quand bon leur semble, et à occuper librement les espaces publics, quelle que soit l’heure, quelle que soit leur tenue, sans être renvoyées à une image négative. Depuis quelques années, en effet, la question du « harcèlement de rue » fait fréquemment l’objet d’articles, de débats et d’actions publiques, telles que les « zones sans relou » [2] ou la slutwalk [3], et cette thématique fait l’objet d’une publicisation encore jamais vue jusqu’ici. La question de la mobilité des femmes semble être devenue un problème public (Gusfield, 1981) qui engagerait à repenser l’articulation entre genre et espace. On peut dès lors se demander, alors que les restrictions imposées aux femmes dans les espaces publics ont toujours fait l’objet de revendications féministes, pourquoi cette question longtemps dénigrée apparaît aujourd’hui comme légitime. Comment comprendre le consensus dont cette question semble faire désormais l’objet ? Quels sont les éléments qui contribuent à favoriser sa diffusion ?
2. Deux formes de réémergence du problème
Le « harcèlement de rue » est une question récurrente qui apparaît et disparaît des débats publics au cours des quarante dernières années et il importe de saisir les différentes formes de cadrage et de définitions du problème et la diversité des acteurs qui se mobilisent. Les enjeux définitionnels et les diverses représentations du problème, tout comme la capacité à représenter ledit problème, façonnent en effet les frontières entre ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas, ou plus. Ils permettent de définir les responsabilités et les solutions envisageables, tout comme ils permettent de mobiliser un cercle plus ou moins étendu de personnes.
Dans les années 1970-1980, en lien avec les revendications à l’encontre de la banalisation du viol, les féministes ont dénoncé les normes sociales qui veulent que les femmes ne peuvent pas se mouvoir librement dans les espaces publics et ont souligné l’existence d’un continuum des violences, allant des sifflements et autres remarques sur l’apparence corporelle au viol. Elles ont dénoncé la dimension avant tout masculine des espaces publics, pourtant officiellement mixtes et ouverts à toutes et tous. Elles ont mis en cause la séparation sexuée entre privé et public, et incité les femmes à résister aux diverses formes de violences imposées par les hommes, violences considérées comme des sanctions à la non-soumission à l’ordre social sexué.
Après avoir disparu partiellement de la scène politique et médiatique, ces dénonciations réapparaissent aujourd’hui sous deux formes principales. D’abord, dans la continuité des revendications féministes des années 1970, notamment avec des marches de nuits des femmes (il y en a eu une à Lausanne en août 2012), les slutwlak ou le mouvement Hollaback. Ces initiatives dénoncent la « culture du viol ». Le monde des réseaux sociaux est mobilisé et le #harcelementderue, par exemple, a provoqué des milliers de réactions de femmes qui ont posté des récits des formes d’interactions non voulues qu’elles subissent au quotidien. Des bandes dessinées, également, comme le Projet crocodiles (Mathieu, Plume, 2014), dénoncent le fait qu’aujourd’hui encore les femmes n’ont toujours pas réellement le droit à une sexualité libre et que leur consentement reste une valeur trop souvent mise à mal.
Au-delà de cette perspective féministe, les dénonciations de harcèlement de rue qui ont fait le plus parler d’elles ont une connotation fortement culturaliste. En 2012, le film de la jeune documentariste Sophie Peters a fait grand bruit. En filmant ses déplacements dans un quartier populaire de Bruxelles, elle a rendu compte des nombreuses remarques et intrusions qu’elle devait subir au quotidien, tant et si bien que les autorités de Bruxelles ont instauré dans la foulée un délit de harcèlement sexuel (fortement contesté). L’analyse présentée dans le film dénonce des pratiques attribuées aux seuls hommes d’origine étrangère et de confession musulmane. Dans cette religion, explique en substance la documentariste, la sexualité serait taboue et les (jeunes) hommes frustrés sexuellement, d’où leurs assauts. Ce type d’explications culturalistes, utilisé pour construire l’altérité comme déviante, est largement contestable sociologiquement et renforce dans le même mouvement une conceptualisation de la sexualité masculine (musulmane) comme naturellement débordante, à laquelle les membres de ces groupes ainsi construits et réifiés ne pourraient se soustraire, pas plus qu’ils n’auraient la capacité de contester les valeurs attribuées à leur culture.
L’intérêt de présenter cette seconde forme de définition du problème, qui a pour la première fois mobilisé les pouvoirs publics, incite à souligner qu’au-delà des revendications en termes de droits des femmes, il existe aujourd’hui certains enjeux plus larges liés à la volonté d’avoir des centres villes sûrs, propres et gentrifiés et on peut se demander dans quelle mesure, ce référentiel plus large contribue à la reconnaissance du « harcèlement de rue » comme un problème public.
3. La féminité et la blancheur comme synonyme de sécurité urbaine
Les recherches en géographie soulignent la dimension genrée des processus de gentrification qui visent la réhabilitation et la reconstruction de certains quartiers urbains et repoussent les populations les plus défavorisées à la périphérie des villes. A Toronto, par exemple, le souci pour la sécurité des femmes a permis la mise en œuvre d’une loi particulièrement rétrograde pour combattre la pauvreté visible dans la ville et légitimer la construction de quartiers sécurisés (Glasbeek, 2006). De telles recherches démontrent que les revendications pour la sécurité des femmes contribuent à renforcer des discours sécuritaires et certaines militantes féministes dénoncent d’ailleurs la récupération de la cause pour laquelle elles se battent [4]. Le souci de préserver des espaces blancs pour les classes favorisées peut-il expliquer l’engouement récent pour cette thématique ? C’est en tous les cas une analyse qui rejoint celle issue de quelques travaux qui réfléchissent au harcèlement de rue. Judith Walkowitz (1998) par exemple dans un article sur l’émergence des revendications des femmes des classes moyennes de la Londres de la fin du XIXe siècle pour un droit à leur autonomie, montre comment cette revendication s’intègre à la fois dans une volonté de se démarquer des prostituées (auxquelles sont assimilées toutes les femmes qui sortent seules le soir) et simultanément dans un rejet des pratiques des hommes des catégories populaires, considérées comme insoutenables.
Aujourd’hui pour légitimes que soit la dénonciation du « harcèlement de rue », elle doit être pensée de façon complexe et ne pas devenir une façon de protéger les espaces des classes moyennes et supérieures (donc blanches). En effet, si les femmes sont sujettes à des formes de patriarcat encore vivaces, les populations paupérisées et racisées rencontrent également des formes de discrimination dans les espaces publics, qui se voient aujourd’hui renforcées par les discours sur les villes sûres, propres et commerciales (des villes féminines ?) au cœur des stratégies municipales depuis quelques années.
Références
- GLASBEEK Amanda, « ’My wife has endured a Torrent of Abuse’ : Gender, Safety, and Anti-Squeegee Discourses in Toronto, 1998-2000 », Windsor Yearbook of access to Justice, 24, 1, 2006, p. 55-76.
- GUSFIELD, Joseph, La culture des problèmes publics. L’alcool au volant : la production d’un ordre symbolique, Paris, Economica, 2009 (1981).
- JASPARD Maryse et al.Les violences envers les femmes en France : une enquête nationale. Paris : La Documentation Française, 2003.
- LIEBER Marylène, Genre, violences et espaces publics. La vulnérabilité des femmes en question, Paris, Presses de Sciencespo, 2008.
- MATHIEU Thomas, PLUME Lauren, Les Crocodiles, Paris, Le Lombard, 2014.
- WALKOWITZ Judith, « Going public : Shopping, Street Harassment, and Streetwalking in Late Victorian London », Representations, 62, 1998, p. 1-30.
[1] Cet article et les cinq autres de la série sur les violences envers les femmes s’inscrivent dans le cadre de deux recherches financées par le Fonds national suisse : « L’émergence et les reconfigurations d’un problème public. Les violences faites aux femmes en Suisse (1970-2012) » (N° FNS 100017_149480) et « Homosexualités en Suisse de la fin de la Seconde Guerre mondiale aux années sida » (N° FNS 100017_144508/1).
[2] Voir : « Une zone sans relou contre le harcèlement de rue », Libération, 25.04.2014. Lien internet, dernier accès le 8 mai 2015.
[4] Voir par exemple ces pages internet de Rue89 et de Slutwalk, consultés le 01.09.2015.