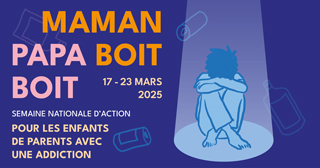Dépasser le genre par l’égalité comptable ?
Les femmes restent majoritaires dans le travail social. La quête de la mixité arithmétique dans ce champ professionnel participe autant aux inégalités qu’à la sexuation de l’espace public et de l’action sociale.
Par Clothilde Palazzo-Crettol (HETS Valais/Wallis), Marie Anderfuhren, (HETS Genève), Myrian Carbajal Mendoza (HETS Fribourg)
Les nombreuses études en Suisse et en Europe montrent que le travail social a toujours été féminisé mais aussi que le processus continue en dépit de la transformation des métiers [1] . Cette situation suscite une inquiétude au sein des instances de formation, elles y voient un risque de dévalorisation des métiers du domaine social. Alors, que signifie la persistance de la prédominance des étudiantes (74% en 2015) dans les écoles de travail social ? Comment cela se traduit concrètement pour les hommes et les femmes ? Quels sont les effets sur les inégalités de genre ? Peut-on comprendre l’égalité uniquement en termes comptables ?
A la différence de la mixité scolaire dont on sait qu’elle est parfois décriée pour les élèves, et valorisée pour les enseignant·e·s, dans le champ du travail social, la mixité n’est que très peu et très récemment théorisée. On sait aujourd’hui que la coexistence des deux sexes ne garantit à elle seule ni l’égalité entre femmes et hommes, ni l’émancipation des femmes. Or les politiques d’égalité sont censées contribuer à ces deux idéaux. Dès lors, il semble important d’analyser les effets de la mixité tant du point de vue du sexe des professionnel·le·s que de celui des usagères et usagers.
La ségrégation verticale du travail
La mixité dans les équipes n’efface pas forcément la division sexuelle du travail – elle peut même l’accentuer – et le système de genre pèse sur les unes et les autres comme le montrent les exemples suivants.
Les travailleuses sociales sont parfois discriminées à l’embauche, en témoignent les offres d’emploi des institutions qui, par souci de mixité dans les équipes, donnent la préférence aux hommes, comme si leur sexe déterminait en soi des qualités surévaluées par rapport aux compétences requises pour le travail sans égard pour l’adéquation au poste.
Quand elles sont engagées, elles risquent de se retrouver dans les modalités de travail qu’elles peuvent connaître dans d’autres emplois moins féminisés, à savoir moindres temps de travail, moindres promotions, moindres possibilités de réorientations et conditions de travail péjorées par le sexisme comme l’ont montré plusieurs études dans différents champs (Rey et Battistini, 2013 ; Martin, Perrin et Damidot, 2014, Anderfuhren et Rodari, 2014).
De plus, la discrimination à l’embauche pour les stages est une plainte qui est souvent formulée par les étudiantes et même attestée par les étudiants. La survalorisation systématique des hommes dans les professions féminines a pour effet de facto de défavoriser les étudiantes dans la formation elle-même.
En Suisse comme en Europe, le travail social n’échappe pas à la ségrégation verticale, les hommes se créent, occupent et conservent des postes hautement valorisés, souvent mieux rémunérés et plus en lien avec le pouvoir (Bessin, 2011 ; Bacou 2010). Par exemple sur une trentaine d’institutions d’éducation sociale en Valais, seul un petit 10% est dirigé par des femmes. Dans les écoles de travail social, les hommes demandent et obtiennent plus facilement des responsabilités honorifiques et/ou réelles qui leur donnent certains avantages matériels en termes de salaire ou d’organisation de leur travail.
Le « risque » social qu’induirait la féminisation du champ du travail social, si tant est que l’on puisse analyser ce processus comme un risque, semble plutôt endossé par les femmes, puisque là aussi, elles se heurtent au plafond de verre.
La ségrégation horizontale du travail
S’agissant du travail effectué, certaines tâches se trouvent « naturellement » dévolues aux femmes et d’autres aux hommes. En l’état des rapports sociaux de sexe, on ne peut exclure que les hommes se déchargent d’une certaine part du travail le moins gratifiant sur les femmes, soit parce qu’il est associé au féminin ou aux femmes soit parce qu’il leur semble trop pénible. On pense ici par exemple au travail de care et de reproduction de la société qui agit comme repoussoir pour l’implication des hommes dans certains travaux de soins (Modak et al., 2008).
Le système de genre crée également des tensions pour les hommes dans les emplois du social en les renvoyant à ce qu’ils peuvent considérer comme du « dirty work » (Zanferrari, 2005), par exemple uniquement à des tâches d’autorité, de contention ou de remise à l’ordre. Dans certaines situations, une forme de rudesse virile fait partie des compétences professionnelles attendues et recherchées (Vilborg, 1998 ; Cheronnet, 2013). La naturalisation des compétences à l’œuvre dans les lieux de travail et parfois de formation, participe pour les femmes et les hommes à la ségrégation horizontale des métiers (Battistini, 2014). Des deux côtés, on pénalise ceux et celles qui ne cadrent avec les attributs liés à leur sexe.
Une intervention neutre pour les bénéficiaires…
La justification à la mixité repose sur une représentation traditionnelle de la complémentarité des sexes, en fonction de l’idée que l’adoption par les professionnel·le·s de comportements et d’attitudes différenciées selon leur sexe serait nécessaire aux bénéficiaires. Or les études sociologiques soulignent le plus souvent les « désavantages » de la mixité sur les bénéficiaires, à savoir les discriminations et les inégalités engendrées à l’encontre des femmes.
Les femmes et les filles peuvent être prétéritées par les politiques sociales et dans les interventions professionnelles, du fait d’une absence de réflexion en termes de genre (Keller, 2011). Ainsi, les mères des classes populaires sont plus stigmatisées, et portent la responsabilité des échecs familiaux (Cardi, 2007, Périvier 2010). Quant aux jeunes filles, c’est souvent parce qu’elles agissent en conformité avec l’ordre social et ne représentent pas un problème, qu’elles ne sont pas prises en compte dans certains dispositifs ou encore qu’elles peuvent être utilisées à discipliner, à domestiquer les garçons (Volery et Rieu, 2008).
Dans le secteur de l’animation auprès des jeunes, les professionnel·le·s privilégient des activités fortement sexuées tels que le foot excluant les filles dans les faits (Palazzo, Richard et Prats, 2007a et b). Par manque d’engagement, dans celles qui sont moins sexuées, elles et ils y réactivent ce qu’Héritier (1996) appelle la « valence différentielle des sexes » en encourageant plus volontiers les garçons (Raibaud, 2011). Par ailleurs, certaines politiques publiques confortent les inégalités, les dispositifs de loisirs sont beaucoup moins nombreux et beaucoup moins onéreux pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons (Ayral, 2011 ; Hiltpold, 2010 ; Maruejouls, 2012). Et enfin, certaines études ont montré que les comportements professionnels sont fortement différenciés en fonction du sexe et de l’âge des bénéficiaires et des attributs attachés à leur genre, ainsi on sollicite plus les garçons, on leur laisse plus d’espace physique ou langagier, on tolère plus leurs écarts (Malatesta et Palazzo, 2006 ; Golay, 2008).
Ainsi, à l’évidence, le risque pour nombre de professionnel·le·s du travail social est de véhiculer un ordre du genre qui reproduit la hiérarchie entre les sexes, et s’actualise sous forme de déficit pour les femmes/filles et de bénéfices pour les hommes/garçons.
Pour un travail social renouvelé !
En définitive, dépasser les inégalités de genre produites dans et par le travail social s’avère plus complexe qu’il n’y paraît. Au vu des résultats de recherche présentés ici, il n’est donc plus possible de croire qu’une égalité purement comptable du nombre d’étudiants et d’étudiantes contribuerait à la construction d’une véritable égalité de conditions de travail et d’opportunités de carrière pour les professionnel·le·s en travail social. Au contraire, il y a tout lieu de craindre que cette « politique des nombres » rende encore plus opaques les chemins devant conduire à la construction d’une véritable égalité entre les sexes. En effet, la non prise en compte des enjeux de genre fait que les mesures visant à construire un équilibre arithmétique entre les hommes et les femmes dans les professions participent de fait aux inégalités, à la sexuation de l’espace public et de l’action sociale. Et dans ces conditions, elles ne contribuent pas à l’émancipation des femmes en général.
A l’inverse, des réflexions, des enseignements et des recherches conduisant à une dénaturalisation de l’éthos féminin du travail social et questionnant, plus généralement, les rapports sociaux de sexe qui structurent la famille, l’emploi et la formation semblent davantage profitables. Enfin, pour le bénéfice de tous et toutes, il s’agirait de mener une réflexion politique sur la dévalorisation de ce champ professionnel et sur les moyens de sa revalorisation.
[1] Cet article est issu d’une recension effectuée par les auteures pour répondre à la question de la HES-SO qui s’interrogeait sur les raisons qui « empêchent » les hommes à s’inscrire en Bachelor travail social. La bibliographie, en document pdf à télécharger ici, a été réduite et principalement limitée à la littérature suisse mais elle est à disposition dans sa version complète chez les auteures.