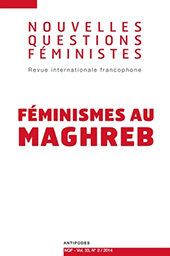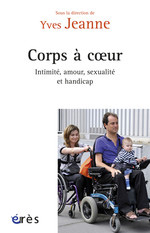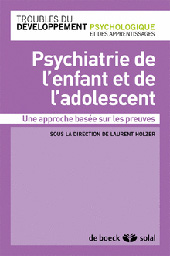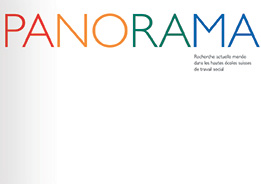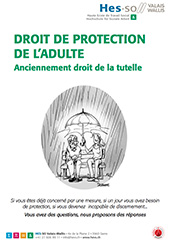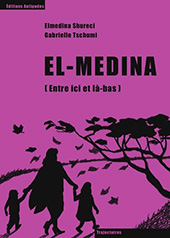Pour réunir les savoirs
et les expériences en Suisse romande
S'abonner à REISO
La liste des parutions
-
Revue spécialisée
Ce numéro est consacré à l’histoire des mouvements féministes en Tunisie, en Algérie et au Maroc, et à leur développement actuel. Avec les "printemps arabes", déclenchés par la révolte tunisienne de décembre 2010, le regard du monde occidental sur le Maghreb a changé. Les Européen·ne·s ont découvert avec surprise la forte présence des femmes dans les manifestations ; et surtout qu’elles se mobilisaient pour revendiquer l’égalité des sexes. Cette méconnaissance est l’héritage d’un colonialisme qui a construit une image passive, résignée, des femmes maghrébines et, plus largement, arabes et musulmanes. NQF a voulu contribuer à la diffusion d’une autre mémoire, celle de chercheuses et de militantes du Maghreb dont les analyses et les expériences prennent le contrepied de cette image.
Leurs articles montrent que les femmes au Maghreb se sont toujours mobilisées, soit en participant aux luttes de libération nationale, soit en développant des luttes autonomes. Mais les états du Maghreb se sont en partie construits sur leur invisibilisation et sur l’exclusion politique et civile des femmes. L’invisibilité de la contribution des féministes reste d’ailleurs de mise aujourd’hui : même si les droits qu’elles ont acquis ont largement aidé les états du Maghreb à revendiquer, face à l’Occident, le statut d’état moderne, l’égalité des sexes ne constitue pas, pour eux comme ailleurs, un enjeu politique prioritaire. Les féministes ont ainsi encore beaucoup à faire.
De type réformiste à des visées plus universalistes, les luttes analysées par les auteures prennent la forme d’une myriade de groupes, d’associations, de tendances politiques qui nous donnent une vue d’ensemble des féminismes maghrébins et de leurs possibilités d’échanges dont témoigne, dans ce numéro, le collectif Maghreb-égalité 95.
Ces luttes montrent des féminismes qui ne sont pas de simples répliques ou imitations des mouvements occidentaux, et qui sont eux-mêmes différents les uns des autres, et parfois divisés, mais qui sont des féminismes.
-
Cette étude mandatée par Promotion Santé Suisse montre qu’une personne sur quatre est soumise à une pression excessive sur son lieu de travail. Ce stress coûte plus de 5 milliards de francs à l’économie suisse.
Les exigences au travail ne cessent d’augmenter et sont bien souvent une source de stress psychologique. En collaboration avec l’Université de Berne et l’Université des sciences appliquées de Zurich, Promotion Santé Suisse a publié une étude scientifique sur le stress lié au travail en Suisse, qui constate que 24,8% des actifs sont soumis à une pression excessive sur leur lieu de travail.
Si les entreprises investissaient plus dans la gestion de la santé en entreprise et si tous les actifs disposaient d’un rapport ressources-contraintes positif, les entreprises pourraient économiser jusqu’à plus de CHF 5 milliards. Selon l’étude, environ 75% de cette perte de productivité est due à une baisse des performances et les 25% restants aux absences pour cause de maladie.
L’étude en format pdf. Graphiques et compléments en ligne
-
Si aujourd’hui la société reconnaît certains droits aux personnes en situation de handicap, bien des aspirations essentielles restent en souffrance. Ainsi en est-il de leur droit à l’intimité et de leur accès à une vie amoureuse et sexuelle dès lors que le libre usage de soi est entravé.
Au-delà des prises de positions politiques ou idéologiques, loin des polémiques focalisées sur l’assistance sexuelle, cet ouvrage donne la parole aux personnes concernées et, plus précisément à celles qui, contraintes par leur déficience, vivent en milieu institutionnel. Elles seules, expertes au premier chef de leurs situations singulières, sont en mesure de dire ce qu’elles vivent et ressentent, ce à quoi elles aspirent et ce qu’elles refusent, ce qui les limite et ce qui peut constituer pour elles des ressources.
En écho à ces témoignages, des sociologues, anthropologues, philosophes, sexologues, théologiens et des professionnels engagés dans leur accompagnement éclairent les déterminants culturels, sociaux et situationnels qui, sous couvert de leur dépendance, invalident leur autonomie. Leurs réflexions ouvrent des pistes de compréhension et d’action pour que leurs constants efforts pour exister en dignité ne restent pas lettre morte.
Site internet des Editions érès
-
Cet ouvrage collectif compte des auteurs de Belgique, du Canada, de France, d’Italie et de Suisse et est coordonné par Laurent Holzer, pédopsychiatre, directeur de l’unité de pédopsychiatrie du CHUV à Lausanne. Il s’occupe des troubles du développement sévères de l’enfant et propose une évaluation spécifique de ces difficultés, une réflexion diagnostique et une orientation thérapeutique.
L’approche basée sur les preuves offre une vision élargie de la pédopsychiatrie en permettant aux thérapeutes de s’extraire de la stricte soumission aux conclusions de la recherche pour donner à la pratique, dans une certaine mesure, la possibilité de valider des choix de prises en charge pluridisciplinaires.
Alors que l’evidence based medecine s’est imposée dans la plupart des spécialités médicales, elle tarde à s’implanter en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Cet ouvrage fait donc le point sur les connaissances actuelles et propose une approche plus globale fondée sur les preuves.
Les 13 chapitres qui le composent couvrent une grande partie des troubles pédopsychiatriques en y intégrant des sujets d’ouverture comme l’alliance thérapeutique, les soins sous contrainte ou les équipes mobiles. Un chapitre consacré aux médicaments psychotropes utilisés chez l’enfant et l’adolescent permet d’offrir un aperçu complet des moyens thérapeutiques à disposition pour chacun de ces troubles.
Site internet De Boeck
-
Dans un contexte professionnel et organisationnel en tension, notamment avec l’établissement de nouvelles normes de gouvernance de l’intervention sociale, le travail social connaît de profondes mutations. Les professions et les formations qui le structurent, se trouvent engagées dans des situations paradoxales entre prescription et autonomie. On relèvera par exemple, l’augmentation des exigences alors que les ressources diminuent ; l’injonction d’insérer des personnes précarisées dans un système économique générant lui-même de la précarisation. Dans le champ de la formation, les différents cursus et l’accent mis notamment sur le développement des compétences engendrent l’ajustement des programmes et l’adaptation des formateurs et des enseignants-chercheurs.
Les contributions réunies dans Dynamiques du travail social en pays francophones permettent d’entrevoir les conditions de renouvellement des métiers du social et les régulations mises en œuvre dans chacun des cinq pays francophones convoqués (Belgique, France, Luxembourg, Québec, Suisse). En dépeignant des paysages contrastés et en soulevant des questions ouvertes issues d’expériences hétérogènes, l’ouvrage vise à alimenter la réflexion et les débats des praticiens, des étudiants, des professeurs-chercheurs et des usagers au sein du travail social.
Site internet des éditions ies
-
Vidéo
« On travaille avec des personnes parfois lourdement handicapées. Ce n’est pas toujours facile. Mais on vit aussi, tous les jours, de belles choses et de beaux moments », explique Olivier Musy, directeur du Service social handicap de la Fondation Emera. La preuve avec ce film.
-
Films, témoignages, faits et chiffres sur les pauvres à Bruxelles. Les thèmes des cinq chapitres :
Quels visages à l’autre bout de la main tendue ?
- Qui sont les mendiants de Bruxelles ? Comment et pourquoi en vient-on à poser ses fesses en rue et à tendre la main ? Quelles histoires se cachent derrière chaque gobelet posé au sol ?
L’impact de la mendicité sur la ville de Bruxelles ?
- Quels sont les quartiers les plus touchés ? Sont-ils un frein pour le commerce, pour le tourisme ? Ont-ils le droit d’investir le métro et les gares ? Gare, métro, commerces ou sites touristiques, les interactions entre la ville et la mendicité sont permanentes, organiques et conflictuelles.
Les coulisses de la mendicité
- Combien gagnent-ils vraiment ? Les réseaux criminels organisés existent-ils ? Les enfants roms sont-ils exploités, loués ou drogués ? Peu de Bruxellois suscitent autant de rumeurs que les mendiants.
Nouvelles règles de survie en milieu urbain
- Liège a donné le ton. Charleroi, Etterbeek, Andenne ou Namur se sont engouffrés dans la brèche. De plus en plus de communes règlementent strictement la mendicité sur leur territoire. La mendicité est légale, mais ça n’arrange pas tout le monde.
Cachez-moi ce pauvre que je ne saurais voir
- Puisque la présence du mendiant nous trouble, nous cherchons à rationaliser notre comportement à leur égard, notamment en définissant de manière arbitraire de bonnes raisons de donner à certains et pas à d’autres. Ne serait-il pas plus simple d’interdire la mendicité une fois pour toute ?
Documentaire en ligne
-
Panorama II donne une nouvelle vue d’ensemble des activités de recherche menées dans les hautes écoles suisses de travail social.
Les directions des hautes écoles de travail social de Suisse alémanique, de Suisse romande et du Tessin, rassemblées au sein de leur Conférence nationale SASSA, ont choisi de publier conjointement une brochure présentant 40 projets de recherche qui ont été menées récemment ou sont encore en cours.
Les projets retenus montrent l’amplitude des thématiques sur lesquelles travaillent les chercheuses et les chercheurs. Ils sont rassemblés dans la brochure selon quatre perspectives :
- La responsabilité sociale de la recherche
- Le développement de la pratique professionnelle grâce à la recherche
- L’utilité de la recherche pour les personnes concernées
- Le développement du savoir et de la théorie par la recherche
Les projets présentés permettent d’appréhender quels sont les apports de la recherche en travail social pour les milieux professionnels car ces travaux livrent des connaissances scientifiquement fondées et des réponses concrètes aux multiples problèmes qu’affronte le travail social. Panorama II montre en cela que les résultats de la recherche apportent un éclairage précieux sur des questions sociétales et de politique sociale et contribue à la cohésion sociale et à la professionnalisation du travail social. Divers témoignages de personnalités issues des milieux politique, scientifique et professionnel attestent de ces contributions.
La brochure se termine par une brève présentation de chacune des hautes écoles de travail social.
Editions en allemand, en anglais, en français et en italien
La brochure en ligne
-
Livre
Nous n’envisageons le plus souvent l’emprise que sous l’angle pathologique, telle qu’elle se donne à voir dans les violences conjugales et familiales, les agressions sexuelles et l’inceste, le harcèlement moral, le sectarisme, ou encore dans cette figure étonnante qu’est le syndrome de Stockholm. On ne peut pourtant ignorer qu’elle a aussi un versant normal, que manifestent les rites de passage, par exemple, mais aussi la « séduction narcissique » (P. C. Racamier) sur laquelle repose l’identification de l’enfant à sa mère, l’emprise réciproque des conjoints qui fonde le couple, l’emprise du leader qui garantit l’esprit de corps au sein d’un groupe quelconque, etc. Ce qui caractérise l’emprise pathologique, ce n’est pas l’emprise en tant que telle mais ses dérives transgressives, destructrices, addictives, qui exploitent la faiblesse de l’autre. Cet ouvrage se propose d’en décrire les mécanismes.
Le modèle élaboré à cette fin s’étaye d’une part sur l’expérience de l’auteur en matière d’aide aux victimes, d’autre part sur les apports de la méthode sémiotique appliquée aux récits de vie considérés comme quêtes. Il en résulte une contribution originale autant qu’essentielle à la compréhension de liens qui parfois mènent au sens et qui parfois tuent.
Site internet des Editions Liber
-
Les réfugiés sont des personnes qui n’ont pas décidé de quitter leur pays, mais qui ont été forcées de partir, souvent dans l’incertitude totale.
À leur arrivée en Suisse, certains possèdent déjà des qualifications reconnues ou une expérience professionnelle parfois même dans des domaines très hautement qualifiés, pourtant leur intégration professionnelle s’avère très complexe.
Seulement un quart des personnes dans le domaine de l’asile parviennent à mettre un pied dans le monde du travail. C’est pourquoi de nombreuses institutions poursuivent des efforts pour encourager leur insertion professionnelle.
Qui sont ces réfugiés ? Quelles sont les difficultés qu’ils rencontrent ? Que faire pour améliorer leur insertion au travail ?
-
L’association Passerelles est un groupe de personnes quasi informel, qui en quelques années, a réussi à créer plusieurs projets qui font déjà école au-delà des frontières cantonales. Les ateliers intégrés Coop, les stages de transition ou l’entreprise sociale Nestor active dans le domaine de la restauration des actions qui démontrent l’engagement des entreprises qui favorisent l’insertion sociale et professionnelle de toute personne en situation de fragilité.
Composé de représentants de PME, de patrons, de grandes sociétés et de services de l’Etat, l’association Passerelles a été mise sur pied il y a quinze ans. Quinze ans pour explorer les collaborations possibles entre social et économie, et ça marche, exemple avec le projet concrétisé par la Coop et la FOVHAM où l’intégration des personnes handicapées dans les équipes actives du supermarché est un succès. Après l’expérience réussie sur le site de Collombey en 2003, une centaine de personnes sont aujourd’hui employées dans toute la Suisse romande.
Autre projet, autre réussite avec les stages de transition. La jeunesse est à la fois un moment privilégié de l’existence et un passage rempli d’embûches. Les résultats scolaires insuffisants, des difficultés familiales ou personnelles peuvent être des freins pour entreprendre une formation professionnelle. Certains adolescents se retrouvent sur le carreau à la fin de leur scolarité obligatoire. Les stages de transition dans le commerce de détail, développés avec le soutien du Service cantonal de la formation professionnelle, de Trade Valais et de Passerelle, donnent une chance à ces jeunes d’intégrer une entreprise, de découvrir un métier mais surtout de suivre à terme une formation. Depuis son lancement en 2010, quatre-vingts places de stage ont été repourvues et soixante collaborateurs ont décroché un contrat d’apprentissage ou de travail à l’issu de cette année de transition.
Un concours pour renforcer les initiatives de PME valaisannes en faveur de l’insertion : c’est la dernière initiative de Passerelles. Pour fêter ses quinze ans, l’association lance un concours d’idées de projets relatifs à la responsabilité sociale des entreprises. Un jury déterminera d’ici quelques semaines les trois projets les plus pertinents ; leurs auteurs recevront respectivement 5000 francs, 3000 francs et 2000 francs.
Page internet Cosmopolis
-
Au 1er janvier 2013 est entré en vigueur le nouveau droit de protection de l’adulte. Parler de droit signifie utilisation d’un langage propre à cette discipline et parfois hermétique au « commun des mortels ». Les nombreuses et nombreux professionnel-le-s amené-e-s à travailler dans le domaine de la protection de l’adulte peuvent faire appel à des ouvrages spécialisés ainsi qu’à des formations pointues afin de se familiariser avec ce « nouveau » droit.
Cependant, peu d’outils sont disponibles pour informer la population de manière générale. C’est pourquoi, à la Haute Ecole de Travail Social de Sierre, nous avons décidé, à l’aide d’étudiant-e-s dans le cadre d’un module libre, de créer un outil permettant d’appréhender les principaux chapitres du droit de protection de l’adulte de manière simple et vulgarisée.
Nous avons opté pour une présentation sous forme de brochure, illustrée de dessins et présentant toute une série de questions-réponses qui permettent au néophyte d’appréhender le sujet de manière simple et pratique.
-
Une présentation pour formateurs·trice·s de parents fondée sur huit constats documentés :
- Les nouveaux médias font partie de notre monde et sont utiles.
- Là où il y a des opportunités, il y a aussi des risques.
- Les parents ont une importante fonction d’accompagnement.
- Les enfants doivent vivre des expériences médias positives.
- Il faut les informer des risques et en parler sans attendre.
- Il faut protéger autant que possible les enfants des dangers.
- En cas de problème, compréhension et soutien avant tout.
- Il faut encourager la conscience de soi et les compétences médiatiques.
Car internet, c’est comme une grande ville, avec
- Des quartiers tranquilles et des ruelles sombres
- Des personnes bienveillantes et des personnages inquiétants
- Des zones piétonnes et des rues dangereuses
- Des places de jeux et des quartiers chauds
- De la sécurité et de la criminalité
Pour éviter les mésaventures et les dangers comme la cyberintimidation, le cyberharcèlement, les pièges de l’abonnement, le grooming, la dépendance, ce guide analyse d’abord les facteurs de risque, explique les bases légales et les ressources policières. Elle donne ensuite
- Une série de conseils précis et concrets pour éviter les mauvais usages des médias numériques par les enfants et les jeunes
- Les adresses des associations et institutions qui fournissent de l’aide
- Des sites internet pour creuser certains aspects ou les sites de jeux conseillés selon l’âge des jeunes
Télécharger le jeu de diapositives sur cette page du site Jeunes et médias de l’OFAS
-
En 1999, cinq « médecines complémentaires » sont intégrées dans l’assurance maladie de base (LaMal). Retirées en 2005, elles y sont réintégrées - à l’essai - dès 2012.
- Quels enjeux politiques et financiers sont à l’origine de cette valse-hésitation ?
- A-t-elle des effets sur les pratiques d’assurance ?
- Et sur les choix de thérapies ?
Cet ouvrage répond à ces questions en montrant que le débat scientifique et politique sur la médecine « légitime » qui perdure depuis des années a conduit à un système d’assurance maladie labile, complexe et opaque qui n’est guère en phase avec les pratiques des assuré-e-s.
-
C’est un atelier d’artistes. Ils s’appellent Sophie, Irène, Alessio, Christian, Jean-Daniel, Philippe et Sandrine. Malgré leur handicap, ce sont déjà des créateurs confirmés. “La peinture, c’est le métier de ma vie. J’ai un rapport fusionnel avec elle. Ce n’est pas une activité comme n’importe quelle autre et, en même temps, l’art en général et la musique plus particulièrement, sont des passions familiales”, explique Sophie.
Christian Bidaud est le responsable de l’Atelier d’Expression Artistique de Saint-Maurice. “Les personnes en situation de handicap qui vont faire partie de cette structure, seront considérées comme des artistes à part entière. Nous ne les prenons pas en compte en fonction de leurs difficultés, mais bien de leurs capacités artistiques”, explique le maître socioprofessionnel. Dans cet appartement de la Grande Rue, du lundi au vendredi, 8 heures par jour, les créateurs dessinent, peignent, apprennent les techniques picturales, étudient l’histoire de l’art, visitent des expositions de grands maîtres à travers toute la Suisse.
La FOVAHM permet depuis quarante ans d’héberger plus de 300 résidents et travailleurs sur plus de vingt sites dans le Valais romand. Depuis sa création, la mission de la Fondation n’a pas changé : elle s’engage afin que la société offre une place en son sein aux personnes handicapées mentales adultes. Les personnes au bénéfice d’une rente AI ont ainsi l’opportunité d’être professionnellement actives à travers des emplois valorisants.
La Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales propose une activité professionnelle, des lieux de vie, des espaces d’apprentissage adaptés. “Cet atelier va plus loin qu’une offre de cours du soir ou d’occupation de loisirs. Il est conçu pour répondre à un projet de vie de la personne handicapée mentale : devenir un artiste. Il ne s’agit donc pas d’un lieu thérapeutique, mais d’un espace répondant à un choix de travailleur “, résume Jean-Marc Dupont. Pour le directeur de la FOVAHM, “ les personnes qui y développent leur art doivent disposer d’un don, des compétences techniques, des capacités créatives et la faculté de transmettre un message par le biais de l’art. Comme toujours à la Fondation, leurs productions doivent se vendre sur le marché, être exposées dans des lieux reconnus comme des galeries d’art ou des musées et non dans des institutions sociales. “
L’avenir de l’atelier est prometteur. Il devrait aménager dans les lieux rénovés de la maison Duc, au cœur de St-Maurice. Si ce projet aboutit, l’atelier pourra enfin réaliser son rêve : disposer d’une galerie d’art ayant pignon sur rue, ouverte à tous les créateurs du canton et d’ailleurs.
Page internet Cosmopolis
-
Breaking The Silence from Geoffroy Dubreuil on Vimeo.
Ce film a été réalisé dans le cadre du projet Breaking the Silence et grâce au soutien de la Fédération suisse des sourds, le CHUV, Dr Patrick Bodenmann (UPV-PMU), l’Ambassador Club d’Yverdon, Raymond Duruz.
- Production : Breaking the silence
- Réalisation : Odile Cantero, Geoffroy Dubreuil
- Voix et idée originale : Alain Borek
- Acteurs : Tanya Al-Khudri, Cooper Jaros, Kevin Staudacher, Diane Uehlinger
- Assistants costumes : Aline Blanc, Kevin Morisod
L’accès à la santé des personnes sourdes n’est pas le même que celui des personnes entendantes. En 2014, aucun médecin en Suisse romande ne parle la langue des signes.
Cette remarquable vidéo incite les soignant·e·s et les étudiant·e·s en santé à faire bouger les choses…
A noter aussi la série de cours donnés les 3, 10, 17 et 24 novembre 2014 de 19 à 21h au CHUV.
Association M.E.T.I.S
-
La journée internationale de la femme est devenue une institution ! Chaque année, le 8 mars, les questions d’égalité et de mixité dans les domaines d’activité professionnelle ou domestique sont soulevées et les inégalités ou le manque de mixité dénoncés. Comme si, les 364 jours restants, la construction des hiérarchies et des divisions du travail ou des tâches selon le genre pouvait se perpétuer. Depuis plus de trente ans, un passage de la parole aux actes est attendu en Suisse afin que l’égalité des chances et des places deviennent une réalité.
Sans garantie de mixité déconstruit les avancées – aux apparences parfois trompeuses – en matière de mixité, dans le travail socio-sanitaire en particulier et plus généralement dans la formation. Les contributrices à ce recueil mettent en avant les mécanismes de reproduction de la non mixité, apportent des éléments de compréhension des politiques et des pratiques institutionnelles de promotion de la mixité, et examinent de manière critique le rapport complexe entre égalité et mixité.
Cet ouvrage, issu de recherches et d’analyses de mesures prises sur le terrain veut contribuer au développement d’une réelle égalité des sexes dans le monde du travail.
-
« Avez-vous renoncé à des soins médicaux pour des raisons économiques au cours des douze derniers mois ? » En Suisse romande, 11 à 14% des personnes interrogées répondent oui. C’est le résultat inquiétant d’une série d’études menées en Suisse romande depuis le début des années 2010. Dans le cadre de l’étude publiée par PLOS one en avril, quarante-sept médecins généralistes ont participé à l’enquête en inscrivant un échantillon aléatoire de leurs patients. La totalité de ces patients étaient assurés auprès d’une caisse maladie et 80% d’entre eux étaient Suisses. Les données principales :
BACKGROUND : Growing social inequities have made it important for general practitioners to verify if patients can afford treatment and procedures. Incorporating social conditions into clinical decision-making allows general practitioners to address mismatches between patients’ health-care needs and financial resources.
OBJECTIVES : Identify a screening question to, indirectly, rule out patients’ social risk of forgoing health care for economic reasons, and estimate prevalence of forgoing health care and the influence of physicians’ attitudes toward deprivation.
DESIGN : Multicenter cross-sectional survey.
PARTICIPANTS : Forty-seven general practitioners working in the French-speaking part of Switzerland enrolled a random sample of patients attending their private practices.
MAIN MEASURES : Patients who had forgone health care were defined as those reporting a household member (including themselves) having forgone treatment for economic reasons during the previous 12 months, through a self-administered questionnaire. Patients were also asked about education and income levels, self-perceived social position, and deprivation levels.
KEY RESULTS : Overall, 2,026 patients were included in the analysis ; 10.7% (CI95% 9.4-12.1) reported a member of their household to have forgone health care during the 12 previous months. The question "Did you have difficulties paying your household bills during the last 12 months" performed better in identifying patients at risk of forgoing health care than a combination of four objective measures of socio-economic status (gender, age, education level, and income) (R(2) = 0.184 vs. 0.083). This question effectively ruled out that patients had forgone health care, with a negative predictive value of 96%. Furthermore, for physicians who felt powerless in the face of deprivation, we observed an increase in the odds of patients forgoing health care of 1.5 times.
CONCLUSION : General practitioners should systematically evaluate the socio-economic status of their patients. Asking patients whether they experience any difficulties in paying their bills is an effective means of identifying patients who might forgo health care.
Lire notamment les comptes rendus
- « Pas de moyens, pas de soins », Le Courrier, Genève, 10 septembre 2014, page 7
- « Je renonce à me faire soigner », Le Temps, Genève, 10 septembre 2014, page 22
L’étude en ligne
-
Ce livre s’adresse aux parents non mariés l’un avec l’autre, à leur entourage, ainsi qu’aux professionnel·le·s concerné·e·s. Où se renseigner avant la naissance d’un enfant hors mariage ? Comment trier les informations reçues ? Comment savoir ce qui est important dans une naissance hors mariage et ce à quoi il faut faire attention ? Il donne toutes les indications pratiques concernant les démarches à accomplir, dans une première partie, en décrivant les situations de vie possibles et dans une deuxième partie, selon des thèmes classés alphabétiquement.
Le cadre social et législatif a beaucoup changé ces dernières années justifiant la réécriture complète de l’ouvrage précédemment parus sous le même titre.
Les deux changements principaux sont certainement l’abandon de la convocation systématique de la mère au moment de la naissance d’un enfant non reconnu par son père (démarche qui constituait pour l’enfant la garantie d’avoir une filiation complète) et l’autorité parentale conjointe devenant la règle pour tous les parents, quels que soient leur mode de vie et leur état civil – mais avec une démarche à accomplir pour les parents non mariés !
En version pdf (CHF 9.-) ou en version papier (CHF 18.-).
A commander sur cette page du site du CSP Vaud
-
Le fait d’opter pour le mariage/partenariat enregistré ou l’union libre/concubinage a des conséquences juridiques dans de nombreux aspects de la vie quotidienne.
Le guide est ainsi subdivisé en chapitres qui donnent pour les particularités, droits, références juridiques pour chacun des deux régimes de vie commune :
- Autorité parentale
- Nom
- Nationalité
- Droit de cité
- Permis de séjour
- Entretien
- Rémunération du travail
- Epargne et fortune
- Logement
- Aide sociale
- Assurance maladie
- Assurance accidents
- AVS / AI
- Prestations complémentaires de l’AVS / AI
- Prévoyance professionnelle (LPP)
- Allocations familiales
- Assurance ménage
- Responsabilité civile
- Dettes
- Poursuites
- Successions
Et en annexe un modèle de Contrat de concubinage.
En version pdf (CHF 9.-) ou en version papier (CHF 14.-)
A commander sur cette page du site du CSP Vaud
-
Bien connu des lectrices et lecteurs de la revue REISO à laquelle il collabore régulièrement, Jean Martin est une des personnalités qui ont façonné le canton de Vaud. Médecin d’ici et d’ailleurs (il a passé 8 ans dans 4 continents), médecin cantonal vaudois de 1986 à 2003, il a aussi été membre de la Commission nationale suisse d’éthique et du Comité international de bioéthique de l’UNESCO.
A l’occasion de la sortie de son livre « Prendre soin, un médecin engagé dans le monde » (présentation sur REISO), entretien sur les enjeux actuels de la médecine, sur les rapports entre patients et soignants, l’éthique médicale, la santé publique, etc.
Une heure pendant laquelle le médecin commente et explique ses profondes valeurs humanistes.
L’émission en podcast
-
Prise de position
La question de savoir si les couples peuvent faire analyser l’embryon avant son implantation en vue de déceler non seulement des maladies héréditaires graves, mais aussi des anomalies chromosomiques telles que la trisomie 21 (syndrome de Down) est entre autres débattue dans le cadre de l’actuelle révision de la loi. « Ces discussions soulèvent une question fondamentale, à savoir si nous sommes en droit de classer les êtres humains entre ceux qui méritent de vivre et ceux qui ne le méritent pas, et les sélectionner en fonction », explique Marie-Thérèse Weber-Gobet, responsable de la politique sociale de Procap Suisse.
Procap craint qu’une autorisation étendue du DPI ne porte préjudice à l’égalité pour les personnes avec handicap de manière indirecte. En effet, la logique de sélection ne s’arrête pas au moment de la naissance, étant donné que la plupart des maladies et handicaps se manifestent plus tard. « La libéralisation du DPI peut affaiblir la solidarité à l’égard des personnes avec handicap. Cela, nous devons l’empêcher », affirme Marie-Thérèse Weber-Gobet.
C’est la raison pour laquelle Procap soutient la proposition du Conseil fédéral visant à utiliser exclusivement le DPI en cas de maladies héréditaires graves. Procap pose par ailleurs six exigences à respecter impérativement dans le cadre de la révision de la loi.
Position de Procap en format pdf
-
Une personne meurt de suicide toutes les 40 secondes, révèle le premier Rapport mondial de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur la prévention du suicide qui appelle à une action coordonnée pour réduire ce nombre.
Environ 75% des suicides sont commis dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Mais le suicide est un problème qui touche le monde entier et presque toutes les tranches d’âge.
Au niveau mondial, les taux de suicide sont supérieurs chez les personnes âgées de 70 ans ou plus. Mais dans certains pays, c’est chez les jeunes qu’ils sont le plus élevés.
Fait notable : le suicide est la deuxième cause de décès chez les 15-29 ans dans le monde.
« Ce rapport appelle à agir face un grave problème de santé publique qui est depuis trop longtemps resté tabou » a déclaré le Dr Margaret Chan, directrice générale de l’OMS.
Le rapport en format pdf
-
Pendant une semaine, l’émission Vacarme s’est intéressée aux enfants placés loin de leur famille et au travail tout en subtilité accompli par les éducateur·trice·s au Foyer de Pierre-Grise, à Genthod, un foyer de la Fondation officielle de la jeunesse (FOJ). Ce foyer accueille des enfants entre 4 et 14 ans placés de gré ou de force dans cet internat en attendant des jours meilleurs. Problèmes parentaux, crises familiales, troubles du comportement : les raisons du placement de ces enfants sont multiples. Comment vivent-ils cette parenthèse qui peut durer plusieurs années ? Quelles sont les causes et les conditions du placement d’enfants aujourd’hui ?
Avec plusieurs éclairages :
Les parents. Certains parents ont décidé eux-mêmes de placer leur enfant. D’autres se sont vus invités par le Service de protection des mineurs ou contraints par un juge de les laisser partir en foyer. Mais les parents, même débordés, atteints dans leur santé, en crise, voire maltraitants, restent des parents…
Les crises. Comment réagir à la colère des enfants ? A Pierre-Grise les crises sont fréquentes. Elles sont souvent brèves mais il arrive aussi que les services d’urgence doivent intervenir et emmener un pensionnaire à l’hôpital pour calmer ses débordements. Ce sont les éducateurs de l’institution qui gèrent au quotidien ces situations explosives tout en construisant, jour après jour, des relations de confiance avec ces enfants en pleine rupture. Comment garder le contact face aux cris ou au mutisme ?
La direction.Bruno Chevrey dirige le foyer de Pierre-Grise depuis 6 ans mais n’y a installé aucun bureau. Il est révolu pour lui, le temps où le directeur d’une institution pour enfants régnait sur la maison comme un père de substitution. « Le but c’est que ces enfants retournent vivre chez eux et que nous finissions par devenir inutiles », rappelle-t-il. C’est dans cette perspective que Mary Jedlicka, responsable pédagogique, reçoit régulièrement les parents pour des entretiens individuels. Pour qu’ils retrouvent la force d’assumer leur rôle.
Après le foyer. Que deviennent les enfants de Pierre-Grise ? Comment construisent-ils leur vie d’adulte après une enfance en foyer ? Témoignage d’Alessandro, qui a aujourd’hui 21 ans. Entre 2000 et 2007, il a vécu dans la belle maison de Genthod : des années pour lesquelles il garde une grande tendresse. Malgré la colère et la tristesse de ne pas vivre en famille.
Les échos. Deux invités réagissent à des extraits de reportages diffusés durant la semaine : Olivier Baud, secrétaire général de la Fondation Officielle de la Jeunesse (FOJ). Joëlle Droux, historienne, spécialiste de l’histoire des politiques de l’enfance en Suisse, auteur de "Enfances en difficultés".
Les émissions en podcast
-
Bande dessinée
Elmedina et Gabrielle se sont rencontrées au cabinet de psychothérapie pour migrants dans lequel elles travaillent toutes deux. En faisant mieux connaissance, Gabrielle a appris qu’Elmedina était elle-même requérante d’asile et en passe d’obtenir sa naturalisation suisse. Autour d’un café, elle lui a un jour demandé : « Serais-tu d’accord de raconter ton parcours dans une bd ? » Elmedina a immédiatement accepté. Le projet était né.
L’histoire racontée dans ces pages décrit, sans les enjoliver, les faits tels qu’Elmedina les a vécus avec, en filigrane et comme fil conducteur, son histoire de migration. Elle parle également de violences conjugales, puisqu’Elmedina en a été la témoin durant de nombreuses années. Ce récit ne se veut pas un exemple d’intégration, mais un parcours parmi d’autres. Réunissant les passions des auteures pour le dessin, la photographie et l’écriture, la notion d’« intégration créatrice » prend ici tout son sens : d’une histoire difficile et jalonnée de violences et de deuils multiples a pu émerger la création artistique.
Les annonces du réseau
L'affiche de la semaine

REISO vous souhaite un bel été. Et si vous profitiez de ces journées pour lire (ou relire) les articles du dossier annuel «Solidarité et liens sociaux»?