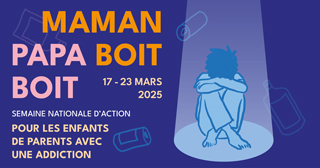Penser la société avec sa composante migratoire
Au lieu d’associer les mots « migration » et « problème », envisageons la migration comme un atout. Car les migrants ont participé à fabriquer la Suisse actuelle. L’épanouissement de notre société dépend de cette culture partagée.
Par Albana Krasniqi Malaj, directrice de l’Université populaire albanaise, Genève, et membre de la Commission fédérale des migrations, Berne
Il y a quelque temps circulait sur la toile une histoire fort intéressante. Un couple voyait un jardin de la fenêtre de la cuisine. Chaque fois que la voisine étendait son linge, la femme disait à son mari : « Comment est-ce possible qu’elle ne sache pas laver proprement son linge ? Il faudrait peut-être lui proposer notre poudre à lessive. » Ce rituel se répéta systématiquement durant des mois. Un matin alors qu’elle sirotait son jus d’orange, la femme s’étonna et dit : « Tiens, elle a changé sa poudre à lessive, son linge est enfin propre. » S’affairant sur la cuisinière, son mari lui répondit sans même tourner la tête : « Chérie, elle n’a rien changé du tout. J’ai lavé les vitres ce matin. » Cette anecdote pour nous amener à réfléchir au regard que nous portons sur les autres. Façonne-t-il le monde ?
L’autre, c’est très souvent le migrant, l’inconnu, celui qui vient de loin, enrobé de mystères et nourrissant des fantasmes. Indépendamment du fait que la presse, certains discours politiques et les discussions de bistrot associent facilement les mots « migration » et « problème », je vais essayer d’aborder le phénomène migratoire suisse en le mettant en corrélation avec le terme « potentiel ».
La migration : une histoire de départs et d’arrivées
La Suisse est une terre d’accueil. L’immigration est une partie constitutive de son histoire. Entre 1948 et 2002, la Suisse a sollicité sept millions de saisonniers pour son économie. Six millions d’émigrants sont venus travailler durant ces cinquante dernières années. Quatre sur cinq de ces migrants sont rentrés chez eux quittant définitivement la Suisse. L’immigration a permis à la Suisse de connaître entre 1990 et 2000 une des plus fortes croissances démographiques d’Europe occidentale.
Il n’en a pas toujours été ainsi. Jusqu’au XIXe siècle, la Suisse était un pays pauvre et agricole. Pour survivre, ses ressortissants partaient ailleurs, s’engageaient comme mercenaires ou domestiques à l’étranger. Révélateur : si le cliché actuel est celui du Portugais gardien d’immeuble, chez Balzac, c’était le Suisse qui occupait cette fonction.
Le premier apport de la migration en Suisse remonte au XVIe siècle avec l’arrivée des réfugiés huguenots [1] et l’essor qu’ils donnent à l’industrie textile et horlogère. Un deuxième mouvement important a lieu au début du XXe siècle lors de la construction des tunnels et des grandes infrastructures nationales. Le pays a alors besoin de main-d’œuvre sur ces chantiers et emploie de nombreux ouvriers italiens. Elle engage également des travailleurs dans l’agriculture. Quant à l’économie domestique, elle voit arriver des femmes allemandes et autrichiennes (450’000 femmes en 1958). En revanche, les étrangers sont peu présents dans l’industrie, les banques, le commerce, la santé et l’enseignement. Rappelons que les frontaliers d’Allemagne, d’Autriche et de France ont aussi toujours fait partie du paysage migratoire.
Ils peuvent venir travailler, mais pas s’installer
En 1921, le Conseil fédéral estime qu’« il n’y aura rien à objecter à l’afflux des étrangers, mais à condition seulement que ceux-ci ne songent pas à s’établir » [2]. Ce message garde tout son poids dans les décennies suivantes : l’immigrant idéal est celui qui vient travailler, qui économise et qui repart. Dans ce contexte, on ne discute même pas d’intégration. Si les gens restent, ils doivent se fondre dans la masse, s’assimiler et laisser derrière eux tous les atavismes culturels. « Un changement culturel des migrants [est] considéré comme un préalable indispensable à leur acceptation dans le nouveau contexte » (Warner et Srole 1945) [3]. Les vagues se succèdent : Italiens, Espagnols, Yougoslaves, Albanais, Turcs…
Depuis une vingtaine d’années, les migrants ne sont plus principalement de la main d’œuvre masculine non qualifiée. Les origines géographiques s’éloignent et le profil sociologique se diversifie. Les nouveaux venus ont souvent une formation tertiaire et s’affirment dans leurs appartenances identitaires. Le décodage culturel devient plus difficile, la compréhension et l’empathie aussi. Les procédés d’interaction entre migrants et locaux deviennent également complexes. Les politiques publiques modernes, quant à elles, tentent de valoriser la différence.
Il est important de noter que, n’étant pas un corps monolithique, le migrant personnifie la différence dans toutes ses dimensions sociale, culturelle, d’appartenance, de genre, de codes et de fonctionnement. Les interactions sont inévitables et l’identité culturelle en perpétuel changement. Le philosophe Jeremy Waldron estime que cet environnement culturel ne doit pas forcément être une sorte de corpus canonique propre au pays. Au contraire, le pluralisme des pratiques se reflète dans les références culturelles qu’un individu va mobiliser en vue de créer ce sentiment d’appartenance. Selon Johan Rochel, c’est l’ensemble des citoyens qui choisit et forge la culture collective.
Les processus intégratifs sur le long terme
Cette culture collective nous mène vers la notion d’intégration, connotée différemment selon les tendances politiques et les intérêts des locuteurs. A la Commission fédérale des migrations (CFM), les processus intégratifs sont vus « comme des moyens de parvenir à une égalité des chances qui ne concernent pas uniquement l’individu, mais également les conditions cadres sociétales… » [4] Cela exprime bien la nécessité d’une volonté politique d’intégration. Sans processus intégratifs, la société risque de perdre ses lignes directrices, négligeant l’égalité au sein même de sa population. L’intégration est donc nécessaire à la fois au bien-être des migrants, mais aussi et davantage encore, à la société en tant que telle.
Les éléments indispensables d’une politique d’intégration réussie relèvent des conditions de stabilité mises à la disposition des migrants, de l’acceptation ou de l’exclusion exprimée par la société, de l’existence des alternatives perméables dans le marché de l’emploi et/ ou de la formation, ainsi que de la mixité sociale. Si la migration est considérée comme une étape passagère et provisoire, les efforts de projection dans la vie locale seront moindres (c’est le cas pour les expatriés par exemple). Si au contraire il y a un projet de s’installer durablement, la personne est incitée à faire partie du paysage et à composer avec. Reste à acquérir la reconnaissance de la société d’accueil : elle se réalise par l’interconnaissance.
« Là où il y a un flou, il y a un loup », dit le proverbe. Afin d’éliminer les flous, il faudrait rendre possible l’interconnaissance. Ainsi, nous n’aurions plus besoin de crier « au loup » car l’interconnaissance fait disparaître les peurs et détermine la construction du citoyen suisse, avec ou sans passeport rouge à croix blanche. Il est donc essentiel que l’on se saisisse de la question. Afin de fournir et respecter une égalité des chances, la société dans son ensemble doit accepter de construire ce patchwork de cultures et de codes qui ont pour socle commun des valeurs humaines partagées.
La migration peut aussi être espoir et savoir
La migration est un processus complexe. Elle est perte, déchirement, trahison, abandon, solitude, deuil de soi et des autres… Tous ces éléments influencent la vie future au sein du nouveau pays d’accueil. Or, la migration peut être aussi rencontre, succès, espoir, découverte, amour. Les migrants ne viennent pas en Suisse dépourvus de tout savoir et savoir-faire. Tout individu possède une série de capacités, de talents et de qualifications qui constituent « son potentiel » [5], indépendamment de son origine. Ceux qui vivent et travaillent en Suisse contribuent à l’économie du pays, contribuent au ralentissement du vieillissement de la population, et apportent des contributions collatérales telles que les impôts, les contributions AVS, les allocations scolaires, etc.
Selon Philippe Wanner, directeur de l’Institut d’études démographiques à l’Université de Genève, « la migration représente un atout puisque la main-d’œuvre étrangère peut, dans une certaine mesure, être ‘importée’ en fonction des besoins » [6]. Les compétences évoquées plus haut sont indispensables pour la Suisse. Un Shaqiri, Behrami, Xhemajli, Antonio Loprieno, une Elina Duni, Sarah Springmann, mais encore toutes celles et ceux que l’on croise dans les hôpitaux, les champs, les chantiers, les universités, mais encore tous ceux qui œuvrent dans les contrats de quartier, les partis politiques, les conseils de classe des écoles, qui entreprennent des travaux d’intérêt général de manière bénévole, tous et toutes font partie du patrimoine suisse. La reconnaissance de l’existence de potentiels dans les migrants permettrait ainsi une meilleure cohésion sociale. L’intégration serait mieux réalisée et les effets économiques, parmi d’autres apports, n’en seraient qu’augmentés [7].
La reconnaissance, mot clef de la cohésion ?
Au lieu de les ignorer, de les sous-estimer, l’économie et la société en général pourraient profiter de ces compétences en reconnaissant l’apport historique et, de manière plus pragmatique, les titres et les acquis. Il est possible et souhaitable de redéfinir une politique, où requérants d’asile et expatriés, ouvriers peu qualifiés et « fuites de cerveaux » seraient considérés sur un pied d’égalité en termes d’intégration et de chances égales.
Les personnes qui viennent en Suisse provisoirement ou durablement, voire qui s’installent ici, pourraient tous mieux contribuer au vivre ensemble en faisant partie d’un tout, sans marginalisation ni privilèges. La société pourrait créer un terrain favorable et fournir ainsi les conditions cadres pour un meilleur exercice des responsabilités individuelles et collectives. Reconnaître d’une part les qualifications de ceux qui en sont munis et, d’autre part, élever les qualifications des autres contribuerait à l’épanouissement de toute la société.
Ce n’est pas notre héritage, encore moins le sang qui coule dans nos veines qui constitue notre pays. Ce sont les valeurs partagées, notre culture commune, qui restent au fondement de notre coexistence. Le sol helvétique nourrit cette harmonie de couleurs. En augmentant nos capacités de co-construction, nous augmentons nos chances de bien vivre les uns avec les autres.
Pour conclure, nous ne nous définissons pas par rapport à l’autre, à l’étranger, mais par rapport à nos valeurs partagées.
[1] Voir notamment Musée virtuel du protestantisme en ligne
[2] Etienne PIGUET (2009), L’immigration en Suisse, 60 ans d’entrouverture, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, Collection Le savoir suisse, 2ème édition, p. 19
Autres ouvrages consultés :
- Johan ROCHEL (2016), Repenser l’immigration, une boussole éthique, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, Collection Le savoir suisse
- Johan Rochel (2015), La Suisse et l’autre, plaidoyer pour une Suisse libérale, essai, Genève, Ed. Slatkine
- Jean-Claude METRAUX ( 2004), Deuil collectif et création sociale, Paris, Ed. La Dispute
[3] Warner, W.L. et L. Srole (1945). The Social Systems of American Ethnic Groups. New Haven : Yale University Press
[4] Déclaration de principe et recommandations de la CFM document en format pdf