Pour réunir les savoirs
et les expériences en Suisse romande
S'abonner à REISO
La liste des parutions
-
Un nouveau jeu numérique sensibilise les 16-25 ans à la violence domestique et dans le couple ainsi qu’aux cyberviolences. Son déploiement est annoncé dans les établissements du secondaire II dès la rentrée 2025-2026.
 © Egalite.chLa Conférence romande des bureaux de l’égalité a présenté hier un outil innovant pour sensibiliser les jeunes à la violence domestique et dans le couple. Sous forme de jeu numérique, ALTernatives apprend aux jeunes à reconnaître les comportements abusifs, à développer leurs compétences pour réagir dans de telles situations et à cultiver des relations respectueuses.
© Egalite.chLa Conférence romande des bureaux de l’égalité a présenté hier un outil innovant pour sensibiliser les jeunes à la violence domestique et dans le couple. Sous forme de jeu numérique, ALTernatives apprend aux jeunes à reconnaître les comportements abusifs, à développer leurs compétences pour réagir dans de telles situations et à cultiver des relations respectueuses.Les enjeux et dynamiques de la violence domestique, la problématique des violences sexuelles et l’importance du consentement sont également abordés, de même que les phénomènes des cyberviolences et du contrôle, très présents dans cette classe d’âge.
Éducation numérique pour des relations sans violence
Parcours didactique sous la forme d’un jeu dit sérieux, ALTernatives vise à sensibiliser les élèves du secondaire II à la violence domestique et dans le couple. Cinq aspects de la violence domestique sont explorées en incarnant différents personnages. À travers ces histoires, les jeunes apprennent à reconnaître les signes de violence, à comprendre les dynamiques relationnelles abusives et à adopter des réactions adaptées, que ce soit en tant que témoin, victime ou auteur·e. Les services d’aide disponibles ainsi que le cadre légal en vigueur sont également présentés.
Conçu par la Conférence romande des bureaux de l’égalité et les départements de la formation et de l’enseignement, ce jeu encourage la réflexion sur les relations, le respect et la gestion de situations complexes. Il est accompagné d’un dossier pédagogique pour soutenir le corps enseignant, les équipes de médiation et des infirmeries. Le déploiement de cet outil est prévu dès la rentrée 2025-2026 dans les établissements scolaires du secondaire II des sept cantons romands.
Une approche pédagogique en deux temps
Chaque thématique se compose de deux parties. La première consiste en un espace interactif, où les élèves incarnent des personnages, accomplissent des missions et explorent différentes situations liées à la violence domestique.
La seconde se veut un espace de réflexion, qui propose des questions et des éléments théoriques pour aider les jeunes à mettre des mots sur les sujets abordés dans le jeu, mieux saisir les dynamiques et faire le lien avec leur réalité. Essentielle, cette deuxième partie apporte des clés de compréhension et encourage une prise de conscience sur la violence domestique et ses conséquences, tout en offrant des ressources pour accéder à de l’aide.
Les contenus du jeu numérique ALTernative
Thématiques
- Introduction au sujet
- Enfants exposés à la violence
- Violence sexuelle et consentement
- Cycle de la violence
- Cyberviolence
Messages clés
- Ne pas s’isoler, en parler.
- Les victimes de violence ne sont pas responsables de la situation.
- Il existe des ressources pour aider les victimes, témoins et auteur·es.
- Il existe toujours plusieurs manières d’agir et de réagir face à la violence.
Points de vue vécus
- Victime
- Témoin
- Personne auteure
En complément
- Aspects légaux
- Ressources
La violence domestique constitue un enjeu de santé publique majeur en Suisse, touchant de nombreuses personnes, y compris les jeunes. En 2024, plus de 21’000 infractions liées à la violence domestique ont été signalées à la police, révélant l’ampleur inquiétante de ce phénomène. Parmi les victimes, les femmes sont largement surreprésentées (70%), soulignant la dimension genrée de cette violence.
Les mineur·es sont également concerné·es. En Suisse, 16% des victimes recensées en 2024 ont moins de 18 ans. Les études internationales montrent que les taux de violence augmentent considérablement à l’adolescence et atteignent un pic au début de l’âge adulte. Les adolescent·es et les jeunes adultes sont aussi touché·es dans leurs propres relations, démontrant la nécessité de sensibiliser et d’éduquer précocement sur ce problème. Dans cette perspective, l’intérêt des supports numériques à composante ludique est reconnu.
(NIB avec egalite.ch)
En savoir plus sur le jeu ALTernatives
-
Ancien médecin cantonal vaudois, Jean Martin partage sa lecture de l’ouvrage « Des regards et des maux » (ed. Favre) signé de son confrère fraîchement retraité, François Pilet.
Réflexion de Jean Martin, ancien médecin cantonal vaudois
 « Mettre le patient au centre » est un principe mis en évidence et pratiqué — parfois revendiqué ! — avec de plus en plus d’insistance depuis des années. C’est bien sûr adéquat et nécessaire.
« Mettre le patient au centre » est un principe mis en évidence et pratiqué — parfois revendiqué ! — avec de plus en plus d’insistance depuis des années. C’est bien sûr adéquat et nécessaire.À la retraite de son activité de médecin généraliste de depuis peu, François Pilet a rassemblé des notes prises au cours du temps à propos de patient·es et d’expériences marquantes. Enrichissant, en partie, ses « Cartes blanches » publiées dans la Revue médicale suisse, il a abouti à Des regards et des maux.
Cet ouvrage scindé en deux parties majeures — « Une présence face à face » et « Une présence côte à côte » — compile vingt-deux histoires, témoignages de sa pratique dans le Bas-Valais. Autant d’illustrations remarquables de ce que peut être la médecine de famille généraliste dans une localité, une région, y compris avec un engagement civil, des initiatives et la mise en place d’activités dans le domaine de la santé et du social, en liaison avec les autorités. Marque de la qualité du lien de François Pilet avec ses patient·es, plusieurs d’entre elles et eux ont souhaité apparaître avec leurs vrais prénoms, et non à travers des identités d’emprunt.
Au-delà de la technologie, le lien humain
François Pilet témoigne dans son récit de la même qualité de continuité et de disponibilité au cours du temps que celle connue par les généralistes fréquentés par le sus-signé durant son assistanat à l’Hôpital de St-Loup, dans le Jura vaudois, dans les années 60. Chacun dans son village, chacun « pendu à un clou » 330 jours par an ou presque, au service de sa région. Si ce n’est que le Dr Pilet a toutefois, sans trop se cacher, pratiqué le jardinage…
Les choses ont changé et c’était indispensable. Au cœur de son Chablais valaisan, François Pilet a su renouveler les modalités de l’exercice médical, notamment par la création, en collaboration et avec le soutien des autorités et de la population, de la Maison de la Santé du Haut-Lac de Vouvry. Un espace interdisciplinaire, au service d’une pratique qui répond aux mutations actuelles, notamment dans l’équilibre entre profession et qualité de la vie privée. Avec une vision importante de santé publique : la collectivité est propriétaire des lieux, ce qui garantit la pérennité du projet, à la différence de centres médicaux « commerciaux ». Et un credo, toujours : celui où la médecin de la personne, du lien à l’autre, de l’attention permettant la rencontre, s’avère plus indispensable que jamais.
François Pilet. Des regards et des maux. Lausanne : Éditions Favre, 2025, 212 pages
-
Ouvrage
La psychomotricienne Anne Dupuis-de Charrière explore les bienfaits d’une approche corporelle du soin, aussi précieuse pour les enfants que pour les adultes, dans un monde où le lien au corps se fragilise.
 Anne Dupuis-de Charrière © Anne Dupuis(REISO) Votre ouvrage, par le biais de cas concrets rencontrés tout au long de votre carrière, montre la multitude de situations que la psychomotricité peut améliorer. Avez-vous le sentiment que les besoins des enfants d’aujourd’hui ont beaucoup changé depuis vos débuts ?
Anne Dupuis-de Charrière © Anne Dupuis(REISO) Votre ouvrage, par le biais de cas concrets rencontrés tout au long de votre carrière, montre la multitude de situations que la psychomotricité peut améliorer. Avez-vous le sentiment que les besoins des enfants d’aujourd’hui ont beaucoup changé depuis vos débuts ?(Anne Dupuis-de Charrière) Les besoins principaux restent identiques : recevoir de l’amour, être respecté·e, éveiller l’admiration même en présence de difficultés qui se traduisent par de l’agitation, des maladresses, des conflits, ou des troubles scolaires et relationnels. Ce qui a changé, se sont surtout les attentes des parents, qui deviennent toujours plus exigeants à l’égard de leurs enfants. En parallèle, les écrans, les outils numériques, et la surabondance de conseils dispensés de toutes parts les détournent d’un certain bon sens. Plutôt que d’installer un bambin devant un écran pour le calmer, il serait préférable de l’emmener jouer dans la nature avec ses copains. L’absence de mouvement et d’activités corporelles nuit à la croissance globale et peut engendrer des retards intellectuels, affectifs ou psychomoteurs.
La psychomotricité est souvent associée à l’enfance ou à l’adolescence comme thérapie pour aider à mieux percevoir son corps dans l’espace, à avoir une bonne coordination, entre autres. Les adultes peuvent-ils·elles aussi profiter de ses bienfaits ?
Oui, absolument. Les adultes ont souvent du mal à se relier à leur corps, prisonnier·ères d’une activité mentale omniprésente. Pourtant, prendre soin de son corps contribue activement à l’équilibre psychique. J’accompagne des hommes et des femmes confronté·es à des blocages physiques, des troubles sexuels, des problèmes de santé, entre autres. Au même titre qu’elles ou ils peuvent consulter un·e psychologue ou un·e ostéopathe, ils·elles peuvent avoir besoin d’un·e psychomotricien·ne. D’ailleurs, bon nombre d’adultes se tournent vers cette approche après avoir observé ses effets positifs chez leurs enfants.
Cette capacité à mobiliser son corps comme outil thérapeutique est unique dans les professions de la santé
Il existe de plus en plus de thérapies ou de méthodes pour améliorer son état physique ou psychique. Quelle est la force de la psychomotricité ?
Ce qui fait la singularité de l’approche en psychomotricité, c’est l’implication du corps du ou de la professionnel·le dans la relation thérapeutique. Nous utilisons non seulement nos connaissances scientifiques, mais aussi notre propre sensibilité corporelle, ce que nous ressentons dans l’interaction avec l’autre. Cette capacité à mobiliser son corps comme outil thérapeutique est unique dans les professions de la santé. Il n’existe pas une réponse standardisée à un problème donné, mais une diversité de propositions, construites à partir de la relation avec le·la patient·e, en s’appuyant sur les connaissances du développement et des apprentissages.
(Propos recueillis par Yseult Théraulaz)
Anne Dupuis-de Charrière, « Voyage en psychomotricité », Éditions ies, décembre 2024, 216 pages
-
La stratégie 2024–2028 du canton mise sur la formation, l’accès équitable aux soins et le soutien aux proches pour mieux accompagner les personnes atteintes de maladies graves ou en fin de vie.
 © Dominik Lange / UnsplashFace à l’augmentation attendue des besoins en soins palliatifs, estimée à 48% d’ici à 2035 dans le canton, le Conseil d’État fribourgeois a adopté en mars 2025 une nouvelle stratégie cantonale couvrant la période 2024 à 2028. Celle-ci entend garantir un accès équitable à des soins de qualité pour toute la population, quels que soient le lieu de vie ou l’âge.
© Dominik Lange / UnsplashFace à l’augmentation attendue des besoins en soins palliatifs, estimée à 48% d’ici à 2035 dans le canton, le Conseil d’État fribourgeois a adopté en mars 2025 une nouvelle stratégie cantonale couvrant la période 2024 à 2028. Celle-ci entend garantir un accès équitable à des soins de qualité pour toute la population, quels que soient le lieu de vie ou l’âge.Pour les professionnel·les du travail social et de la santé, cette stratégie marque un tournant. Elle élargit en effet le champ de la formation palliative au domaine social, incluant les institutions spécialisées, les établissements médico-sociaux, les services à domicile, les structures pour personnes en situation de handicap ainsi que les services de santé mentale. L’objectif est de développer une culture commune de la fin de vie, centrée sur la dignité et les besoins de la personne accompagnée.
Un effort collectif interprofessionnel
Budgétée à hauteur de 695'000 francs, la stratégie repose sur cinq objectifs principaux, déclinés en huit mesures concrètes. Plusieurs d’entre elles visent à renforcer la formation continue et la coordination entre les actrices et acteurs de terrain. Le personnel social, éducatif et soignant bénéficiera d’offres de formation ou de sensibilisation adaptées à ses besoins, en lien avec la pratique palliative. Ce renforcement des compétences est particulièrement pertinent pour les professionnel·les intervenant auprès de personnes vulnérables ou atteintes de maladies chroniques évolutives.
La stratégie prévoit également une accessibilité accrue aux soins jour et nuit, notamment pour les enfants et les personnes en situation de handicap, qui pourront rester dans leur lieu de vie dans la mesure du possible. Le soutien aux proches aidant·es est consolidé par des prestations de relève et d’accompagnement proposées par divers organismes reconnus.
Enfin, l’amélioration de la coordination interprofessionnelle figure parmi les priorités du plan. La création d’une table ronde cantonale vise à faciliter les échanges entre les partenaires et à assurer un suivi régulier des mesures. Une rencontre annuelle permettra d’identifier les freins, de partager les réussites et d’ajuster les actions.
Une stratégie évolutive, en appui aux pratiques de terrain
La stratégie valorise les dynamiques existantes et s’appuie sur les initiatives portées par les institutions locales. Elle reconnaît la nécessité d’un engagement interdisciplinaire pour répondre aux défis croissants liés à la complexité des trajectoires de fin de vie.
En mettant l’accent sur la formation, la coordination, la sensibilisation et l’accompagnement, le canton de Fribourg se dote d’un cadre cohérent et évolutif, qui ambitionne d’offrir aux professionnel·les du travail social et de la santé un appui structuré pour accompagner avec humanité les personnes en situation palliative et leurs proches.
(Source : communiqué)
Voir la « Stratégie cantonale de soins palliatifs ». Direction de la santé et des affaires sociales, Fribourg, 2025, 38 pages
-
Comment sensibiliser les futur·es travailleur·ses sociaux·les aux enjeux environnementaux ? La HETS Fribourg s’empare de la thématique dans un podcast vidéo, dont le premier épisode a été publié fin mars.
 Rahma Bentirou Mathlouthi et Rita Bauwens. Capture d'écran / © HETS-FRSoucieuses de l’importance de répondre aux défis actuels en matière de durabilité, les Hautes écoles romandes ont chacune développé leur stratégie à ce sujet. Pour sa part, la Haute école de Travail social de Fribourg a structuré sa démarche autour de cinq axes principaux : enseignement, recherche et innovation, gouvernance, responsabilité sociétale et campus durable.
Rahma Bentirou Mathlouthi et Rita Bauwens. Capture d'écran / © HETS-FRSoucieuses de l’importance de répondre aux défis actuels en matière de durabilité, les Hautes écoles romandes ont chacune développé leur stratégie à ce sujet. Pour sa part, la Haute école de Travail social de Fribourg a structuré sa démarche autour de cinq axes principaux : enseignement, recherche et innovation, gouvernance, responsabilité sociétale et campus durable.C’est sous la forme d’un podcast vidéo — autrement dit, un entretien filmé — que la professeure et chargée de mission durabilité de la HETS Fribourg, Rahma Bentirou Mathlouthi, a choisi de sensibiliser étudiant·es et professeur·es aux enjeux de justice socio-environnementale. Des chercheur·ses expert·es y partagent leur vision d’une approche interdisciplinaire. Financé principalement par le Domaine Travail Social de la HES-SO, ce projet a bénéficié du soutien institutionnel de la HETS-FR.
Publié le 21 mars dernier, le premier épisode de cette série explore la thématique de l’appréhension de la durabilité et son intégration dans le domaine du travail social par celles et ceux qui y travaillent. Vingt-sept minutes durant, Rahma Bentirou Mathlouthi reçoit sa collègue Rita Bauwens, professeure sur le thème de l’intégration de la durabilité et de la justice socio-environnementale dans la formation du travail social.
Justice socio-environnementale par l’interdisciplinarité
Ce premier épisode traite de la question des ressources, du matériel, d’une charte adéquate ou encore de gouvernance horizontale, autant d’éléments nécessaires à l’intégration de la durabilité dans les pratiques. Mais selon Rahma Bentirou Mathlouthi, la priorité est ailleurs : « les travailleur·ses sociaux·les ne se sentent pas légitimes pour parler de justice environnementale ». Pour y remédier, intégrer ces thématiques de durabilité dans la formation du travail social semble primordial.
À cela s’ajoute la nécessité d’établir un lien étroit avec les instituts et les professionnel·les dans la pratique. « C’est grâce à ce dialogue que l’on pourra faire le lien entre la théorie et la pratique », souligne la professeure, avant de rappeler l’importance d’intégrer la justice socio-environnementale dans les formations professionnelles et pratiques lors des stages à l’étranger. Ce sujet fera d’ailleurs l’objet d’un prochain épisode.
Enregistrées en 2024, les six vidéos de cette série seront publiées mensuellement sur le site de l’école et les réseaux associés. L’objectif est de mettre en lumière des projets de recherche qui sont en cours ou achevés. Parmi eux figure un projet portant sur la transformation des pratiques et politiques de gestion des déchets en Asie du Sud, dirigé par la professeure Swetha Rao Dhananka. Un autre projet international de la HETS, dirigé par Rahma Bentirou Mathlouthi est consacré à l’accès aux ressources naturelles et aux droits des communautés traditionnelles brésiliennes et mexicaines. Plus local, le projet de jardin mosaïque développé par Rita Bauwens directement au sein de l’école fribourgeoise incarne une démarche participative incluant étudiant·es, professeur·es, communes et crèches.
La chargée de mission durabilité considère que « la durabilité est une thématique très récente dans le domaine du travail social. En général, ce qui intéresse les étudiant·es et les professionnel·les, c’est le marché de l’emploi, lequel demande des assistant·es sociaux·les, des éducateur·trices ou des animateur·trices socioprofessionnel·les, mais pas des professionnel·les de la durabilité ». Elle ajoute : « J’ai intitulé ce podcast justice socio-environnementale pour parler davantage aux professionnel·les du travail social, car cela implique des aspects déjà intégrés dans des paradigmes du travail social : la notion de justice, la question des inégalités sociales, la question de la solidarité, de la répartition des richesses, la protection des droits humains… L’interdisciplinarité est donc la voie pour garantir l’intégration de la durabilité dans les enseignements et dans la pratique ».
(Mélissa Henry)
En savoir plus sur le podcast « Justice socio-environnementale et travail social : approches interdisciplinaires ».
Lien vers le deuxième épisode « L’importance de l’approche droit de l’homme comme fondement de la justice socio-environnementale »
-
L’ouvrage «Un café comme métaphore» questionne l’enseignement universitaire et propose une pédagogie participative inspirée de la psychologie communautaire, fondée sur l’horizontalité et le pouvoir d’agir.
 Que ce soit à l’université ou à l’école obligatoire, étudier signifie majoritairement se mettre dans une position d’écoute du corps enseignant. Et même si des discussions émergent et que des exercices permettent aux étudiant·es de ne pas rester passif·ves, le monde de l’enseignement reste très codifié et hiérarchisé.
Que ce soit à l’université ou à l’école obligatoire, étudier signifie majoritairement se mettre dans une position d’écoute du corps enseignant. Et même si des discussions émergent et que des exercices permettent aux étudiant·es de ne pas rester passif·ves, le monde de l’enseignement reste très codifié et hiérarchisé.D’autres approches existent pourtant. C’est ce que démontre l’ouvrage collectif Un café comme métaphore [1]. On y lit ceci : « Le concept de déconfinement universitaire sert ici de tremplin pour amener l’enjeu central de ce livre : l’introduction à l’université des méthodes de pédagogie communautaire participative. L’originalité de l’approche pédagogique suggérée réside dans l’extension de la pensée et des valeurs clés de la psychologie communautaire (libération de l’oppression, participation sociale, promotion de la santé et du bien-être, égalité, pouvoir agir et dire, horizontalité) au contexte de la salle de classe et à la transmission du savoir. »
Réinventer la posture pédagogique
Bien que l’idée de base de cette nouvelle pédagogie puisse se généraliser à tous les types d’enseignements, cet ouvrage parle principalement de celui de la psychologie et de la psychothérapie. Jean-Claude Métraux, pédopsychiatre et chargé de cours à l’Université de Lausanne, est l’un des auteurs. Son ancienne assistante. Moraya Knecht, aujourd’hui psychologue au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) s’exprime ainsi dans un des chapitres : « La pédagogie communautaire participative est pour moi une pédagogie qui se construit par et avec les personnes impliquées dans l’enseignement, de l’enseignant·e aux étudiant·es, en passant par les différents intervenant·es, sur une base d’horizontalité et de participation. (…) L’expertise de chacun·e est reconnue, la transmission du savoir est horizontale. »
Selon ce modèle, chaque personne peut enrichir, développer et faire vivre le contenu théorique. La classe devient ainsi un espace d’échange plutôt que de transmission unilatérale. L’implication de tou·tes les participant·es redéfinit le rapport au savoir : il n’est plus imposé verticalement, mais co-construit dans l’interaction.
(Par Yseult Théraulaz)
[1] Knecht, Moraya et Métraux, Jean-Claude (dir.). Un café comme métaphore. Lausanne : Antipodes, 2024, 160 pages
-
Face à la variété des réglementations et à la complexité des enjeux en matière de remboursement de l’aide sociale pour les jeunes adultes, une nouvelle publication propose un panorama intercantonal.
 © FreepikDe nombreux et nombreuses jeunes en transition vers la vie d’adulte autonome bénéficient de l’aide sociale durant cette phase. C’est notamment le cas pour les care leavers, soit ceux et celles quittant un placement extra-familial. Les raisons d’un soutien de l’aide sociale s’avèrent variées, qu’il s’agisse d’assurer leur subsistance pendant leur formation, parce que les mesures d’intégration professionnelle et sociale sont financées par ce biais ou que, dans certains cantons, les prestations de soutien ambulatoires ou stationnaires de l’aide à l’enfance et à la jeunesse y relèvent au-delà de la majorité. L’aide sociale représente donc un instrument important de sécurité matérielle de base pour ces jeunes.
© FreepikDe nombreux et nombreuses jeunes en transition vers la vie d’adulte autonome bénéficient de l’aide sociale durant cette phase. C’est notamment le cas pour les care leavers, soit ceux et celles quittant un placement extra-familial. Les raisons d’un soutien de l’aide sociale s’avèrent variées, qu’il s’agisse d’assurer leur subsistance pendant leur formation, parce que les mesures d’intégration professionnelle et sociale sont financées par ce biais ou que, dans certains cantons, les prestations de soutien ambulatoires ou stationnaires de l’aide à l’enfance et à la jeunesse y relèvent au-delà de la majorité. L’aide sociale représente donc un instrument important de sécurité matérielle de base pour ces jeunes.En même temps, le recours à l’aide sociale engendre aussi des inconvénients. Ceux-ci peuvent compliquer le passage vers l’autonomie, déjà exigeant en soi. Malgré des besoins effectifs, ces freins peuvent conduire les jeunes à renoncer à faire appel aux prestations ou à les refuser. Cela peut alors entraver leur participation à la société.
L’un des désagréments porte sur l’obligation de rembourser l’aide sociale perçue, en vigueur dans certains cantons. En effet, en l’absence de loi fédérale sur l’aide sociale, les dispositions relatives au remboursement sont régies par les législations cantonales en matière d’aide sociale. Celles-ci diffèrent fortement les unes des autres. Par exemple, dans certains cantons, l’exécution de l’aide sociale est entièrement ou partiellement déléguée aux communes.
Face à cette complexité, le Centre de compétences Leaving Care a élaboré un aperçu des réglementations cantonales relatives à l’obligation de remboursement. Ce document de référence a pour but de clarifier les règles cantonales correspondantes et d’aider les personnes concernées à s’y orienter. Les professionnel·les de l’accompagnement des jeunes ou les care leavers elles et eux-mêmes y trouvent des données fiables. Cette publication contribue ainsi à la prévention de phénomènes générés par des informations lacunaires ou erronées, tels que l’endettement des jeunes ou le non-recours à des prestations de soutien.
(Source : Centre de compétences Leaving Care)
Plus d’informations ou télécharger l’aperçu des bases légales cantonales
Lire également :
- Marie-Thérèse Hofer, Beatrice Knecht Krüger et Natascha Marty, «Un cadre approprié sur la voie de l’autonomie», REISO, Revue d’information sociale, publié le 22 avril 2024
-
AvenirSocial a publié récemment la quatrième édition de sa Chronologie de l’aide sociale en Suisse 2000–2024. Retour sur 430 interventions et décisions politiques en matière d’aide sociale.
 La quatrième édition de la Chronologie de l’aide sociale en Suisse met en lumière les dynamiques territoriales, les actrices et acteurs impliqué·es et les tendances à l’œuvre dans ce champ souvent débattu, situé au cœur des politiques publiques. Rédigée par la professeure HES Véréna Keller, la chronologie offre une mise en perspective de chaque événement, présenté avec la date, les entités concernées, les enjeux politiques, le niveau institutionnel (commune, canton, Confédération) et, cas échéant, les conséquences sur la pratique qui en découlent.
La quatrième édition de la Chronologie de l’aide sociale en Suisse met en lumière les dynamiques territoriales, les actrices et acteurs impliqué·es et les tendances à l’œuvre dans ce champ souvent débattu, situé au cœur des politiques publiques. Rédigée par la professeure HES Véréna Keller, la chronologie offre une mise en perspective de chaque événement, présenté avec la date, les entités concernées, les enjeux politiques, le niveau institutionnel (commune, canton, Confédération) et, cas échéant, les conséquences sur la pratique qui en découlent.Ce rapport « cherche à retracer la genèse des décisions et le développement de tendances dans leur contexte temporel, géographique et politique ». De plus, il « vise à permettre l’analyse des intentions et principes des acteurs et actrices impliqué·es dans les démarches et les décisions » (p. 6). L’intention est aussi pédagogique, en donnant à voir l’histoire de l’aide sociale non comme une suite de cas isolés, mais comme un processus en mouvement.
De la contractualisation à la responsabilisation
Le rapport met en évidence une tendance marquée depuis les années 2000 : la montée d’une logique de contractualisation et de conditionnalité. Notamment l’introduction, par le canton de Zurich, de mesures conditionnant les prestations à la participation à des programmes d’insertion. Cette approche reflète une évolution vers une responsabilisation accrue des bénéficiaires.
À l’échelle nationale, la CSIAS (Conférence suisse des institutions d’aide sociale) adapte ses recommandations pour intégrer ces logiques d’activation. Dans plusieurs cantons, ces modifications s’accompagnent d’un durcissement du discours politique. En effet, les bénéficiaires de l’aide sociale ne se voient pas reconnaître la capacité juridique et la capacité d’agir pour mener une vie autonome et responsable au même titre que les autres personnes. Les possibilités de participation et d’intégration, ainsi que leurs droits, sont donc fortement entravées. Néanmoins, depuis la crise du Covid-19, plusieurs interventions visent à promouvoir l’égalité de traitement en matière d’aide sociale des personnes n'ayant pas la nationalité suisse.
Harmonisation en marche, disparités persistantes
L’autre grande tendance observée concerne les tentatives d’harmonisation des pratiques. Si le système fédéral laisse une large marge de manœuvre cantonale, plusieurs initiatives cherchent à réduire les écarts. Neuchâtel a adopté un modèle de suivi différencié harmonisé, qui s’inscrit dans le cadre du programme RAISONE, « repenser l’aide sociale neuchâteloise ». Initié en 2013, celui-ci vise à moderniser et harmoniser les pratiques cantonales en matière d’aide sociale.
Dans le canton de Vaud, la réforme de l’aide sociale, entrée en vigueur en 2016, introduit un cadre plus structuré pour l’évaluation des situations et la gestion des prestations. Elle est perçue comme un compromis entre exigences budgétaires et respect de la dignité des bénéficiaires. Les écarts intercantonaux restent cependant considérables, tant en matière de montants versés que de critères d’octroi.
Ce travail permet aussi de suivre les réformes emblématiques, comme celle de Genève, où l’adoption en 2023 de la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité constitue un tournant. Prévu pour entrer en vigueur en 2025, ce texte entend simplifier les procédures, renforcer l’orientation professionnelle, et instaurer un accompagnement mieux adapté.
Dans le Jura, la révision de la loi sur l’action sociale, adoptée en 2019, marque également une étape. Elle introduit une approche participative avec les bénéficiaires, intégrant des outils d’évaluation plus souples. L’objectif est de favoriser une meilleure coopération entre travailleur·ses sociaux·ales et bénéficiaires, tout en assurant un suivi individualisé.
Le rapport souligne encore qu’en 2023, le taux d’aide sociale en Suisse est tombé à 2,8% (source OFS), niveau le plus bas depuis vingt ans. Selon l'autrice, ce chiffre, qui pourrait faire figure de bonne nouvelle à première vue, mérite toutefois d’être nuancé : cette baisse globale masque des réalités très diverses, notamment des exclusions administratives, le phénomène du non-recours ou encore un durcissement des critères d’accès.
Un outil au service de la profession
Gratuite et librement accessible, cette chronologie s’adresse en priorité aux professionnel·les du travail social. Elle constitue un outil de référence pour documenter les politiques publiques, analyser les pratiques et nourrir les réflexions sur l’évolution du système et des métiers de l’aide sociale. Ce document peut également servir de base pour la formation et la production de savoirs collectifs.
Enfin, ce rapport rappelle que l’aide sociale, souvent perçue comme une réalité administrative ou comptable, relève avant tout d’enjeux politiques, éthiques et sociétaux, en constante évolution.
(Par Mélissa Henry)
Télécharger le rapport en français
Véréna Keller. « Chronologie aide sociale en Suisse 2000-2024 ; Gérer la pauvreté ». AveniSocial, Berne, 2025, 175 pages
-
Si la gestion de la prévoyance professionnelle peut sembler complexe de prime abord, de nombreuses sources d’information sont disponibles pour guider les personnes assurées. Rappel et tour d’horizon.
 © FreepikLa prévoyance professionnelle ou deuxième pilier constitue une matière ardue qui peut se révéler difficile à appréhender. Pour en faciliter la compréhension, les institutions publiques concernées proposent différents outils et services accessibles à toutes et tous. À l’occasion du quarantième anniversaire de la Loi sur la prévoyance professionnelle, Sécurité Sociale CHSS rappelle les principaux d’entre eux.
© FreepikLa prévoyance professionnelle ou deuxième pilier constitue une matière ardue qui peut se révéler difficile à appréhender. Pour en faciliter la compréhension, les institutions publiques concernées proposent différents outils et services accessibles à toutes et tous. À l’occasion du quarantième anniversaire de la Loi sur la prévoyance professionnelle, Sécurité Sociale CHSS rappelle les principaux d’entre eux.En premier lieu, le site internet de l’Office fédéral des assurances sociales fournit de nombreuses données générales sur les principes de la prévoyance professionnelle, les prestations servies par cette assurance sociale, les droits des assuré·es et les devoirs des entités employeuses. On y trouve également un aperçu des réformes et révisions. À relever que les informations de base sont aussi proposées en version facile à lire, en langue des signes ou sous forme de vidéo.
La section « Questions et réponses » constitue une autre ressource clé. Elle aborde de manière très concrète les différents aspects du deuxième pilier en répondant à une série de demandes fréquemment formulées. Les sujets portent sur les obligations des entités employeuses et les droits des personnes assurées en passant par les prestations servies en cas d’invalidité, de vieillesse et de décès.
Ces questions-réponses couvrent de nombreux thèmes, tels que la perception des cotisations, leur partage entre l’employeur et l’employé ; la nature des prestations versées en cas d’invalidité, de vieillesse et de décès pour la personne assurée elle-même et ses proches ; le libre passage lors de changement d’entité employeuse ou de pause professionnelle ; les enjeux de couverture des besoins futurs, les questions autour du financement de l’acquisition d'un logement à l’aide de son avoir de prévoyance ; la répartition des avoirs de prévoyance en cas de divorce.
La section questions-réponses est régulièrement mise à jour afin de refléter les changements législatifs et les évolutions dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Elle permet une information générale pour cette matière complexe à appréhender.
Retrouver des avoirs de prévoyance égarés
Il arrive que les personnes assurées oublient l’existence de leur avoir de libre passage, notamment dans les cas où elles changent d’entité employeuse ou quittent définitivement la Suisse. La brochure Prestation de libre passage : n’oubliez pas vos avoirs de prévoyance a été créée pour expliquer le libre passage et informer les personnes concernées des démarches à entreprendre pour retrouver leur avoir. Le document rappelle également la procédure lorsqu’une personne quitte son entité employeuse et quelles sont les données qu’elle doit communiquer à l’institution de prévoyance de sa nouvelle entité employeuse.
La publication présente les options existantes dans différentes situations de vie, qu’il s’agisse d’un divorce, d’une période de chômage ou d’un cas d’invalidité sans employeur par exemple. Elle précise encore les implications fiscales du libre passage et aborde les conditions permettant un retrait de l’avoir avant l’âge de la retraite.
La Centrale du deuxième pilier constitue une institution essentielle pour protéger les personnes assurées dans le cas où leurs avoirs de prévoyance seraient perdus ou « oubliés » suite à un changement d’emploi ou un déménagement à l’étranger. Sa mission consiste à rétablir les contacts rompus entre les assuré·es et les institutions. En effet, si une personne salariée change d’employeur ou quitte la Suisse définitivement sans transférer ses avoirs de prévoyance dans une nouvelle institution de prévoyance ou auprès d’une institution de libre passage, ces fonds peuvent « se perdre » ou s’avérer difficiles à retrouver pour la personne assurée.
C’est dans cette situation que la Centrale du deuxième pilier intervient. Les assuré·es la sollicitent afin de retrouver leurs avoirs de prévoyance en soumettant une demande accompagnée d’informations personnelles et professionnelles détaillées. Ces informations aident la Centrale à identifier leurs avoirs de prévoyance et à les localiser. Le formulaire de recherches existe en plusieurs langues ce qui favorise l'accessibilité de ce service et facilite les démarches des personnes assurées.
Suivre les évolutions du deuxième pilier
Plus pointu, le Bulletin de la prévoyance professionnelle constitue un outil précieux pour qui souhaite suivre l’actualité et l’évolution de la prévoyance professionnelle. Paraissant plusieurs fois par année, il apporte des réponses à des questions d’intérêt général émanant des citoyen·nes comme des actrices et acteurs de la prévoyance professionnelle.
La publication spécialisée comporte des indications, par exemple sur des changements de réglementation, des prises de position sur des questions actuelles et des résumés de jurisprudences. Elle reflète l’évolution de la Loi sur la prévoyance professionnelle au fil du temps et présente l’ensemble des changements législatifs, en couvrant aussi bien les différentes réformes des lois que les modifications d’ordonnances.
Pour favoriser la compréhension de ces changements législatifs, ces multiples dispositions sont commentées et des prises de position sous forme de questions-réponses sont publiées. Les sujets sont facilement consultables, que ce soit par le biais de compilations par thèmes ou par le répertoire qui propose une recherche par mots-clés. Il est également possible de s’y abonner.
(NIB avec Sécurité sociale CHSS)
Consulter le site internet de l’OFAS, sa section Questions et réponses ou le site internet de la Centrale du 2e pilier
Télécharger la brochure La prévoyance vieillesse suisse — L’essentiel expliqué simplement
Consulter le Bulletin de la prévoyance professionnelle
-
Court-métrage
Poétique, sensible et authentique, le court-métrage « Gigi » de Cynthia Calvi, diffusé sur Arte, vaut le détour. Ce documentaire animé d’une quinzaine de minutes raconte le parcours de vie d’une personne transgenre.
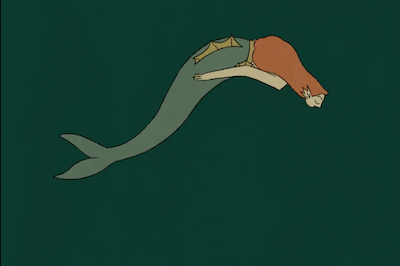 Capture d'écran © ArteGigi est un petit garçon « avec une personnalité de fille », en proie à tout un tas de questions face aux nombreuses injonctions qu’il découvre année après année. Ayant du mal à se concentrer, ce personnage accuse un retard scolaire : on lui diagnostique un trouble autistique. Était-ce parce qu’il sortait du cadre, qu’il refusait les normes de genre et souhaitait s’en détacher ?
Capture d'écran © ArteGigi est un petit garçon « avec une personnalité de fille », en proie à tout un tas de questions face aux nombreuses injonctions qu’il découvre année après année. Ayant du mal à se concentrer, ce personnage accuse un retard scolaire : on lui diagnostique un trouble autistique. Était-ce parce qu’il sortait du cadre, qu’il refusait les normes de genre et souhaitait s’en détacher ?Ce court-métrage présenté par Arte soulève ici la question de la pathologisation du genre. Malgré une évolution de la société en la matière, à commencer par le retrait de la transidentité de la catégorie des maladies mentales (CIM-11) par l’OMS en 2019, les professionnel·les de santé se doivent de faire preuve de vigilance. Le personnel formé apprend à ne pas stigmatiser ni pathologiser le genre, mais au contraire à reconnaître la diversité des parcours, et surtout faire preuve d’écoute active et de respect de l’individualité, afin d’accompagner au mieux chaque personne dans sa transition.
A son grand soulagement, Gigi parviendra à sortir de l’école spécialisée grâce à sa mère. Mais iel fera face au discours sévère de son père, qui veut remettre son enfant sur « le droit chemin », celui dans lequel précisément iel ne se reconnaît pas. Ce faux-semblant lui permettra de se mettre dans le moule quelques années durant. En parlant de moule, le film utilise avec poésie la métaphore filée de la sirène, cette créature aquatique mi-femme, mi-poisson, cette « femme avec une queue ». Un récit aussi sincère que touchant.
(Mélissa Henry)
Voir «Gigi», de Cynthia Calvi, disponible sur Arte
-
Après le Valais, le canton de Neuchâtel est le deuxième canton romand à diffuser ses prestations sociales via cet outil numérique qui recense l’offre dans les domaines du handicap, de l’addiction et de la précarité.
 © maplace.chDepuis le mois de mars, le canton de Neuchâtel a intégré la plateforme maplace.ch. Cette interface en ligne gratuite recense les prestations proposées par les institutions sociales dans les domaines du handicap, de l’addiction et de la grande précarité. Les offres y sont présentées par canton et par site géographique. Sont notamment répertoriés les logements, centres de jour et ateliers, avec des informations actualisées sur le nombre de places disponibles.
© maplace.chDepuis le mois de mars, le canton de Neuchâtel a intégré la plateforme maplace.ch. Cette interface en ligne gratuite recense les prestations proposées par les institutions sociales dans les domaines du handicap, de l’addiction et de la grande précarité. Les offres y sont présentées par canton et par site géographique. Sont notamment répertoriés les logements, centres de jour et ateliers, avec des informations actualisées sur le nombre de places disponibles.Pensé pour les personnes concernées, les proches et les professionnel·les, cet outil numérique vise à faciliter l’accès à l’information sur les dispositifs existants. Une version en langage facile à lire et à comprendre sera prochainement disponible pour les utilisatrices et utilisateurs du canton de Neuchâtel.
Un dispositif élargi à dix-sept cantons
La fiabilité de maplace.ch repose sur un contrôle régulier assuré par un groupe d’auto-représentant·es et d’organisations spécialisées. Avec cette adhésion, Neuchâtel devient le dix-septième canton suisse à publier ses prestations sur cet outil numérique. Jusqu’alors, le Valais était le seul canton romand à l’utiliser.
(Source : communiqué de presse)
-
Ouvrage
Dans «Imaginer les soins primaires de demain», des pistes se dessinent pour une meilleure prise en charge la population. Trois questions à Nicolas Senn, médecin chef du Département de médecine de famille à Unisanté.
 Nicolas Senn © Unisanté(Reiso) Nicolas Senn, le livre « Imaginer les soins primaires de demain », dont vous avez dirigé la publication, compare les soins primaires de la France, la Suisse, le Québec et la Belgique ? La Suisse est-elle bonne élève ?
Nicolas Senn © Unisanté(Reiso) Nicolas Senn, le livre « Imaginer les soins primaires de demain », dont vous avez dirigé la publication, compare les soins primaires de la France, la Suisse, le Québec et la Belgique ? La Suisse est-elle bonne élève ?(Nicolas Senn) Malheureusement pas. En Suisse, nous avons un système de santé qui est très axé sur la médecine hospitalière et technologique. Nous disposons de beaucoup de ressources, mais nous sommes particulièrement à la traîne en matière d’intégration des soins et du social, ainsi que de soins primaires. Dans le livre, ces derniers sont définis comme un premier niveau d’accès aux services de santé apportant des bénéfices aux individus en matière de santé et de bien-être dans les dimensions physiques, sociales, psychologiques, voire spirituelles.
À propos de la dimension sociale des soins, elle est souvent mise de côté en Suisse par le système de santé. Pourquoi ?
Effectivement, c’est principalement un problème politique, car les modèles financiers actuels ne le permettent pas. Les actes médicaux sont facturés différemment des prestations sociales. La médecine générale est seule de son côté et ne peut que difficilement s’appuyer sur les acteurs sociaux. Pourtant cela se fait en France et au Québec, par exemple, et c’est un avantage pour la population.
Que faudrait-il faire en Suisse pour améliorer les soins primaires ?
Parmi les mesures qui ont fait leurs preuves ailleurs figurent les maisons de santé. Il s’agit de réunir sous un même toit des soignant·es (médecine, physiothérapie, soins infirmiers, ergothérapie, entre autres) et des acteurs sociaux. Le fait de travailler au même endroit permet une réelle synergie et une prise en charge globale de la patientèle. Ces maisons doivent se trouver dans les différents quartiers des villes, être de taille raisonnable, facilement accessibles et disponibles pour toute la population. De telles structures existent ailleurs et elles prodiguent des soins primaires, mais elles réalisent aussi de la prévention et de la promotion de la santé. Cela profite à la société et coûte beaucoup moins cher que de se rendre aux urgences hospitalières, par exemple.
(Propos recueillis par Yseult Théraulaz)
[1] Imaginer les soins primaires de demain, sous la direction de Nicolas Senn, RMS Editions, 2025, 377 pages
-
Longtemps publiée en allemand sous le nom de ZESO, la revue spécialisée de la CSIAS devient bilingue. Dès cette année, elle paraît en français et en allemand, avec un premier numéro consacré au logement en situation de précarité.
 Depuis 1903, la revue spécialisée de la CSIAS fournit des rapports et des analyses sur les thèmes actuels de l’aide sociale, de la politique sociale, de la science et des institutions sociales, en allemand seulement. Ce magazine répond aux questions relatives à la pratique, à l’interprétation et à l’application du droit de l’aide sociale, présente des projets innovants et donne la parole aux personnes actives dans le domaine social.
Depuis 1903, la revue spécialisée de la CSIAS fournit des rapports et des analyses sur les thèmes actuels de l’aide sociale, de la politique sociale, de la science et des institutions sociales, en allemand seulement. Ce magazine répond aux questions relatives à la pratique, à l’interprétation et à l’application du droit de l’aide sociale, présente des projets innovants et donne la parole aux personnes actives dans le domaine social.Depuis 2021, une petite sélection d’articles est publiée dans un magazine en ligne en langue française. Et depuis cette année, le magazine spécialisé de la CSIAS « L’aide sociale », anciennement nommé ZESO, sera publié en allemand et en français.
La revue paraîtra quatre fois par an, et sera aussi disponible à E-Periodica de la Bibliothèque ETH, qui s’est occupée de la digitalisation de toutes les éditions de la ZESO et du titre qui l'a précédé, intitulé Armenpfleger. Le premier numéro est consacré au logement dans les situations de précarité.
(Source : CSIAS)
-
Apaiser le stress, améliorer l’attention et renforcer la confiance en soi: la méditation de pleine conscience offre de nombreux bienfaits. Un ouvrage propose aux professionnel·les de l’enfance un programme de huit semaines.
 © Vitolda Klein / UnsplashLa méditation de pleine conscience suscite un intérêt croissant depuis plusieurs années et de nombreuses études en démontrent les bienfaits. Une pratique régulière réduit le stress, l’anxiété et les angoisses. Elle aide à mieux gérer ses émotions et renforce la confiance en soi.
© Vitolda Klein / UnsplashLa méditation de pleine conscience suscite un intérêt croissant depuis plusieurs années et de nombreuses études en démontrent les bienfaits. Une pratique régulière réduit le stress, l’anxiété et les angoisses. Elle aide à mieux gérer ses émotions et renforce la confiance en soi.Chez les enfants, la méditation de pleine conscience est également un bon outil pour soutenir celles et ceux qui souffrent de troubles du déficit de l’attention, du spectre autistique, du langage, de troubles dys ou moteurs, entre autres. Ainsi, le livre de l’enseignante spécialisée genevoise Julie Bosson [1] s’adresse aux logopédistes, pédopsychologues, ergothérapeutes, psychomotricien·nes ou encore enseignant·es spécialisé·es. Il propose un programme de huit semaines, le classique Mindfulness-Based Stress Reduction, adapté aux enfants de 7 à 12 ans et aux groupes.
Les huit séances y sont détaillées avec des explications théoriques et des indications pour la mise en activité. Les méditations sont disponibles via un QR code menant à des fichiers audios. La séance ne s’arrête pas à la fin de la partie audioguidée : des moments de discussion — appelés dialogues exploratoires — sont prévus après chaque exercice. Ils permettent à l’adulte et aux enfants de partager librement leur expérience et de réfléchir à l’utilité de chaque méditation en fonction des besoins individuels. Entre méditation, échanges et mise en place, les séances durent entre trente et soixante minutes. Il convient donc de prévoir suffisamment de temps pour accompagner les groupes à chaque étape.
Par un travail sur l’instant présent et l’attention, la méditation pleine conscience se révèle être une alliée efficace contre l’agitation et pour l’amélioration des résultats scolaires. On peut lire : « Une augmentation significative des performances scolaires est observée dans les études à la suite d’une intervention de pleine conscience, avec une hausse moyenne de 11% ! (…) Les deux raisons principales sont l’amélioration des fonctions exécutives et le développement de la confiance en soi, qui permettent à l’enfant de se sentir plus à l’aise dans sa classe et de s’épanouir. »
(Yseult Théraulaz)
[1] Julie Bosson, Le petit programme pour améliorer l’attention, les compétences sociales, la gestion émotionnelle, De Boeck Supérieur, 2024, 176 pages
-
Outil de cohésion sociale par excellence, mais aussi précieux allié pour la santé, la musique passionne le journaliste et pianiste québécois Michel Rochon qui a écrit plusieurs livres sur le sujet. Interview.
 Michel Rochon © Pierre Tonietto(REISO) Michel Rochon,votre dernier ouvrage « Comment la musique transforme notre cerveau » passe en revue un nombre incroyable d’études sur la question. Pourquoi cet art est-il si étudié par le monde scientifique ?
Michel Rochon © Pierre Tonietto(REISO) Michel Rochon,votre dernier ouvrage « Comment la musique transforme notre cerveau » passe en revue un nombre incroyable d’études sur la question. Pourquoi cet art est-il si étudié par le monde scientifique ?(Michel Rochon) La musique est le premier langage de l’humanité. Bien avant de construire une langue, les êtres humains ont utilisé leurs cordes vocales pour émettre des sons plaisants et communicatifs. Ils et elles utilisaient leur voix — et par la suite des percussions, pour tous leurs rituels : pour se donner du courage avant de partir à la chasse, pour avoir de bonnes récoltes, pour la guerre, l’amour, les religions, etc. La musique est un excellent outil de cohésion sociale, mais aussi un moyen unique pour stimuler le cerveau. D’une part, son écoute déclenche la libération d’un grand nombre de messagers chimiques qui affectent l’humeur et le développement ; et d’autre part, elle active plus de trente régions cérébrales. C’est un véritable feu d’artifice pour le cerveau ! Les autres formes d’art n’ont pas cet effet. Un grand nombre de chercheur·euses à travers le monde se sont donc intéressé·es à la musique tout simplement parce qu’elle permet d’étudier en détail le fonctionnement du cerveau.
Dans votre livre, vous expliquez comment la musique apporte des bienfaits de la naissance à la vieillesse. Pouvez-vous détailler ?
La première musique que l’être humain entend est celle perçue dans le ventre de la mère. Écouter un vaste choix de styles musicaux est important pour le bon développement de l’enfant et pour sa plasticité cérébrale. À l’adolescence, le ou la jeune va chercher à rejeter ses parents et va se tourner vers des formes musicales qui lui sont propres. Cette période est très importante, car des études ont démontré que la musique écoutée entre l’âge de 15 et 25 ans détient un pouvoir intéressant bien plus tard. En effet, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à qui l’on propose des chansons qui leur plaisaient à cette période de la vie parviennent à retrouver de l’entrain et à s’éveiller aux sons de ces mélodies. La musique stimule leur mémoire associative. Les effets de la musicothérapie en tant que médecine de compassion sont nombreux.
 © Yohan Marion / Unsplash
© Yohan Marion / UnsplashQuels sont ces effets plus précisément ?
Que ce soit pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, pour celles qui souffrent de Parkinson ou celles qui se remettent d’un accident vasculaire cérébral, la musicothérapie est une aide précieuse. Les malades de Parkinson réussissent à se mouvoir avec moins de tremblements en pratiquant des mouvements rythmés sur de la musique. Ces personnes arrivent alors à marcher de manière plus fluide. Quant aux victimes d’un AVC, le fait de combiner les approches habituelles de rééducation avec de la musicothérapie contribue à accélérer les progrès. Dans le cas de démence, de maladies mentales, d’autisme, entre autres, l’écoute de la musique a des effets apaisants. Elle ne soigne pas, mais elle améliore le quotidien.
Des études ont démontré que la musique écoutée entre l’âge de 15 et 25 ans détient un pouvoir intéressant bien plus tard
Nous avons beaucoup parlé des effets de la musique sur les personnes malades, mais qu’en est-il pour celles qui sont en bonne santé ?
Chaque personne réagit différemment vis-à-vis de la musique. Pour certaines, elle est indispensable, pour d’autres c’est juste un agréable passe-temps. Tout cela dépend de composantes héréditaires, prénatales, sociales, des choix des parents également. Une chose est sûre, en période de confinement pendant la pandémie de covid, la musique a apporté beaucoup de soulagement. Le fait d’en écouter véhicule de nombreuses émotions et active le cerveau. Mais ce qui lui est encore plus bénéfique, c’est la pratique d’un instrument. Cela améliore la mémoire et la concentration, aide à l’apprentissage d’une langue et à la réussite scolaire, entre autres.
A contrario, la musique peut-elle nuire à la santé ?
À ma connaissance, aucune étude ne s’est penchée sur cette question. Assurément toutefois, la musique ne possède pas le pouvoir de rendre malade. Une personne qui a des idées suicidaires ne va pas passer à l’acte à cause d’une mélodie en particulier. A l’inverse, lors des différents Salons du livre auxquels j’ai participé, plusieurs lecteur·trices sont venu·es me voir pour partager à quel point écouter certaines chansons les ont aidé·es à sortir de leur dépression.
(Propos recueillis par Yseult Théraulaz)
Michel Rochon, « Comment la musique transforme le cerveau », Ed. Quanto, 2024, 216 page
-
Dans son «Kit d’urgence émotionnelle», Géraldine Rousselot-Pailley, auteure et coach de vie, explique les différents maux liés à l’anxiété et différentes méthodes pour y faire face.
 Géraldine Rousselot-Pailley © Ed. Favre(REISO) Géraldine Rousselot-Pailley, votre ouvrage propose un vaste choix de techniques — alimentation, méditation, rangement, fleurs de Bach, massages — pour apprivoiser les troubles psychiques et physiques liés à l’anxiété ? Pourquoi aborder autant d’approches si différentes ?
Géraldine Rousselot-Pailley © Ed. Favre(REISO) Géraldine Rousselot-Pailley, votre ouvrage propose un vaste choix de techniques — alimentation, méditation, rangement, fleurs de Bach, massages — pour apprivoiser les troubles psychiques et physiques liés à l’anxiété ? Pourquoi aborder autant d’approches si différentes ?(Géraldine Rousselot-Pailley) Mon fil conducteur est de proposer des outils pour aller mieux. J’ai volontairement abordé des techniques très différentes afin que tout le monde puisse trouver celle qui lui convient. Ainsi, une personne qui teste une approche et n’en retire aucun avantage peut en choisir une autre. Si vous aimez les plantes, je vous fournis des conseils avec des fleurs de Bach. Si vous préférez chantonner, je vous donne des exercices en ce sens.
Votre livre donne des explications tant sur les symptômes que sur les techniques proposées. Pourquoi autant de théorie ?
À mes yeux, il est important de soutenir le lecteur ou la lectrice dans la compréhension des causes de son mal-être, mais aussi d’éclairer les raisons de l’efficacité des méthodes que je détaille. Un jour, j’ai proposé à une femme de pratiquer de la cohérence cardiaque. Elle trouvait ces inspirations et expirations longues ridicules. Mais lorsque je lui ai détaillé le lien entre les battements cardiaques et le cerveau, elle a compris et s’est mise à pratiquer régulièrement. Les explications sont indispensables pour choisir un outil qui nous parle et que l’on va utiliser, car convaincu·e de son efficacité.
En cas de crise d’angoisse, n’est-il cependant pas difficile de se mettre à choisir un outil alors que les émotions débordent ?
Pour qu’un outil fonctionne, il faut l’entraîner. Ainsi, le mieux est de chercher des techniques qui parlent au lecteur·trice et de les tester avant d’être dans une situation de crise. Un grand nombre de personnes ressentent des maux physiques liés à un déséquilibre émotionnel. Elles savent que quelque chose ne va pas. Mon livre veut les aider à décrypter leurs symptômes et à tester différentes méthodes pour les gérer. Je partage aussi des astuces que l’on peut effectuer en fonction du lieu où l’on se trouve : dans les transports en commun, au travail, etc. Ainsi, il y a un soutien dans chaque circonstance.
(Propos recueillis par Yseult Théraulaz)
Géraldine Rousselot-Pailley, Mon kit d’urgence émotionnelle, Ed. Favre, 2025, 216 pages
-
Essai sociologique
«Vieillir en Suisse» est un essai sociologique qui donne une vision globale du troisième âge et qui contribue à mieux comprendre le quotidien des personnes concernées.
 Comment la vie se déroule-t-elle une fois passée la barre des 65 ans ? L’image restrictive de retraité·es passifs·ves à la charge de la collectivité encore trop souvent renvoyée cache une réalité bien plus complexe. Publié aux éditions Savoir Suisse, l’essai sociologique Vieillir en Suisse ; Du privé au politique s’emploie ainsi à visibiliser la diversité des situations rencontrées par les seniors en Suisse et à reconnaître leurs engagements en faveur de la société, notamment en matière de bénévolat.
Comment la vie se déroule-t-elle une fois passée la barre des 65 ans ? L’image restrictive de retraité·es passifs·ves à la charge de la collectivité encore trop souvent renvoyée cache une réalité bien plus complexe. Publié aux éditions Savoir Suisse, l’essai sociologique Vieillir en Suisse ; Du privé au politique s’emploie ainsi à visibiliser la diversité des situations rencontrées par les seniors en Suisse et à reconnaître leurs engagements en faveur de la société, notamment en matière de bénévolat.On y apprend, notamment, que la Suisse ne fait pas office de bon élève en matière de vieillissement. En effet, les contextes économiques, sociaux et politiques propres à chaque pays influencent beaucoup la manière dont les personnes avancent en âge. Le système de prévoyance vieillesse suisse, avec ses trois piliers, favorise les individus ayant travaillé toute leur vie à plein temps en touchant des salaires confortables. En d’autres termes, les hommes bénéficient très fréquemment d’une retraite plus confortable que les femmes. Ce constat est valable également pour les personnes d’origines étrangères qui occupent souvent des postes professionnels moins qualifiés, engendrant une retraite moins confortable.
L’ouvrage montre également que vieillir et s’appauvrir vont malheureusement souvent de pair. Si, 9,2% de la population globale est pauvre, ce chiffre s’élève à 16,5% chez les 65 ans et plus. Marion Repetti et Farinaz Fassa s’efforcent également à identifier les facteurs qui favorisent, ou à l’inverse empêchent, le maintien d’une existence de qualité et d’un statut de citoyen·ne à part entière tout au long de la vie.
Les différentes inégalités sont ainsi pointées du doigt dans cet essai très complet. Il aborde la fracture numérique, les enjeux démographiques, les discriminations, entre autres, mais dresse aussi des pistes pour mieux inclure les seniors dans la société. Car, les deux autrices précisent bien que « la vieillesse ne concerne pas seulement une partie de la population, mais nous touche toutes et tous dans notre vie collective et intime, même si nous ne sommes souvent pas conscients des effets physiques, sociaux, économiques et politiques que vieillir aura sur nos conditions de vie, nos interactions et notre place sociale, au moins tant que nous n’y sommes pas directement confrontés. »
(YT)
Marion Repetti et Farinaz Fassa, «Vieillir en Suisse», Savoir Suisse, 2024, 168 pages
-
Intitulé «Les Uns & les Autres», le nouveau journal de l’Hospice général vise à informer sur les thématiques sociales à Genève et à renforcer le lien entre les différents acteurs de l’institution.
 © Hospice général« Le journal au service du lien social. » C’est ainsi qu'est sous-titrée la nouvelle publication de l'Hospice général, qui ambitionne de servir de pont entre les bénéficiaires, les partenaires et les collaborateur·trices de l’institution genevoise.
© Hospice général« Le journal au service du lien social. » C’est ainsi qu'est sous-titrée la nouvelle publication de l'Hospice général, qui ambitionne de servir de pont entre les bénéficiaires, les partenaires et les collaborateur·trices de l’institution genevoise.Dans son éditorial, le directeur Christophe Girod souligne que ce premier numéro « voit le jour dans un contexte de grands changements pour notre institution », marqué notamment par une hausse du nombre de bénéficiaires et de collaborateur·trices. Ces évolutions sont le reflet des défis sociaux actuels, alors que l’entrée en vigueur de la nouvelle loi cantonale sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité constitue « un tournant dans la politique sociale du canton ». Un dossier spécial y est consacré.
Ce numéro inaugural propose également des témoignages de bénéficiaires, de partenaires et de collaborateur·trices sur l’intégration professionnelle, ainsi que des articles traitant d’autres enjeux sociaux. Des rubriques dédiées à la vie de l’institution et au travail social à Genève complètent cette publication.
(CROC)
Lire le premier numéro de Les Uns & les Autres
-
Une étude nationale analyse pour la première fois le secteur social dans son ensemble. Verdict ? La situation est tendue et les conditions appelées à se détériorer à l'avenir.
 © Lordn / Adobe StockDes chiffres représentatifs sur la situation du personnel qualifié pour l’ensemble du secteur social en Suisse : pour la première fois dans le pays, des employeur·ses de toutes les régions et de tous les champs d’activité ont été interrogé·es dans le cadre d’une étude mandatée par Savoirsocial, organisation faîtière suisse pour la formation professionnelle du domaine social, et la Sassa, Conférence des Hautes écoles spécialisées suisses de travail social.
© Lordn / Adobe StockDes chiffres représentatifs sur la situation du personnel qualifié pour l’ensemble du secteur social en Suisse : pour la première fois dans le pays, des employeur·ses de toutes les régions et de tous les champs d’activité ont été interrogé·es dans le cadre d’une étude mandatée par Savoirsocial, organisation faîtière suisse pour la formation professionnelle du domaine social, et la Sassa, Conférence des Hautes écoles spécialisées suisses de travail social.L’étude fournit non seulement des données actuelles sur les employé·es et leurs formations, mais également sur les fluctuations de personnel et les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises. Une conclusion s’impose d’emblée : la tension qui caractérise la situation du personnel qualifié impose désormais des mesures ciblées pour garantir la qualité des prestations dans le domaine social. Les employeur·ses font dès lors face à des défis considérables. Les entreprises et les organisations sociales doivent jongler avec des emplois de courtes durées, de fréquents changements de poste et la nécessité de faire des compromis pour parvenir à repourvoir les emplois vacants. Ces difficultés se traduisent également par une charge supplémentaire pour les employé·es. Un regard vers l’avenir laisse entrevoir qu’aucune amélioration ne sera possible sans mesures concrètes, qu'il incombe à l’ensemble des acteurs et actrices de déterminer.
Des points positifs méritent néanmoins d’être relevés : la professionnalisation s’est renforcée, et la part de travail consacrée à la formation au sein des entreprises a augmenté par rapport à d’autres branches.
L’étude sur la situation du personnel qualifié 2024
Les deux associations nationales, Savoirsocial, organisation faîtière suisse pour la formation professionnelle du domaine social, et Sassa, la Conférence des hautes écoles spécialisées suisses de travail social, ont mandaté une étude à laquelle ont pris part près de 1’700 entreprises issues de huit champs d’activité dans toute la Suisse — des crèches aux EMS, en passant par les services sociaux — par le biais d’une enquête en ligne réalisée au début de l’été 2024. Les résultats issus de ce questionnaire ont été complétés par des entretiens menés avec des groupes de discussion et des données provenant de statistiques publiques. Cette vaste enquête a permis d’obtenir une vue différenciée de la situation du personnel qualifié par champs d’activité et par région. Les conclusions établies à l’échelle de l’ensemble de la Suisse seront par ailleurs complétées dans les semaines à venir avec les résultats spécifiques de six cantons.
Une présentation en ligne gratuite des principaux résultats (traduction simultanée en allemand et en français) se déroulera le 25 février 2025, 15h30 à 16h30 (lien de participation, pas d'inscription nécessaire)
La proportion de jeunes collaboratrices et collaborateurs se révèle exceptionnellement élevée. Elles et ils changent aussi souvent d’employeur·se. Pratiquement un poste sur cinq a dû être repourvu pour l’année de référence 2023, ce qui se traduit par un taux de fluctuation supérieur aux 16% de la moyenne nationale, toutes branches confondues. La plupart des départs sont des démissions d’employé·es, en raison d’une charge de travail trop importante, des conditions de travail ou de prétentions salariales. Près d’un tiers des personnes qui démissionnent ne changent pas uniquement d’entreprise, mais également de profession. Si 90% des postes vacants ont pu être repourvus, seuls 60% d’entre eux l’ont été dans les délais et avec les qualifications souhaitées. Ce taux de rotation élevé a un impact important sur le recrutement.
« Ces résultats sont un coup de semonce pour la branche », affirme Mariette Zurbriggen, présidente de Savoirsocial. « Nous allons à présent analyser en détail les conclusions de l’étude et élaborer des mesures et des revendications concrètes. Nous avons la conviction que nous trouverons de bonnes solutions à la situation actuelle du personnel qualifié. L’inaction n’est pas une option ».
La situation devrait encore s’aggraver
Les employeur·ses ont également été interrogé·es sur leur perception de l’évolution à venir. Leurs réponses ne laissent guère de place au doute : le recrutement va encore se compliquer et la situation s’exacerber, selon toute vraisemblance. Comme le souligne Agnès Fritze, présidente de la Sassa : « Cette étude montre quels sont les principaux défis. Il faut désormais que l’ensemble des acteurs passent à l’action dans leurs domaines de compétence respectifs pour que nous puissions ensemble améliorer la situation. »
(Source : communiqué de presse)
Voir le rapport complet, un résumé et des infographies
-
Livre
Un livre fraîchement paru soutient le processus de collecte d’informations et de souvenirs au sujet sur des seniors souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles de la mémoire. Un outil utile.
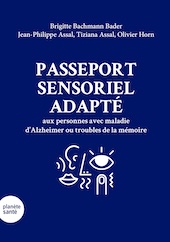 Lorsqu’un enfant vient au monde, il existe un vaste choix de livres de naissance. Au fur et à mesure de sa croissance, les parents y notent des anecdotes, y collent des photos, y inscrivent la taille, le poids, les souvenirs de vacances, entre autres.
Lorsqu’un enfant vient au monde, il existe un vaste choix de livres de naissance. Au fur et à mesure de sa croissance, les parents y notent des anecdotes, y collent des photos, y inscrivent la taille, le poids, les souvenirs de vacances, entre autres.Si un tel outil existe pour répertorier l’enfance de sa progéniture, il est bien moins répandu pour les personnes âgées vivant en institution. Cette lacune est désormais comblée grâce au « Passeport sensoriel adapté aux personnes avec maladie d’Alzheimer ou troubles de la mémoire. »
Le but de ce livret, édité par Planète santé, est de permettre à celles et ceux dont la mémoire vacille de mieux se faire connaître du personnel soignant et de toutes les personnes qu’elles côtoient au sein de l’institution. « Dans l’accompagnement d’une personne présentant tout ou partie de ces changements de comportement, il est nécessaire d’utiliser un guide opératoire et un canevas structuré de questions afin d’explorer et de raviver les émotions et les souvenirs liés aux cinq sens », décrivent les quatre autrices et auteurs dans le résumé de leur ouvrage.
« Aider à préserver l’humanité du résident et sa dignité d’avant la maladie », ou encore « proposer (…) des activités qui lui procuraient confort et plaisirs avant l’apparition de ses troubles de la mémoire » sont les buts affirmés de cet outil, comme l’indique l’introduction.
Le passeport est découpé en cinq sections, une pour chaque sens. Des questions sont alors posées afin d’encourager la personne à parler de ses goûts artistiques, culinaires, sportifs, animaliers, entre autres. Les réponses sont consignées dans ce document et aident les encadrant·es à mieux cibler les activités susceptibles de procurer du plaisir à la personne concernée, et de maintenir ainsi ses compétences le plus longtemps possible.
(Yseult Théraulaz)
Brigitte Bachmann Bader et al., «Passeport sensoriel adapté», Ed. Planète Santé, 2025, 48 pages
-
L’épilepsie devient de plus en plus une maladie du troisième âge, mais encore faut-il qu’elle soit correctement diagnostiquée. Un nouveau dépliant d’information se penche sur le sujet.
 Les personnes âgées développent fréquemment une épilepsie, ce qui en fait un enjeu pour elles et pour leurs proches. Désormais, plus de la moitié des épilepsies apparaissent chez les seniors.
Les personnes âgées développent fréquemment une épilepsie, ce qui en fait un enjeu pour elles et pour leurs proches. Désormais, plus de la moitié des épilepsies apparaissent chez les seniors.Les vertiges, les trous de mémoire, la confusion et les chutes font partie des symptômes et les crises ne s’accompagnent pas toujours de convulsions. La maladie est donc souvent ignorée ou confondue avec d’autres troubles. Cependant, une fois correctement diagnostiquée, l’épilepsie se soigne généralement bien chez les seniors. Le plus grand défi réside dans le fait que les médicaments doivent être bien tolérés, alors qu’ils interagissent souvent avec d’autres principes actifs.
Le nouveau dépliant d’information de la Ligue contre l’épilepsie présente les causes et les symptômes de la maladie chez les seniors et informe sur les traitements appropriés.
(Source : communiqué de presse)
Disponible en PDF sur cette page en français, allemand et italien, ou par envoi postal.
-
Dans un contexte d’allongement de quinze ans de l’espérance de vie en quelques décennies, trois ouvrages inaugurent une collection sur l’habitat intergénérationnel. Ils s’appuient sur l’expérience de l’ADRET, à Lancy.
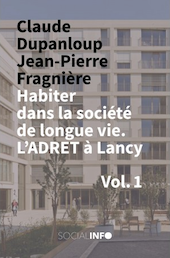 L’initiative émane de la Fondation communale pour le logement des personnes âgées (FCLPA), en partenariat avec l’Association Longue Vie et les Éditions Socialinfo. La collection « Habiter dans la société de longue vie » explore les nouvelles modalités d’habitat : logements intergénérationnels ouverts aux personnes dès « l’âge AVS » et aux étudiant·e·s, structures évolutives selon l’état de santé des locataires, cadres de vie accueillants et accessibles.
L’initiative émane de la Fondation communale pour le logement des personnes âgées (FCLPA), en partenariat avec l’Association Longue Vie et les Éditions Socialinfo. La collection « Habiter dans la société de longue vie » explore les nouvelles modalités d’habitat : logements intergénérationnels ouverts aux personnes dès « l’âge AVS » et aux étudiant·e·s, structures évolutives selon l’état de santé des locataires, cadres de vie accueillants et accessibles.Les trois premiers volumes présentent les idées fondatrices du projet ADRET, proposent une immersion dans ce quartier et livrent le témoignage d’une résidente sur l’art de la solidarité entre générations. La parution d’un quatrième volume est annoncée courant 2025.
- Dupanloup, C., & Fragnière, J.-P. (2024). Habiter dans la société de longue vie. L’ADRET à Lancy. Lausanne : Socialinfo, 140 p.
- Bonnevie, L., & Bernardinelli, Y. (2024). Au cœur de l’ADRET. Lausanne : Socialinfo, 132 p.
- Pillay, S. (2024). Au cœur de la vie. Lausanne : Socialinfo, 140 p.
(Source : communiqué de presse)
-
Outil de visualisation
L’outil informatique de l’Université de Neuchâtel qui permet de visualiser les demandeur·ses d’asile inclut désormais les données sur la protection temporaire et propose une base factuelle pour discuter de l’accueil en Europe.
 Etienne Piguet / © UnineImaginé en 2014 et développé progressivement dans le cadre du pôle de recherche national « nccr - on the move »[1], l’outil Fair Share est aujourd’hui pleinement fonctionnel. Son amélioration récente intègre les données des personnes bénéficiant d’un statut de protection temporaire, une évolution particulièrement pertinente dans le contexte de l’accueil des réfugié·es ukrainien·nes.
Etienne Piguet / © UnineImaginé en 2014 et développé progressivement dans le cadre du pôle de recherche national « nccr - on the move »[1], l’outil Fair Share est aujourd’hui pleinement fonctionnel. Son amélioration récente intègre les données des personnes bénéficiant d’un statut de protection temporaire, une évolution particulièrement pertinente dans le contexte de l’accueil des réfugié·es ukrainien·nes.L’outil permet de visualiser si un pays accueille plus ou moins de personnes demandeuses d’asile qu’il ne le « devrait », selon différents critères objectifs et combinables : taille du pays, richesse, taux de chômage ou PIB. Sans décider de ce qui est « juste », il fournit des données factuelles pour permettre une discussion et une négociation éclairées. « Fair Share permet de mener un débat dépassionné », estime Etienne Piguet, professeur de géographie des mobilités à l’UniNE et chef de projet de ce pôle national de recherche, pour les phases I et II.
Cette base de discussion arrive à point nommé : en août 2024, le Conseil fédéral a décidé d’associer la Suisse au nouveau Pacte européen sur l’asile (consultation ouverte jusqu’au 14 novembre 2024). Ce pacte vise à rendre le système de migration et d’asile plus efficace, plus résistant aux crises et plus solidaire. En tant qu’associée à Schengen/Dublin, la Suisse participera à cette réforme qui pourrait inclure une meilleure répartition des responsabilités d’accueil.
Actuellement dans sa troisième phase (2022-2026), le « nccr – on the move » est le pôle de recherche national consacré aux études sur la migration et la mobilité, dont l’objectif est de mieux comprendre les phénomènes liés à l’interaction entre ces deux domaines. Géré par l’Université de Neuchâtel, il réunit onze projets de recherche dans huit universités suisses, relevant des sciences sociales, de l’économie et du droit, pour mieux comprendre l’interaction entre migration et mobilité en Suisse et au-delà.
L’outil de visualisation Fair Share fait partie d’un ensemble plus large d’indicateurs sur la migration et la mobilité, disponibles sur le site du nccr — on the move
(Source : communiqué de presse)
Voir le tableau Fair Share
Voir la page des indicateurs développés par le nccr
[1] National Center of Competence in Research – The Migration-Mobility Nexus
-
Du roller derby au football féminin au Sénégal, les contributions publiées dans l’avant-dernier numéro de «Nouvelles Questions Féministes» analysent comment le sport peut devenir un espace d’émancipation et de lutte féministe.
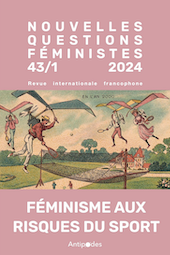 Le sport, malgré son éthique proclamée d’égalité et de fair-play, reste un domaine où la reproduction des inégalités de genre persiste. C’est ce paradoxe qu’examine le dernier numéro de « Nouvelles Questions Féministes » à travers cinq articles dédiés aux pratiques sportives. « Dans les mondes du sport, le genre continue de produire et de valoriser la différence et la hiérarchie sexuées (...) Dans ce contexte, les « autres », les personnes en situation de handicap ou définies comme telles, les femmes, les personnes racisées ou minorisées, n’ont le droit de concourir que sous conditions. Et lorsqu’elles concourent, leurs performances sont minimisées ou au contraire survalorisées, réduisant les personnes à leurs exploits physiques », affirment Sigolène Couchot-Schiex, Eva Nada, Clothilde Palazzo-Crettol et Béatrice Bertho dans leur édito.
Le sport, malgré son éthique proclamée d’égalité et de fair-play, reste un domaine où la reproduction des inégalités de genre persiste. C’est ce paradoxe qu’examine le dernier numéro de « Nouvelles Questions Féministes » à travers cinq articles dédiés aux pratiques sportives. « Dans les mondes du sport, le genre continue de produire et de valoriser la différence et la hiérarchie sexuées (...) Dans ce contexte, les « autres », les personnes en situation de handicap ou définies comme telles, les femmes, les personnes racisées ou minorisées, n’ont le droit de concourir que sous conditions. Et lorsqu’elles concourent, leurs performances sont minimisées ou au contraire survalorisées, réduisant les personnes à leurs exploits physiques », affirment Sigolène Couchot-Schiex, Eva Nada, Clothilde Palazzo-Crettol et Béatrice Bertho dans leur édito.Ainsi, Solène Froidevaux et Claire Nicolas ouvrent la réflexion en démontrant que le sport constitue un espace essentiel de revendication pour la pensée et l’activisme féministes. Leur analyse met en lumière l’importance d’une meilleure prise en compte de la diversité des corps sportifs, notamment grâce aux apports interdisciplinaires.
L’étude d’Aurélie Aromatario sur le roller derby illustre comment ce sport de contact devient un outil féministe de modification des rapports de genre. Cette pratique, résolument inclusive, permet une transformation des corps et des identités qui bouleverse les normes établies.
Dans une perspective internationale, Marame Cissé analyse la situation du football féminin au Sénégal, où les jeunes footballeuses doivent négocier entre leurs aspirations sportives et les résistances sociales. Pendant ce temps, en France, Alison Hernandez-Joset, Virginie Nicaise et Natacha Chetcuti-Osorovitz étudient l’émergence d’équipes de football féministes et queers qui remettent en question les normes institutionnelles du sport.
La question des transidentités dans le sport est abordée par Bastien Pouy-Bidard à travers l’expérience d’une élève trans en éducation physique et sportive, ouvrant ainsi la réflexion sur un possible horizon transféministe dans cette discipline.
Les questionnements soulevés dans ce dossier intitulé « Féminisme aux risques du sport » se révèlent essentiels à une évolution en faveur de davantage d'équité et d'inclusivité dans le sport. Car comme le concluent les coordinatrices de ce numéro : « À l’heure des nouveaux défis concernant les définitions catégorielles des sports, du genre et d’autres rapports sociaux, soumettre le sport à l’analyse féministe est à l’évidence une urgence sociétale, afin de réduire les discriminations qui y ont cours et d’affaiblir les injustices faites aux corps et aux personnes minorisées. »
(CROC, avec résumés)
Lire également :
Aurélie Hofer et Nadia Bonjour, «Les femmes, des athlètes sous-visibilisées», REISO, Revue d'information sociale, publié le 19 décembre 2024
-
L'État de Neuchâtel publie son rapport bisannuel sur les prestations sociales. Si l'aide sociale diminue depuis 2017, les demandes de subsides pour l'assurance-maladie augmentent et 14.9% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
 © République et Canton de NeuchâtelCe rapport biennal, réalisé par le service de l'action sociale en collaboration avec le service cantonal de statistique, offre une vue d'ensemble chiffrée de l'évolution de la situation sociale dans le canton sur la période 2019-2023. Si le revenu disponible équivalent ne cesse d'augmenter depuis 2010, atteignant 43'761 francs en 2021, l'amélioration de la situation socio-économique profite surtout aux personnes ayant un revenu annuel supérieur à 30'000 francs. La population disposant d'un revenu inférieur voit sa situation rester relativement stable.
© République et Canton de NeuchâtelCe rapport biennal, réalisé par le service de l'action sociale en collaboration avec le service cantonal de statistique, offre une vue d'ensemble chiffrée de l'évolution de la situation sociale dans le canton sur la période 2019-2023. Si le revenu disponible équivalent ne cesse d'augmenter depuis 2010, atteignant 43'761 francs en 2021, l'amélioration de la situation socio-économique profite surtout aux personnes ayant un revenu annuel supérieur à 30'000 francs. La population disposant d'un revenu inférieur voit sa situation rester relativement stable.Le taux de pauvreté cantonal atteint 14.9% en 2021 (contre 14.2% en 2017), restant légèrement inférieur à la moyenne nationale de 15.6% en 2022. La baisse du taux de chômage depuis 2018 s'accompagne d'une diminution continue du recours à l'aide sociale.
En revanche, les demandes de subsides pour l'assurance-maladie déposées par les personnes qui ne sont pas bénéficiaires de l’AVS, de l’AI ou de l’aide sociale sont en hausse en 2022 et 2023, à la suite des mesures prises par le Conseil d'État face à l'augmentation des primes. Les partenaires privés comme Caritas ou le Centre social protestant constatent également une forte croissance des demandes d'aide de la population la plus fragilisée.
Ces constats soulignent la nécessité de veiller à l'efficacité des prestations sociales à l'égard des personnes en situation précaire, en particulier en cas de péjoration de la dynamique économique.
(Source : communiqué de presse)
Consulter le Rapport social cantonal 2023
Les annonces du réseau
L'affiche de la semaine

Journée de Bienne 2026 : jeunes adultes en situation de précarité au cœur des échanges le 26 mars. Questionner les pratiques, croiser les regards et dégager des pistes d’action concrètes.