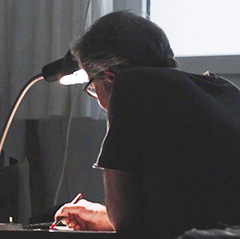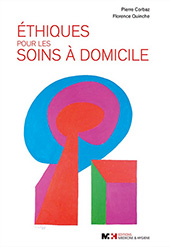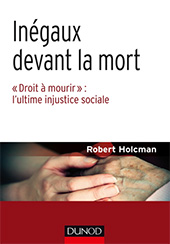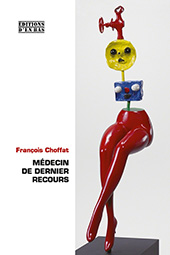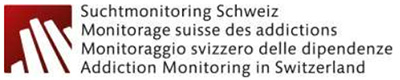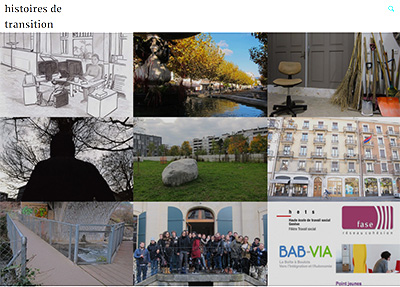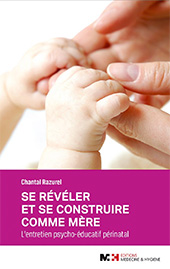Pour réunir les savoirs
et les expériences en Suisse romande
S'abonner à REISO
La liste des parutions
-
En quelques décennies, l’approche par compétences a bouleversé l’éducation et la formation professionnelle. Ébranlant une régulation fondée sur les qualifications, elle dessine un sujet contraint à agir en situation, appelé à se questionner sur l’adéquation de ses actions à la réalité économique.
Si l’approche par compétences apparaît comme le vecteur du déploiement d’une rationalité instrumentale, elle doit particulièrement être questionnée dans le domaine des métiers de la relation humaine.
Quelle place peut-on accorder à la relation à l’autre et à l’intersubjectivité dans une approche par compétences essentiellement opératoire et technique ? Quelles en sont les limites et les implications ? C’est dans une perspective critique, interrogeant les fondements de l’approche par compétences et faisant le lien avec la pratique professionnelle, que cet ouvrage collectif se propose d’apporter des éléments de réponse à ces questions.
Réunissant des contributions de chercheurs, enseignants et formateurs de Belgique, du Canada, de France et de Suisse, il éclaire tour à tour le cadre institutionnel sous-tendant l’approche par compétences, l’acteur supposé agir de manière compétente, la compétence régissant le rapport interpersonnel et, enfin, le professionnalisme face à la compétence.
Editions L’Harmattan
-
Cette étude a eu pour but de :
- Décrire la population des hommes victimes, recueillir des données sur les auteur-e-s, sur la relation de couple et sur l’implication d’enfants mineurs.
- Caractériser la violence, ses contextes et ses conséquences.
- Evaluer les besoins et les ressources en matière de prise en charge des hommes signalant de la violence de couple.
Les principales questions de recherche ont été de nature exploratoire :
- Dans quels contextes personnels, familiaux, communautaires et sociétaux se manifeste la violence physique envers les hommes dans le couple ?
- La violence physique s’accompagne-t-elle d’autres formes de violence ?
- Quelles en sont les conséquences pour les victimes, les auteur-e-s et les enfants mineurs ?
Auteures :
Dr Nathalie Romain-Glassey et Jacqueline De Puy, PhD
Unité de médecine des violences, Centre universitaire romand de médecine légale, Département universitaire de médecine et santé communautairesMaryline Abt, PhDc
Institut universitaire de formation et de recherche en soins, Département universitaire de médecine et santé communautairesRésumé de l’étude en format pdf
-
À l’occasion de la journée internationale des femmes, l’Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers (ODAE romand) publie ce nouveau rapport en collaboration avec le groupe de travail « Femmes migrantes et violences conjugales ».
Malgré l’importante avancée que constitue la modification de la Loi fédérale sur les étrangers, les femmes concernées ne sont toujours pas certaines d’obtenir le renouvellement de leur permis de séjour si elles quittent leur mari violent. Effrayées par la perspective du renvoi, certaines femmes restent auprès de leur mari et endurent en silence des violences qui ne feront souvent que s’aggraver, parfois au péril de leur vie. Les situations individuelles sur lesquelles se fonde le rapport illustrent les conséquences de ces pratiques sur la vie des femmes concernées et de leurs enfants.
Les autorités tant administratives que judiciaires font parfois preuve d’une grande méconnaissance des réalités et de la complexité du phénomène des violences conjugales. Dans un arrêt daté du 29 juin 2015 par exemple, le Tribunal administratif fédéral a nié l’existence de violences conjugales, estimant que l’intéressée ne présentait pas « un profil laissant penser qu’elle ne réagirait pas face à une relation insatisfaisante » puisqu’elle « pouvait se prévaloir d’une certaine maturité ainsi que d’une certaine expérience de la vie ». Les spécialistes s’accordent pourtant à dire qu’il n’y a pas un profil de femme plus susceptible de subir des violences ou plus susceptible d’avoir le courage de s’extraire de cette situation.
Rapport ODAE en format pdf
-
Six personnalités ont été suivies pendant une journée par le cinéaste et régisseur Hans Kaufmann :
- Blerim Ameti, joueur de futsal
- Corinne Parrat, webdesigner-actrice
- Michèle Berger, interprète en langue des signes
- Peter Hemmi, artiste
- Stephan Willi, skateur
- Isabelle Cicala, enseignanteEn Suisse, 500’000 personnes souffrent d’un trouble de l’audition, et parmi elles 10’000 sont complètement sourdes. La plupart des sourds, toutefois, ne se considèrent pas comme des handicapés car ils peuvent tout faire – sauf entendre. Le matin, ils sont tirés du sommeil par leur réveil qui vibre ou flashe, la sonnette de la porte est reliée à un système lumineux, la mère appelle ses enfants par Facetime et communique avec eux en langue des signes. Les sourds perpétuent leur culture, ont leur propre langue, et participent pleinement à la vie sociale en Suisse. Ce n’est que lorsqu’ils côtoient le monde des entendants que leur surdité devient un handicap.
Par le biais de cette campagne, la Fédération suisse des sourds (SGB-FSS) cherche à faciliter l’accès à la langue des signes et à la culture des sourds. Etre à l’écoute des sourds, c’est comprendre qu’ils vivent exactement comme les autres – simplement, sans le son.
-
Réalisé à l’occasion d’Out of the Box – Biennale des Arts inclusifs, ce catalogue prolonge au-delà de sa durée l’exposition Dix sur Dix, basée sur la rencontre entre dix professionnels du monde de l’art et dix artistes suisses en situation de handicap.
L’exposition a eu lieu en juin 2015 dans le Bâtiment d’art contemporain de Genève, organisée par Teresa Maranzano, curatrice, chargée du projet mir’arts, programme d’activités de l’association ASA-Handicap mental. Le catalogue publie des oeuvres des dix artistes et les textes des professionnels qui les ont rencontrés.
- ALEXANDRE BAUMGARTNER
- ISABELLE GAY
- BERNARD GRANDGIRARD
- DAVID JACOT
- HEINZ LAUENER
- HERVÉ PERREIRA
- SABRINA RENLUND
- STÉPHANE REPOND
- DRAGAN STANIC
- PASCAL VONLANTHEN
Ces artistes n’ont pas suivi un parcours conventionnel, mais travaillent de manière assidue dans des ateliers à Genève, Berne, Fribourg, Vevey et Etoy, dans le canton de Vaud.
Grâce à un environnement propice à la création, ils réalisent depuis plusieurs années des œuvres hautement poétiques et inventives.
Catalogue Dix sur Dix en format pdf
-
Recension par Jean Martin
Médecin généraliste à Lausanne, Pierre Corbaz a présidé la Fondation lausannoise des soins à domicile ainsi que sa commission d’éthique, dont l’ouvrage discuté ici donne un reflet des travaux. Il s’est aussi acquis un doctorat en philosophie et a écrit plusieurs livres traitant d’éthique médicale, notamment en fin de vie. Florence Quiche est philosophe et enseigne à la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne ; elle a été membre de plusieurs commissions d’éthique. Ces deux auteurs collaborent de longue date et apportent aujourd’hui une somme substantielle présentant leur expérience, avec d’autres, dans le conseil éthique au sein de structures de soins à domicile (bien développées, depuis plusieurs décennies, dans le canton de Vaud).
Les thèmes abordés ont été choisis parce qu’ils ont occupé la commission d’éthique par leur fréquence, leur acuité, leur originalité ou leur caractère exemplaire. Parmi eux : justice et soins à domicile, soins et vie privée, secret professionnel, autonomie, discernement et curatelle, l’éthique du « care » et de la sollicitude, maltraitance (des patients, mais aussi parfois des soignants), soins palliatifs à domicile, les problématiques du suicide assisté et de l’assistance sexuelle – sur lesquelles les auteurs ne cachent pas leur perplexité. Chacun des 12 chapitres du livre commence par une ou plusieurs vignettes cliniques, discutées ensuite dans leurs divers aspects. Quand le sujet s’y prête, sont incluses les dispositions légales pertinentes, vaudoises et fédérales.
Il importe de noter que, dans le titre, « éthiques » est au pluriel. Les auteurs à ce propos : « Nous sommes tentés d’être en quête de recettes. C’est un leurre parce que l’éthique qui nous intéresse entre en action lorsque justement les recettes s’épuisent. » On peut saluer cette position, rappelant celle de l’universitaire genevois Eric Fuchs pour qui l’éthique, c’est répondre à la question Comment faire pour bien faire. « La pratique basée sur les preuves, ça marche jusqu’au jour où ça ne marche plus, où il n’y pas de bonne solution, où le soignant est mal à l’aise quoi qu’il fasse. La question posée, de plus, ne peut être supprimée, il n’est pas question de s’en débarrasser. »
Il serait faux de croire que les auteurs sont désabusés. Au contraire : c’est là que sont les défis, auxquels il est d’abord nécessaire mais aussi stimulant de devoir répondre, dans un certain malaise, voire une souffrance face aux doubles contraintes et autres dilemmes. « Ethiques pour les soins à domicile » n’est pas le livre que vous lirez une fois, d’un bout à l’autre. C’est plutôt un manuel, une somme de référence à laquelle s’adresser (se raccrocher ?) quand les situations rencontrées n’admettent pas d’issue aisée, interpellent par leur complexité.
Dans leur conclusion, les auteurs soulignent que « soutenir les soignants à domicile n’est pas seulement une question de déontologie ou d’éthique médicale, mais une question sociétale qui nous concerne tous ». Au moment où le « tsunami gris » est devenu, dans nos pays, l’enjeu majeur de santé publique pour les décennies à venir et où la prise en charge à domicile est une partie importante des stratégies à mettre en œuvre, on ne saurait mieux dire.
Jean Martin, médecin de santé publique
-
Les bonnes pratiques alimentaires chez la personne âgée
Le point sur les pratiques actuelles dans les EMS, sur ce qu’est la malnutrition, sur l’évaluation des risques et sur ce que présente la littérature spécialisée.
Synthèse de la conférence par Camille-Angelo Aglione.
Résumé en format word
-
Statistiques
64 milliards de francs de prestations sociales pour le domaine de la vieillesse
D’après les Comptes globaux de la protection sociale, 64 milliards de francs ont été octroyés sous forme de prestations sociales pour couvrir les risques et les besoins liés à la vieillesse en 2012. Ce domaine de la protection sociale comprend notamment les rentes de vieillesse de l’AVS et de la prévoyance professionnelle (LPP). Le domaine vieillesse a absorbé 43,2% de l’ensemble des dépenses pour les prestations sociales (148,1 milliards de francs).
- Exprimées par habitant et en Standard de pouvoir d’achat (SPA), ces dépenses sont 37% plus élevées en Suisse que dans l’Union européenne. Le niveau des dépenses par habitant en Suisse atteint 4020 SPA contre 2940 SPA en moyennes pour l’UE-28.
- En pourcentage du PIB, les dépenses sociales pour la vieillesse en Suisse se situent à 10.3%, un peu en dessous des 11% qu’elles représentent dans l’UE.
La synthèse en format pdf
-
Ce document résume les conférences et les interventions de :
- Chris Philipson, Professeur de sociologie et de gérontologie sociale à l’Université de Manchester et Directeur exécutif du Manchester Institute for Collaborative Research on Ageing (MICRA), Royaume-Uni : « Active » or « Precarious » Ageing ? New approaches to understanding agency and empowerment in later life
- Daniela Jopp, Professeure associée, Institut de psychologie de la Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne, Suisse : Successful aging at age 100 : Myth or reality ?
- Françoise Le Borgne-Uguen, Professeure de sociologie à l’Université de Bretagne Occidentale à Brest, France et professeure associée à l’Université de Sherbrooke, Canada : La protection des vieilles personnes : un contexte de négociations « sous contraintes » pour/avec elles.
Habitats et espaces de vie
- Antonia Jahn, Fondation Age : Le programme Socius par la Fondation Age (Age Stiftung)
- Kaj Jahn, LaSUR, EPFL, Suisse : Habiter avec son âge
- Sabrina Gitto, MA HES-SO en Travail social : Des logements à l’épreuve du temps
- Dominique von der Mühl, EPFL-ENAC-Chôras, Suisse : Effet de l’environnement construit sur la qualité de vie
Regards croisés sur l’innovation en matière d’habitat pour personnes âgées : vers de nouveaux modèles
- Fabrice Ghelfi, Chef du Service des assurances sociales et de l’hébergement, Etat de Vaud : Politique d’accompagnement et mobilisation des acteurs : le rôle et les effets d’une politique publique
- Pierre-Henri Daure, Directeur des établissements FEDOSAC, REIACTIS France : Retour sur 30 ans d’expérience sur les petites unités de vie en France
- Gail Kohn, Age Friendly DC Coordinator, Former Director of Capitol Hill Village, Washington DC : Alternative and innovative housing for older people : insights from the United State
Seniors et technologies – A l’initiative de Pro Senectute Suisse et de l’AVASAD
- Alain Huber, Secrétaire romand Pro Senectute, Suisse : Digital Senior
- Henk Verloo, Infirmier, professeur HES-SO La Source : La technologie au service du maintien à domicile des personnes âgées
- Francesco Carrino & Leonardo Angelini, HumanTech : Nouvelles technologies pour la personne âgée
La fabrique des représentations sociales de la vieillesse
- Rachel Zacklade, Doctorante au Conservatoire national des Arts et métiers, France : L’implication d’un modèle culturel dans la constitution des politiques publiques
- Mario Paris, Doctorant à l’Université de Sherbrooke, Canada : La reconnaissance sociale de la vieillesse : Étude de cas de quatre Villes-amies des aînés au Québec (VADA-QC)
- Ricardo Iacub, Université de Buenos Aires, Argentine : The media as a space for ageing empowerment
Lutte contre la maltraitance et pouvoir d’agir des aînés
- Dominique Langhendries, Directeur de l’agence Respect Seniors : L’accompagnement de situations de maltraitance envers les aînés en Wallonie (Belgique) au regard de l’outil EN-MAIS-Respect Seniors, outils de réflexion basé sur un guide de pratique développé au Québec
- Marie-Ève Bédard, Candidate au doctorat en gérontologie à l’Université de Sherbrooke : Prévenir la maltraitance envers les aînés grâce aux comités des usagers du système sociosanitaire québécois
Notes du colloque REIACTIS en format word
-
Depuis cinq ans, 33 équipes ont étudié la prise en charge des personnes âgées dépendantes et le quotidien des proches aidant·e·s. Les résultats de ces recherches montrent la complexité des interventions et l’urgence d’une meilleure articulation.
Premiers points forts présentés par Jean Martin
Le Programme national de recherche « Fin de vie » (PNR 67) a été lancé en 2011 avec un financement de 15 millions de francs pour cinq ans. Ont été sélectionnés les projets de 33 équipes. En 2016, ses responsables organisent cinq Dialogues pour discuter les résultats obtenus.
Jusqu’à 32 intervenants au chevet du patient
Le premier Dialogue, « Mourir à la maison ou dans un EMS », a eu lieu à Berne le 19 février 2016. On y a beaucoup parlé des proches aidants, de plus en plus sollicités pour prendre soin de leurs parents très âgés. Un travail sous la direction de Beat Sottas, réalisé à Fribourg et en Valais, a étudié les situations critiques à cet égard. Ainsi, la durée des aides extérieures, professionnelles et autres, est d’un peu plus d’une heure par jour, alors que les proches aidants doivent être disponibles en permanence. Ces derniers ont de la peine à y voir clair : pour un patient, on a pu compter jusqu’à 32 intervenants, chacun pour une prestation particulière. D’où un très grand besoin de coordination. Parmi les conclusions de l’étude : les aidants sont souvent épuisés, sur le plan physique et psychique ; ils (mais les aidants sont très majoritairement des femmes) ont le sentiment d’être abandonnés, ils peinent à se préparer au décès prévisible du patient, ont peur de ne pas faire juste ni assez et de ne plus avoir le contrôle, ni de la situation ni de leur propre vie.
Conciliation avec la vie professionnelle
Une étude lausannoise, sous la direction de Marc-André Berthod, s’est intéressée à la manière dont les aidants parviennent - ou non - à concilier vie professionnelle et exigences du soutien à leur proche âgé. Les histoires recueillies éclairent les façons dont les gens s’adaptent. Pas surprenant d’observer que des aménagements sont rendus plus ou moins faciles ou difficiles selon la culture d’entreprise et la bonne volonté des supérieurs. Les auteurs de l’étude soulignent les besoins d’instauration de possibilités mieux structurées, si possible à large échelle, pour faciliter la disponibilité des proches aidants, y compris par une protection de l’emploi pour ceux qui diminuent leur temps de travail, ainsi que des soutiens organisationnels et matériels. Une plateforme nationale « Work and Care » sera lancée à ce propos en automne 2016. Là comme ailleurs, il y a une place pour des bénévoles, tout en sachant que leur engagement doit être sérieux et adéquatement coordonné pour être utile.
A propos du désir de mourir
La recherche présentée par Anne-Véronique Dürst, Stéfanie Monod et coll. (Lausanne) a porté sur le désir de mourir dans des groupes de patients âgés : en service de réadaptation, 12.9% ont exprimé un tel désir ; en EMS, ils étaient 21%. A été évoquée la question du suicide assisté : les chiffres en Suisse montrent qu’il est plus fréquent chez les plus de 65 ans (et chez les plus de 75 ans, le nombre de suicides assistés est proche de celui des autres suicides). De manière intéressante, les auteurs estiment qu’il est possible d’évaluer adéquatement le désir de mourir chez des personnes avec un déficit cognitif modéré et même important. A noter que la même équipe a récemment publié un travail montrant qu’on peut différencier, par des instruments appropriés, ce qui est dépression et ce qui est détresse spirituelle. Cette distinction est importante puisque, à l’évidence, la prise en charge n’est pas la même dans les deux cas.
Privé-public, communes-cantons
La discussion sur les résultats présentés a montré combien les questions sont complexes. D’abord il y a celle de la multiplicité des intervenants, qu’il faut chercher à simplifier mais sans diminuer la qualité des prises en charge. Il est impératif de mieux reconnaître le rôle des proches aidants et de donner plus d’attention aux aides dont ils ont besoin : pour concilier leur engagement avec leur activité professionnelle, pour être parfois déchargés par d’autres, pour bénéficier d’informations et d’une certaine formation. En pratique, les responsabilités et tâches sont le fait de services privés ou publics. Dans le secteur public, la répartition des compétences diffère selon les cantons entre ce qui est du ressort des communes, voire des districts, et de l’Etat. On est habitué en Suisse à ces diversités, souvent solidement ancrées politiquement, mais il importe de faire en sorte que, partout et de manière équitable, nos concitoyens âgés et dépendants puissent bénéficier de prestations qualitativement et quantitativement adéquates. Clairement, les défis lancés par le « tsunami gris » du vieillissement sont de taille ; il est bon que le PNR 67 mette le doigt sur des domaines et articulations qui demandent à être considérés en urgence.
Jean Martin, médecin de santé publique
-
Livre
Le travail social est décrié de toutes parts. On l’accuse de soutenir des personnes qui ne le méritent pas ou de n’avoir guère de résultats tangibles à présenter. Une inconnue demeure : qu’est-ce que le travail social ?
Ce manuel a pour but de répondre à cette question. Écrit par Véréna Keller, spécialiste réputée, il présente l’organisation du travail social, ses destinataires, ses finalités et sa mise en œuvre. Il explique qui le réalise et débat de son caractère scientifique.
Résolument critique, il permet d’avoir une vue d’ensemble de ce qu’est le travail social – en Suisse en particulier – et des controverses qui le traversent au début du XXIe siècle.
Un ouvrage de référence non seulement pour les étudiant·e·s et professionnel·le·s en travail social, mais pour toutes les personnes intéressées par les questions sociales.
-
Recension par Jean Martin, médecin de santé publique
Economiste et gestionnaire français, ayant assumé des tâches dirigeantes en hôpital, enseignant, Robert Holcman publie un ouvrage dense sur l’éventail des facettes du thème « fin de vie et droit à mourir » qui fait beaucoup débat aujourd’hui. Ce livre sera une référence utile, une référence toutefois que salueront surtout ceux qui restent très réticents, voire fondamentalement opposés à la libre détermination des personnes dans ce domaine.
Une chose frappe dans le panorama brossé par l’auteur : on n’y trouve pas de récits cliniques, d’histoires de patients qui fassent toucher du doigt ce que vivent, en France aujourd’hui, les malades en fin de vie, leurs proches et les soignants. Bien sûr, il importe de rappeler ce que les sociologues, les philosophes ou des instances officielles ont dit sur ces sujets. Mais il faudrait faire la part de ce qui est options dogmatiques et ce qu’on sait pratiquement. En décembre 2012, le rapport de la Commission Sicard a été limpide dans sa conclusion : « En général, on meurt mal en France aujourd’hui et il est urgent d’améliorer la situation. » Pour cela, le développement des soins palliatifs est à l’évidence une avenue majeure mais ne saurait être l’entier de la solution.
L’auteur rappelle à juste titre les inégalités dans l’accès aux soins pour les groupes moins favorisés, leur plus grande morbidité et leur moindre espérance de vie. Il craint que, dans la foulée, les personnes précarisées soient poussées plus que d’autres à envisager de mettre fin à leurs jours - cas échéant en y étant incités par leurs proches pour des motifs matériels. Préoccupation tout à fait estimable. Toutefois, si ce souci se comprend bien dans un pays comme les Etats-Unis où l’accès aux soins reste fort inégalitaire, c’est moins le cas en France où un système de santé social et étoffé doit assurer à tous une prise en charge adéquate.
Clairement, la grande différence entre Holcman et d’autres (dont le rédacteur de cette recension) réside dans l’importance et le respect accordé à l’autonomie de la personne. Il y a dans le livre une réticence palpable à admettre que les patients ont le droit de décider de leur propre existence, y compris quant à l’option de lui mettre un terme quand elle est devenue trop lourde à porter. On peut, on doit bien sûr avoir le souci que ces décisions soient bien réfléchies mais cela ne saurait justifier le retour à une posture paternaliste, élitiste. Posture où ceux qui « sauraient mieux » contesteraient la compétence de la personne lambda et la légitimité de ce qu’elle décide. On ne peut accepter des raisonnements répétés tendant à disqualifier les patients qui ne pensent pas comme soi. Il y a là un anachronisme grave, ou de la cécité.
A propos du titre du livre : l’inégalité existe, mais elle est ailleurs. Un statut social plus élevé facilite l’accès aux moyens de terminer sa vie. Qu’il suffise de rappeler que Mme Jospin, mère d’un premier ministre, a pu bénéficier d’une aide au suicide – ce qui n’a guère suscité de réprobation sociétale. N’y a-t-il pas lieu, au pays des droits de l’homme, de s’émouvoir de tels écarts, au détriment de la libre détermination des moins influents ?
Holcman évoque également le fait indiscuté qu’il y a, en France et ailleurs, un nombre notable d’assistances au suicide et d’euthanasies qui ne disent pas leur nom. Il les regrette mais semble s’accommoder de cette clandestinité. A notre sens, le fait choquant que ces choses soient tolérées sous le manteau enlève beaucoup de poids aux argumentations dogmatiques refusant de considérer l’évolution sociétale. Sur ce point, des pays voisins de la France, vus généralement comme civilisés eux aussi, ont décidé de reconnaître l’autonomie des personnes - ce qui n’empêche pas bien sûr de le faire en mettant en place des garanties adéquates.
-
Le rapport montre que les objectifs du Masterplan sont en grande partie atteints.
- Le nombre de diplômes décernés en Suisse dans la formation professionnelle initiale ne cesse d’augmenter : depuis 2007, le nombre de diplômes délivrés chaque année dans la profession d’assistant en soins et santé communautaire CFC a plus que doublé et permet actuellement de couvrir plus de 84 % du besoin de relève estimé.
- L’évolution du nombre de diplômes est également positive au degré tertiaire. Les efforts visant à augmenter le nombre d’inscriptions aux filières d’études en soins infirmiers dans les écoles supérieures et les hautes écoles spécialisées sont poursuivis.
Les mesures prises dans le domaine de la formation déploient leurs effets à moyen terme et ne permettent pas à elles seules de lutter contre la pénurie de professionnels des soins. D’autres facteurs, comme les conditions d’engagement et de travail en vigueur dans la branche et dans les entreprises, exercent également une influence au niveau de la garantie et de la qualité des soins. Ils relèvent toutefois de la compétence des institutions de la santé. Ces questions et d’autres encore doivent rester à l’ordre du jour des autorités compétentes au-delà du terme du Masterplan « Formation aux professions des soins ». Le succès de la lutte contre la pénurie de professionnels des soins passe en effet par le maintien des places de formation et de stage et par la création de nouvelles places : des tâches qui doivent être conçues sur le long terme.
Le rapport en ligne
-
Recension par Jean Martin, médecin de santé publique
Le Docteur François Choffat (1941) est un médecin connu de Suisse romande. Lui et moi nous connaissons de longue date et partageons d’avoir tous deux travaillé en début de carrière dans des pays en développement. L’auteur s’est ensuite installé comme généraliste au bord du lac de Neuchâtel. Sa curiosité de paradigmes médicaux autres (y compris guérisseurs et autres « panseurs de secret » dans le Jura) et des expériences positives dans des situations où l’allopathie s’avérait décevante l’ont amené à s’attacher à l’homéopathie, devenue une partie majeure de sa pratique. Il s’est aussi beaucoup préoccupé d’alimentation, en étant notamment un disciple de Catherine Kousmine, et a fondé un Centre de santé holistique dont il raconte les péripéties parfois difficiles.
« Le chamanisme et la chirurgie sont les symboles de deux pratiques diamétralement opposées de l’art de guérir… Un pôle humaniste et un pôle mécaniste. Pour moi, ces deux pôles sont devenus indissociables, et complémentaires come le cerveau gauche et le cerveau droit (…) Dans ma propre pratique, il y a d’un côté l’héritage revendiqué de la médecine conventionnelle, de l’autre certaines médecines complémentaires. Cette synthèse a été le fruit d’une longue confrontation entre mes croyances initiales et les échecs que la réalité m’a infligés. (…)L’homéopathie m’a fait redécouvrir la réalité d’une certaine Energie vitale, qui échappe à la démarche scientifique et la complète. »
C’est toute une carrière, une trajectoire, que retrace Médecin de dernier recours. Un mot sur ce titre, lié au fait que, pas rarement, des patients se sont adressés à lui et à ses méthodes autres après avoir cherché du secours ailleurs, en particulier dans la médecine orthodoxe, sans qu’un remède soit trouvé. Il se dit aussi « médecin des causes perdues ».
L’ouvrage fourmille de vignettes cliniques illustrant le propos, avec des critiques marquées à l’endroit d’aspects commerciaux de la médecine et du carcan imposé par le paradigme biochimique. Il consacre un chapitre à ses réserves vis-à-vis des pratiques vaccinales qu’il juge trop systématiques (tout en ne les excluant pas) et influencées par l’industrie. Un autre est dédié à la sclérose en plaques, une des « causes perdues » pour lesquelles on faisait appel à lui.
Les attitudes ont passablement changé à l’endroit des méthodes qu’on ne souhaite plus appeler parallèles ou alternatives mais complémentaires - pour ne pas donner une impression d’inévitable confrontation. Aujourd’hui, il me paraît que beaucoup d’entre nous peuvent se dire d’accord avec F. Choffat quand il écrit : « Affirmer qu’il n’y a pas de salut en dehors de la médecine officielle relève de l’arrogance. »
Cela étant, on ne sera bien sûr pas toujours d’accord avec l’auteur dans ses affirmations. Mais on ne saurait nier son ouverture aux choses « autres », sa sincérité, et son engagement au service des patients. Ce livre est un exemple d’efforts tout à fait estimables, par des médecins au terme d’une carrière bien remplie, de rassembler vécu, expériences, leçons tirées, questionnements, sous une forme aisément accessible à d’autres. Le récit de vie du Dr Choffat, bien écrit, structuré en nombreuses sections faciles à consulter, est susceptible d’intéresser les professionnels de santé aussi bien qu’un large public.
Site internet Editions d’en bas
-
Ce document a été développé par Santé Sexuelle Suisse en collaboration avec l’ensemble des cantons latins qui souhaitaient disposer d’un cadre de référence et d’un canevas de réflexion communs pour faciliter la mise en place de plans ou de programmes cantonaux harmonisés en matière de santé sexuelle.
Cette thématique se profile comme un axe prioritaire en matière de prévention et de la promotion de la santé en Suisse latine pour les années à venir, aussi il est important de disposer d’un guide qui rassemble les différents éléments fondamentaux pour la mise en œuvre de politiques cohérentes et coordonnées dans ce domaine.
Basés sur les textes et accords internationaux et nationaux ainsi que sur les études les plus récentes en matière de santé sexuelle, ce document intègre aussi l’expérience des acteurs de terrain. Il comprend notamment la définition du concept de santé sexuelle, les principaux cadres de références théoriques nationaux et internationaux, un état des lieux du contexte helvétique et latin ainsi que les critères de qualité, des recommandations et des propositions à observer pour le développement et la mise en œuvre d’une stratégie globale de santé sexuelle.
Une partie du guide est rédigée sous forme de fiches thématiques et pratiques, mettant en évidence les champs d’action prioritaires de la santé sexuelle en Suisse, les ressources utiles à ces derniers ainsi que les acteurs œuvrant dans le domaine.
Barbara Berger, directrice de Santé Sexuelle Suisse, Dr Claude-François Robert, président de la Commission de prévention et de promotion de la santé de la CLASS
Le guide en version originale ou en version A4
-
Le rapport tire la conclusion qu’entre l’analyse de 2011 et 2015, il y a peu de changements en ce qui concerne la consommation problématique d’alcool en Suisse.
On estime à environ 250’000 le nombre de personnes alcoolodépendantes vivant en Suisse.
Quelques chiffres : 9.2% de la population suisse présentent une consommation problématique, 2.4% un trouble probablement lié à l’alcool, et 1.0% une dépendance probable à l’alcool. Dans l’ensemble, 12.6% de la population suisse présentent une consommation d’alcool pour le moins problématique.
Monitorage (en allemand avec résumé en français) en format pdf
-
Forte présence des établissements médico-sociaux (EMS) en Suisse orientale, prédominance des services d’aide et de soins à domicile (SASD) en Suisse romande : la prise en charge des personnes âgées varie selon les cantons.
La présente publication examine différents aspects de ces différences. Elle met tout d’abord en lumière les caractéristiques du recours aux EMS et aux SASD dans les cantons en 2013.
Elle examine ensuite l’existence éventuelle d’une convergence des pratiques durant la période 2006–2013.
Finalement, elle identifie des modèles-types de prise en charge en regroupant les cantons connaissant des pratiques similaires.
Ce rapport est le deuxième d’une série de trois rapports sur la prise en charge des personnes âgées en Suisse. Présentation du premier rapport sur REISO.
L’étude en format pdf
-
Le 2 février 2016, le Parlement fédéral commence l’étude du nouveau projet de loi sur les jeux d’argent. Trois spécialistes donnent leurs éclairages. Si la volonté d’ouverture et de modernisation du secteur est légitime, les organisations actives dans la protection des joueurs tirent la sonnette d’alarme : l’ouverture aux jeux online ne peut se faire sans mesures d’accompagnement suffisantes. Les organisations demandent donc au Parlement de rééquilibrer le projet. Elles regrettent que le Conseil fédéral place les intérêts fiscaux avant la protection des joueurs et de leur entourage.
Les pouvoirs publics face à l’addiction aux jeux d’argent
- Prof. Robert J. Williams, Faculté des sciences de la santé, Alberta Gaming Research Institute, Université de Lethbridge, Canada
- 0:00 - Quelles sont les populations sujettes aux jeux d’argent ?
- 1:28 - Comment prévenir le jeux excessif ?
- 5:03 - Le rôle des pouvoirs publics
- La vidéo
Le coût social du jeu excessif en Suisse
- Prof. Claude Jeanrenaud, Institut de Recherches Economiques de l’Université de Neuchâtel (IRENE)
- 0:00 - Le coût social des jeux, c’est quoi ?
- 0:40 - Montant du coût social
- 1:02 - Effets de la prévention sur le coût social
- La vidéo
La problématique des jeux d’argent chez les adolescents
- Dr Joan-Carles Suris, Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP), Groupe de recherche sur la santé des adolescents (GRSA), CHUV, Lausanne
- 0:00 - Etude sur les jeunes et les adolescents (étude sur 1’000 jeunes de 15 à 18 ans, Neuchâtel - 2011)
- 0:38 - Résultats de l’étude
- 1:49 - Recommandations
- La vidéo
-
Site internet
Cette boîte à outils est à la disposition des groupes de patients et des défenseurs des patients européens, ainsi que de toute personne souhaitant obtenir davantage d’informations sur le processus de recherche et de développement (R&D) des médicaments. Les utilisateurs peuvent acquérir les connaissances permettant d’apporter une contribution significative au développement des médicaments et au dialogue plus étendu concernant l’implication des patients. Cette ressource pédagogique en ligne permet aux utilisateurs de découvrir, d’adapter et de partager librement des documents.
C’est le résultat d’un effort concerté, à long terme, déployé par des experts, dont des patients, des chercheurs et des universitaires. Le projet est que des milliers de défenseurs des patients en Europe tireront profit de cette boîte à outils pour permettre un partenariat et une implication des patients plus significatifs au niveau de la R&D des médicaments.
La boîte à outils en ligne est disponible en sept langues (anglais, français, allemand, espagnol, italien, polonais et russe) et contient plus de 3000 documents spécialisés sur l’abc de la R&D des médicaments. Les utilisateurs ont accès à un grand nombre de fiches d’informations, de graphiques, de diaporamas, de vidéos, de webinaires enregistrés, de documents prêts à imprimer ainsi que d’un glossaire complet.
-
Les étudiant.es du module d’approfondissement romand OASIS intitulé « La citoyenneté agressée, la place des jeunes dans la ville » sont allés dans les structures genevoises de travail social actives auprès des jeunes en décrochage. Ce réseau est constitué du dispositif de travail social hors murs, de structures municipales d’insertion et de permanences d’accueil cantonales.
Crayons à dessin, appareils photo et enregistreurs en main, les futur.es travailleur.euses sociaux.ales sont allés à la rencontre des jeunes et des professionnel.les œuvrant dans ce réseau. Par le biais de l’observation directe, de l’observation participante et de l’entretien, les étudiant.es se sont efforcé.es de saisir en finesse le quotidien de ces espaces de travail social de proximité.
Plutôt que de restituer les fruits de leur enquête par le biais d’articles scientifiques ou professionnels, les étudiant.es se sont inspirés de la sociologie narrative, ou du roman social, et se sont fait auteur.es de récits singuliers. Des récits présentés sur ce site qui, résolument, mettent en avant l’expérience de la transition juvénile et la dimension sensible de « l’art de faire » du travail social de proximité.
Ce module a été mis sur pied en étroit partenariat avec la FASe (Transit Meyrin -Tshm Versoix-Tshm rive droite-Tshm Carouge), l’association BAB-VIA et la permanence du dispositif Point jeunes de l’Hospice Général. L’équipe du module : Monica Battaglini, Julie Peradotto, Alexandra Pittet, Laurent Wicht.
-
Pour la première fois en Suisse, l’étude RESPONS fournit des données représentatives de résidant-e-s à propos de la qualité de vie et la satisfaction dans les EMS des régions linguistiques alémanique et romande. Dans l’ensemble, les résidant-e-s estiment que la qualité dans les EMS des deux régions linguistiques est bonne.
1035 résidant-e-s de 51 EMS ont participé à l’étude ; 38 en Suisse allemande et 13 en Suisse romande. Trois quarts des résidant-e-s participants étaient des femmes (76 %). Les participants avaient en moyenne 86 ans et vivaient en EMS depuis environ 3,5 ans.
Ce sont principalement dans les domaines de la gestion de la douleur, la gestion du quotidien, l’autodétermination ainsi que dans des soins et un accompagnement centrés sur la personne qu’il y a un besoin d’agir.
Signalons en particulier un résultat de l’étude : lorsque la dépendance aux soins et les troubles cognitifs augmentent, tout comme avec un état de santé subjectif moins bon, l’évaluation de la qualité de vie et des soins est moins bonne. Cette tendance est visible dans plusieurs dimensions de la qualité de vie ainsi que dans la satisfaction. Ces relations, à prendre au sérieux, montrent que la qualité de vie et des soins se reflète dans la qualité des soins et de l’accompagnement des résidant-e-s les plus dépendants aux soins. Des analyses plus approfondies sont cependant nécessaires avant de pouvoir tirer des conclusions définitives.
Auteur·e·s : Kathrin Sommerhalder, Eliane Gugler, Antoinette Conca, Madeleine Bernet, Niklaus Bernet, Christine Serdaly, Sabine Hahn.
L’étude en format pdf
-
L’asile occupe actuellement une place importante dans le débat politique et les médias. Des termes comme NEM, permis F ou aide d’urgence font désormais partie du vocable couramment employé, sans toutefois que leur sens soit clair.
Le « Petit lexique de l’asile » fournit aux personnes concernées ou intéressées par les questions d’asile une définition précise de quelques notions clés.
Les définitions ont été élaborées par des juristes professionnels de l’EPER. Ce travail de clarification repose sur leur expérience quotidienne tout en rendant accessible à un public non-spécialistes des notions juridiques parfois complexes.
Le but premier visé par ce lexique est de réduire les imprécisions et malentendus découlant d’une simple méconnaissance de la terminologie de l’asile. L’EPER espère contribuer ainsi à une discussion mieux informée et partant, plus sereine.
Prix : 10.-
Petit lexique de l’asile en ligne
-
Revue spécialisée
La santé est essentielle tant pour l’individu que pour la société. Elle comporte de nombreuses dimensions, que l’on ne peut appréhender que grâce à des données statistiques fiables. Dans ce numéro, consulter notamment les articles consacrés à :
- Les principales causes de décès de ces dernières années en Suisse
- Les méthodes statistiques pour analyser la santé dans sa globalité
- Les interactions entre le travail et la santé
- Les comportements en matière de santé dans la population et les différences sociales
- L’environnement, son influence sur la santé
- Comment est établie la statistique de synthèse « Coût et financement du système de santé »
- Les buts de la Stratégie Santé2020 du Conseil fédéral
- Comment l’OBSAN aide la Confédération et les cantons à analyser les données sur la santé
Auteurs : Monika Diebold, Katharina Fehst, Sabina Helfer, Christoph Junker, Martine Kaeser, Ralph Krieger, Renaud Lieberherr, Michael Lindner, Jean-François Marquis, Caroline Schnellmann, Marco Storni, Georges-Simon Ulrich, Ulrich Wagner, Mirella Wepf et Laurent Zecha
ValeurS Santé en ligne
-
Les changements de vie liés à la naissance d’un premier enfant nécessitent des ajustements émotionnels, comportementaux et cognitifs de la part des mères.
Une difficulté de s’adapter aux nouvelles situations engendrées par la naissance de l’enfant peut occasionner un stress, à l’origine souvent d’une baisse du sentiment de compétence et d’une détérioration de la santé psychique de la mère.
L’entretien psycho-éducatif périnatal a été développé dans le but de permettre à la mère de s’adapter à ce nouveau rôle en l’entraînant à trouver ses propres ressources.
Enfin un outil simple, à utiliser de manière systématique pour des situations non pathologiques dans un but de prévention, aussi bien en prénatal qu’en post-partum ou en suivi postnatal. Il est également accessible au grand public.
Lire aussi l’article de Chantal Razurel : « Naissance du premier enfant : pas toujours simple », REISO, revue d’information sociale de Suisse romande, 13 janvier 2014.
-
Unique à Genève, le guide La Clé permet de s’orienter à travers le réseau des services publics et des organismes œuvrant dans le domaine social. Il propose en effet 1’700 adresses d’organismes privés et publics des secteurs médico-social, socioculturel et socio-éducatif de la ville et du canton de Genève. Résultat d’un minutieux travail de mise à jour, ce guide est aussi bien destiné aux particuliers qu’aux professionnels et bénévoles, les acteurs sociaux du canton.
En publiant La Clé, l’Hospice général entend également contribuer à améliorer la qualité de vie de la collectivité genevoise en jetant des passerelles entre les associations et les personnes en quête d’appui, mais aussi entre le secteur privé et les administrations publiques. Notre collaboration avec de nombreux organismes, figurant dans le présent répertoire incarne cette complémentarité.
NDLR: Depuis 2017, le répertoire La Clé (et celui d'Ariane sur les fonds et fondations) est uniquement disponible en ligne, où les informations sont actualisées en permanence. Lien vers le moteur de recherche
Les annonces du réseau
L'affiche de la semaine

Pour un usage raisonné des écrans - formation universitaire basée sur les derniers résultats scientifiques. Expertise académique reconnue et impact professionnel direct.